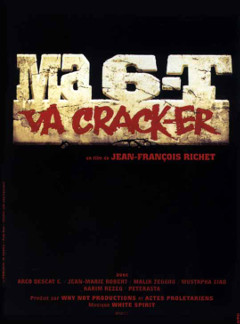
REALISATION : Jean-Francois Richet
PRODUCTION : Actes Proletariens, Why Not Productions…
AVEC : Jean-Francois Richet, Arco Descat C., Jean-Marie Robert, Malik Zeggou…
SCENARIO : Jean-Francois Richet, Arco Descat C.
PHOTOGRAPHIE : Valérie Le Gurun
MONTAGE : Jean-Francois Richet
BANDE ORIGINALE : White & Spirit
ORIGINE : France
GENRE : Drame
DATE DE SORTIE : 02 juillet 1997
DUREE : 1h45
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Au cours d’une soirée hip-hop, très attendue par les jeunes d’un quartier, une fusillade éclate. La police intervient, un policier tire. Un mort. Les jeunes du quartier, désorientés, se révoltent…
Pas facile à digérer, c’est sûr. Pas facile à juger, c’est encore plus sûr. Pourtant, on en sort avec la sensation de s’être pris un gros coup de boule dans la tronche. Peut-être plus que n’importe quel autre film, Ma 6-T va crack-er est clairement le genre de film qui manque de respect, et envers lequel on a un peu peur de manquer de respect. Rien d’étonnant, le film semble fait pour interloquer, pour interpeller, voire même pour déplaire si l’on en croit les réactions énervées qui auront accompagné sa sortie en salles. Trop manichéen pour les adeptes de la nuance, trop frontal pour les fanatiques du débat, trop violent pour les âmes sensibles, trop idéologique pour la diffusion grand public, trop anti-flic pour ne pas se prendre une polémique en pleine face, etc… Rien n’aura été épargné au projet de Jean-François Richet. On aura eu droit au retrait du film en salles, ainsi qu’à l’accroche « film interdit » sur les jaquettes VHS et DVD, histoire d’en rajouter une couche dans la médiatisation du film-choc. Et malgré tout cela, on ne va pas se mentir, c’était couru d’avance : pamphlet politique revendiqué par son auteur, le film de Richet mixe une vision pessimiste de la banlieue à un discours pseudo-marxiste brûlant comme un cocktail molotov, ce qui suffit amplement à susciter l’horreur chez les donneurs de leçons.
En guise de schématisation, on aurait ici les banlieues (version dure) qui prôneraient la guérilla urbaine face à la police, sur fond de rap militant et de violence hyperréaliste. Même le point de départ de l’intrigue a lui-même des allures de tract qui mettrait les choses au clair : quelques jeunes de banlieue subissent un quotidien tout sauf reluisant, jusqu’au soir où une fusillade entre gangs rivaux éclate au cours d’une soirée hip-hop, allant même jusqu’à provoquer la mort de deux jeunes par des flics venus rétablir le calme. Résultat : le chaos. D’emblée, l’influence de La haine, basé sur le même sujet et sorti deux ans avant ce film, s’impose comme une évidence. Sauf que si Kassovitz tentait une explication du terrible engrenage amenant à cette violence, Richet ne faisait pas dans la dentelle ou dans l’explicatif, ne cachait pas son mépris pour les forces de l’ordre, se mettait quasiment du côté des casseurs, et choisissait l’angle du propos révolutionnaire… Tout ça, c’est ce que l’on avait retenu du film, avec la certitude d’avoir vu un film engagé, sans concessions. Mais le revoir aujourd’hui ne procure pas le même effet, et on se surprendrait presque à y trouver de la nuance. Un film social à thèse ? Certainement pas. Un appel à la révolte ? En fait, pas vraiment. Juste la volonté de filmer frontalement une réalité qui n’en finit plus de ne jamais finir.

Même s’il portait là une fois de plus son engagement prolétaire en bandoulière, le jeune cinéaste connaissait son sujet sur le bout des ongles (il a lui-même vécu dans la cité de Meaux pendant des années) et ne cherchait qu’une chose : capter la colère de sa cité, de tous ceux à qui le droit de s’exprimer reste (très) limité. Il le faisait déjà dans son premier film, Etat des lieux, où Patrick Dell’Isola incarnait un prolétaire conscient de sa condition sociale et subissant quotidiennement la rudesse du monde du travail. Une vision sèche, sincère, réaliste, sans fioritures, et épicée d’un vidéo-clip du rappeur Base Enemy aux paroles radicalement marxistes. Un an après, que restait-t-il de cet état des lieux ? Tout, puisque le contenu n’a pas changé, à part l’emballage : on passe d’un titre sobre à un habile jeu de mot à connotation prophétique, et la rage prend un relief beaucoup plus affirmé. Pendant une bonne heure, pourtant, rien de hardcore à relever : en se contentant de suivre les déambulations incessantes de deux bandes de potes (l’une composée de cancres lycéens, l’autre de dealers à la vingtaine passée), Richet capte aussi bien la tension que la sensation de tourner en rond. Des cages d’escalier aux centres commerciaux, en passant par les bancs et les salles de classes, chacun semble errer sans but, sans destination précise, sans jamais rencontrer personne, à part pour se cogner ou s’insulter. Pas de réel scénario, juste un quotidien morne et exaspérant que Richet sait capter et à filmer sous tous les angles, dont on ne sait rien des intervenants (à part leurs noms) et chez qui ne ressortent que des discussions sans intérêt (des keufs à fumer, des meufs à choper, etc…).
A l’inverse de ce que l’on pouvait voir chez Kassovitz ou Kechiche, l’humour n’a plus lieu d’être et la désolation semble totale. Mais cette misère sociale, généralement exploitée pour fournir des sujets bien démago au Droit de savoir, sonne ici d’une profonde justesse, du naturel des jeunes acteurs jusqu’à la moindre ligne de dialogue. Et le cinéaste développe alors des scènes-clés, plus ou moins reliées les unes aux autres, où la fragilité narrative du montage donne au réel un relief inédit : une bagarre à l’école, un match de basket-ball qui dégénère, une confession existentielle sous un abribus, des séances de drague ridicules où chacun se la pète face aux filles, des fauches de bouteilles d’alcool au Leclerc, etc… Les flics, dans tout cela, ne sont que des figures fluctuantes, pratiquant souvent le contrôle musclé ou osant parfois la bavure répugnante. Peu à peu, l’inaction laisse place à la réaction : pour sortir de la monotonie et de l’injustice, il n’y a rien d’autre à faire que d’agir en réaction. Mais là encore, difficile de considérer Richet comme un pro-banlieusard. En témoigne l’édifiante première scène du film, où se déroule la confrontation tendue entre les trois protagonistes et leur proviseur : entre la bêtise d’une jeunesse sans repère ni futur (les ados restent joviaux, inconscients de leur bêtise) et une classe aisée qui les condamne au silence (le proviseur n’a de cesse que de leur clouer le bec à chaque début de phrase), la situation se révèle un peu plus complexe que prévu. Tout le film est dans cet entre-deux, diffus mais bien réel : qu’il s’agisse des banlieusards ou des représentants de l’ordre (moral ou juridique), personne n’a vraiment le beau rôle dans ce monde.

C’est lors d’une soirée hip-hop que tout bascule : deux gangs qui s’affrontent au shotgun pour un motif vaguement énoncé, des jeunes qui s’agitent alors pour transformer la soirée en émeute, une bagnole qui crame, des flics qui interviennent, des coups de feu, la mort vient de frapper l’un des jeunes. Le temps d’un travelling en spirale au-dessus du cadavre, on comprend que l’étincelle vient de s’allumer. Le film n’est alors plus que violence : vitres brisées, bagnoles retournées, cabines téléphoniques brûlées au cocktail molotov, intervention musclée des CRS, coups de matraque à répétition, morts en pagaille, etc… Cette seconde partie quasi westernienne, durant laquelle Richet filme les émeutes comme jamais personne ne l’avait fait avant lui (caméra portée, violence extrême, ralentis à la Peckinpah, montage aux cassures radicales…), est celle où le spectateur aura peut-être du mal à suivre le propos, Richet s’étant senti obligé de balancer un rap ultra-explicite et de citer un article de loi pour illustrer le bien-fondé d’une révolte sociale. De même que l’ouverture du film, pseudo-clip prolétarien où Virginie Ledoyen joue les icônes révolutionnaires avec kalachnikov et drapeau rouge, virait déjà à l’allégorie un peu lourde sur la nécessité de sortir les armes. Reste que le montage, éclaté et percutant, devient une incarnation du chaos : dès lors, la perte des repères empêche de savoir qui tire sur qui, l’affrontement vire à l’absurde, et l’énergie affolante qui se dégage de l’émeute révèle l’impasse d’une société fracassée.

Sous l’impulsion d’une mise en scène virtuose (dans les scènes de tension, Richet use magnifiquement du travelling circulaire), la forme du film se met alors à contrebalancer le fond, transformant le spot de propagande marxiste en peinture radicale d’une révolte inéluctable. Entre une population vivant dans une oppression bétonnée sans réelle perspective d’avenir et des flics angoissés à l’idée de devoir gérer des révoltes incontrôlables, difficile de savoir aujourd’hui qui juger. Et comme le film n’impose pas au final de constat heureux sur cette révolte par le sang, c’est presque comme si Richet était lui-même conscient que ce nouveau mouvement de colère insurrectionnelle n’allait rien arranger du tout. C’est sans doute là qu’il faut interpréter le clip de rap final sur fond d’émeutes : moins appel à la révolte que l’expression d’une colère bien réelle par le biais d’un découpage musical, ce qui, en y réfléchissant bien, suffit à donner à Ma 6-T va crack-er la dimension d’un « cinéma-rap », doté d’une rage et d’une énergie interne souvent inouïe. Vu que l’énergie est parfois ce qui suffit à exprimer un réel désir de cinéma, on ne pourra franchement que s’en réjouir. Pas la peine de sortir le gun, donc.

6 Comments
Je déteste les Inrocks, mais je trouve qu’ils ont fait une analyse assez pertinente de ce film (que personnellement, je classe bien au-dessus de « La Haine ») : http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/ma-6-t-va-crack-er-2/
Je pense qu’il ne faut pas aborder ce
film en fonction des commentaires qu’il y a eu à sa sortie. Par
exemple, durant toute cette critique, l’auteur parle de « marxisme »
ou « pseudo-marxisme », sans jamais expliquer ce qu’il y
a (ou non) de marxiste dans le film, ce qui biaise totalement
l’analyse de ce film. Selon moi ce film est l’antithèse complète du
film La Haine, dont le regard sur les banlieues manquait
justement de ce côté matérialisme historique (ce qui est ici
totalement explicite dans le film de Richet, lorsque V.Ledoyen fait
tourner une terre en soufflant dessus avec en fond des images
d’émeutes, etc. …). Certes, La Haine traite aussi des
banlieues françaises, mais il ne suffit pas de faire deux films sur
les banlieues pour les rapprocher aussitôt. Il me semble que le
rapprochement devrait plutôt se faire avec Do the right thing
de Spike Lee (1989), même si dans le film de Spike Lee, la
dialectique est plutôt raciale puisque les protagonistes viennent du
même quartier. Cependant, le film de Richet n’est absolument pas
manichéen et traite avec une rare nuance des banlieues françaises
je trouve (ce qui a fait dire à la bourgeoisie française imprégnée de paternalisme de
l’époque que ce film donne une « mauvaise image » de la
banlieue). Bref, pour en revenir au terme marxisme, il aurait été
pertinent par exemple de montrer l’évolution d’un nouveau
« Lumpenproletariat », qui selon Marx n’a pas de
conscience de classe, ce qui l’empêche d’être une force
révolutionnaire, ce qui a été modifié par les penseurs de la
décolonisation et du Tiers-Monde (comme Frantz Fanon par exemple).
D’ailleurs, c’est toute la trame du film : le passage d’une
révolte à une révolution (c’est d’ailleurs pour cela qu’ils se
battent d’abord entre eux puis que ça devient une émeute contre les
institutions françaises – et en premier lieu : la police).
L’auteur de cette critique aborde rapidement « les
déambulation incessantes de deux bandes de potes (l’une composée de
cancres lycéens, l’autre de dealers à la vingtaine passée) »,
mais je ne comprend pas pourquoi la critique ne s’arrête pas sur le
fait qu’il s’agisse de deux générations (pour reprendre le
vocabulaire caricatural des médias, les « petits »
et les « grands frères »). En effet, le film date
de 1996, soit peu de temps après les émeutes de Vaulx-en-Velin et
la naissance du « problème des banlieues », il
n’est donc pas anodin que la généalogie de ce « Lumpenproletariat »
moderne passe par deux générations distinctes, dont les parents ont
sans doute connu les différentes guerres de décolonisation. Lorsque
l’auteur de cette critique écrit qu’il n’y a « pas de réel
scénario », je ne sais pas tellement si c’est vrai, cependant
je trouve dommage qu’un parallèle avec le cinéma de Dziga Vertov
n’ait pas été fait, puisque faire un film sur les banlieues est
assez délicat, autant ré-actualiser la technique du cinéaste
soviétique. De même je trouve la phrase « difficile de
considérer Richet comme un pro-banlieusard. » un peu étrange
et sans vraiment de sens. Ici, il ne s’agit pas d’être pro ou
anti-banlieusard, il s’agit de faire face à une réalité (« filmer
frontalement » comme c’est écrit plus haut). Difficile de
clôturer mon commentaire sans parler de la violence : « Le
film n’est alors plus que violence » . Ce qui me gène un
peu ici est le terme « alors », il aurait fallu écrire
« Le film n’est que violence ». Tout le film est
ancré de violence, mais ce sont deux violences différentes :
d’un côté la violence d’un État capitaliste et post-colonial et de
l’autre la violence comme révolte puis comme révolution. La
référence faite au Hip-Hop est assez pertinente mais pas assez
approfondie puisque le montage en lui même est un montage façon
Hip-Hop. On devrait même plutôt dire façon « rap français »
et c’est ici qu’il aurait fallu analyser un minimum la musique du
film, puisque ce sont des groupes comme les 2Bal/2Neg’ ou X Men qui
donne au film la puissance dont l’auteur parle. Bonne continuation
Approche intéressante de Slavoj Zizek sur le terme de « prolétaire » : « Où
faut-il regarder pour trouver un « prolétaire » aujourd’hui, à l’heure
de la prétendue « disparition de la classe ouvrière » ? La meilleure
façon d’aborder cette question est peut-être d’examiner la façon dont la
conception marxienne du prolétaire
renverse la dialectique hégelienne classique du Maître et du Serviteur.
Au cours de la lutte entre le (futur) Maître et le Serviteur, telle que
la décrit Hegel dans sa Phénoménologie de l’Esprit, le Maître est prêt à
tout risquer, y compris sa vie, et acquiert ainsi la liberté, alors que
le Serviteur, quant à lu, est lié non pas directement au Maître, mais
d’abord au monde matériel objectif, est attaché à son enracinement dans
son environnement et, fondamentalement, à sa vie en tant que telle – il
est celui qui n’est pas prêt à tout risquer, et doit pour cette raison
abandonner sa souveraineté au Maître. L’espion soviétique bien connu,
Alexandre Kojève, interprète la dialectique du Maître et du Serviteur
comme la préfiguration de la lutte des classes selon Marx ; ce en quoi
il n’a pas tort, pour peu que l’on garde à l’esprit que Marx a renversé
les termes de cette dialectique. Au cours de la lutte des classes
prolétarienne, c’est le prolétaire qui occupe la position du Maître
hégélien : il est prêt à tout risquer, puisqu’il est un pur sujet,
dépourvu de racines, qui n’a « rien à perdre que ses chaînes », comme le
veut l’ancienne formule. Le capitaliste, au contraire, a un certain
nombre de choses à perdre (son capital, justement), et est donc le
véritable Serviteur, lié à ses biens ; il n’est par définition jamais
prêt à tout risquer, quand bien même il serait l’innovateur dynamique
que célèbrent les médias. Il est important de ne pas oublier que, pour
Marx, loin d’être subordonné au capitaliste, comme l’objet de son sujet,
le prolétaire occupe la position du sujet et tient lieu de subjectivité
pure, non substantielle. C’est la clé qui permet de savoir où trouver
les prolétaires d’aujourd’hui : là où sont des sujets réduits à une
existence sans racines, privés de tout lien substantiel. » (Slavoj Zizek dans « Vous avez dit totalitarisme? Cinq interventions sur les (més)usages d’une notion ». Éditions Amsterdam)
Tout cela est intéressant, merci de vos commentaires. Ceci étant, il s’agit là d’une critique, non d’une analyse. Reprocher à celle-ci de ne pas se montrer exhaustive a autant de sens que cette volonté de disserter sur Marx quand on parle avant tout, ici, de cinéma.
« quand on parle avant tout, ici, de cinéma. « , je ne comprend pas tellement ce que ça veut dire. Le cinéma « en soi » n’existe pas et il se rattache TOUJOURS à des références extérieures. Surtout chez Richet, pour qui Marx est la référence principale (ce qu’il y a écrit dans cette critique d’ailleurs, lorsqu’on parle de « misère sociale », du coup je ne comprends pas en quoi c’est un problème de discuter cela). Si j’avais commenté un autre film, qui traite d’un sujet différent, je ne me serai jamais attardé sur Marx. Mais à partir du moment ou quelqu’un veut faire un film, c’est qu’il a une idée en tête et il me semble qu’au centre d’une critique (après, ce n’est que mon avis) il doit y avoir la critique de cette idée (sans pour autant, utiliser le film comme « prétexte » pour parler d’autre chose). Il me semble que dans mon commentaire, toutes les références que je fais, sont rattachées au film et ne sont pas « des références pour elles-mêmes ». »il s’agit là d’une critique, non d’une analyse » : selon moi (après, je peux me planter), même si une critique ne peut pas être aussi exhaustive qu’une analyse détaillée, une critique se base toujours sur une certaine analyse cinématographique. Ce que je reproche à cette critique est de vider le film de sa substance, alors que c’est cette substance qui en fait un film assez fort. D’ailleurs, je m’étonne que ma remarquer sur Dziga Vertov n’ait pas été prise en compte et que d’ailleurs, la forme de ce film est relativement peu présente dans la critique.Ceci dit, il ne s’agit pas d’un manque de respect pour l’auteur, je me suis attardé sur le contenu de la critique
Ce film est un brûlot idéologique fumeux quasiment de la même trempe qu’un Forces Occultes, il est purement idéologique, incite à la violence, à la haine gratuite et saupoudre ça avec l’oeil romantisant du réal, croyez le mes amis, il n’y a absolument rien de marxiste dans les banlieues, j’y ai habite toute ma vie et les gens ne parlent que de mettre des carottes et se faire un max d’oseille pour se casser au soleil donc au final le réal se trompe. Et je me demande comment des gens attaché à la démocratie peuvent avoir un oeil bienveillant à l’égard de ça. Vraiment.