Intro

© Rue des Archives / BCA
« Claude Lelouch, retenez bien ce nom, vous n’en entendrez plus jamais parler… »
Cette phrase, qui inaugurait la critique du Propre de l’homme par les Cahiers du Cinéma en 1961, se voulait prophétique. Elle prouva finalement que, comme trop souvent, la clique des Cahiers avait tout faux dans ses prévisions. Que l’on soit fan sincère ou détracteur compulsif du cinéma de Claude Lelouch, cela fait déjà plus de cinquante ans que le cinéaste continue de tourner à vitesse régulière, bravant les vagues de la critique pour mieux aller à la rencontre du public. Depuis la découverte accidentelle de Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov au cours d’un voyage à Moscou, c’est dire si le bonhomme aura vécu avec le cinéma dans la tête comme on a besoin d’oxygène pour les poumons, avec un parti pris risqué mais ô combien vénérable : faire du cinéma en même temps qu’on en apprend les bases et les rouages. Quatre-vingt ans au compteur, plus de cinquante films sur un CV que beaucoup doivent lui envier, deux Oscars, quelques Golden Globes et une célèbre Palme d’Or sur l’étagère, sans oublier une réputation de grand auteur vénéré à l’internationale par tant de cinéastes, allant de Sydney Pollack à Quentin Tarantino en passant même par Stanley Kubrick, Steven Soderbergh et même William Friedkin (qui aura même choisi Amidou pour Sorcerer après l’avoir vu dans La vie, l’amour, la mort). Et pourtant, rien n’y fait : entre Lelouch et la sphère cinéphile française, les clivages analytiques et intellectuels n’ont toujours pas perdu en intensité, d’autant que ses derniers longs-métrages se font de moins en moins médiatisés et de plus en plus conspués avec le temps.
Ne vous est-il jamais arrivé, au cours d’une discussion entre cinéphiles, de voir tout le monde faire la grimace ou les gros yeux lorsque vous prononciez le mot « Lelouch » dans une phrase ? Bien sûr que si – l’auteur de ces lignes en sait d’ailleurs quelque chose… Qu’est-ce qui pose réellement problème avec Lelouch ? Sa naïveté assumée ? Son trop-plein de stars Paris Match et de musique pompière ? Son « amour de l’amour » au milieu d’un amas de tautologies mièvres ? Son art du dialogue too much ? Son rejet catégorique de la Nouvelle Vague (selon lui, « une révolution pour les chefs opérateurs, pas pour les cinéastes ») ? Sa mégalomanie explosive qui se bercerait d’illusions sur son propre travail ? Sa prétention survoltée allant jusqu’au fait de parler souvent de lui à la troisième personne ? Après avoir épuisé la filmo lelouchienne, on en tire trois constats : 1) il y a du vrai et du faux dans cette liste de reproches, 2) c’est souvent moins le film que le cinéaste (voire la personne) qui est attaqué, 3) attraper sa filmo en vol sans l’avoir entamée à partir du début revient à passer à côté de beaucoup de choses. Et on s’en rend bien compte, dédaigner le cinéaste d’Un homme et une femme pour mille et une raisons s’avère assez facile – et donc faussé – lorsque l’on a vu à peine un ou deux de ses films (et pas forcément les plus représentatifs de sa sensibilité). Or, à partir du moment où l’on fait l’effort de lire entre les lignes et de mettre en parallèle deux évolutions (celle d’une carrière et celle d’une vie, ici totalement liées) pour mieux disséquer la construction d’un style à part entière, l’impression s’avère très différente. On en vient même à considérer Lelouch non pas comme un génie (n’exagérons rien !) mais clairement comme un cinéaste incompris et malgré tout majeur, dont la carrière est en soi un film passionnant.
L’objectif de cette très longue rétrospective n’est donc pas tant d’adresser un mea culpa à un cinéaste que l’on aura pu parfois dénigrer par le passé (même s’il y a quand même un peu de ça…), ni même de réhabiliter la plupart de ses films ou de bousculer certains de nos aprioris (car certains d’entre eux n’auront pas disparu après coup), mais plutôt de parcourir en détail une carrière tellement vaste et intimement liée à son cinéaste qu’il est apparaît indispensable de ne pas l’appréhender de façon parcellaire afin de se bâtir un jugement ferme. Une carrière où chaque film constitue une étape de plus sur un trajet vers l’inconnu, impliquant autant de bons moments que de mauvais, et où le fait de suivre un cinéaste qui se découvre va de pair avec celui de suivre un être humain qui se construit. Et comme nous avons ici affaire à un cinéaste ayant traversé plusieurs décennies et utopies qui auront jalonné son parcours, ce long retour en arrière permettra en même temps de replonger dans les coulisses de l’Histoire, et pas seulement celle du 7ème Art… Alors, une fois de plus, comme dirait Lelouch lui-même : tournez manège, et que le spectacle commence !
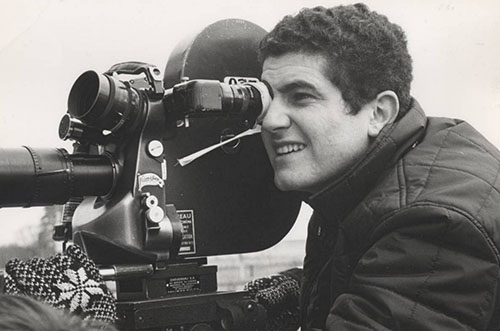
1960

LE PROPRE DE L’HOMME
France – 1960 – 1h30
Ce n’est désormais plus un secret pour personne : les débuts de Lelouch réalisateur en 1960, ce fut la cata. Un désastre si violent que le cinéaste ira jusqu’à détruire lui-même le négatif et les trois seules copies existantes du film deux ans après sa sortie éphémère (celui-ci tiendra à peine une semaine dans un petit cinéma d’art et essai de Paris !). De ce fait, il n’est plus possible aujourd’hui pour qui que ce soit – y compris Lelouch lui-même – de visionner ce premier essai totalement raté qu’était Le propre de l’homme. Toutefois, l’historique du film et les souvenirs du cinéaste permettent d’y démêler ce qui a pu clocher dès le début et de voir ainsi se dessiner les premiers pas d’un style en mutation patiente… Fort d’un parcours solide en tant que caméraman d’actualités (notamment au Service Cinéma des Armées, où son efficacité et sa rapidité d’action firent sensation), le jeune Claude Lelouch se sentit alors prêt à passer le cap du premier long-métrage de fiction. Avec dix mille dollars issus de la télévision canadienne, il créa en 1960 sa société de production Les Films 13 et se lança très rapidement dans le tournage du Propre de l’homme, sur lequel il occupa les postes de réalisateur, producteur, scénariste et même acteur !
Lelouch qui fait l’acteur : voilà un détail qui a son importance, car il détermina à lui tout seul l’échec absolu du film. Dans son idée de suivre la première journée d’un couple à travers les rues de Paris, Lelouch partait de l’idée suivante : c’est en posant leur regard sur les autres que cet homme et cette femme finissaient vraiment par se découvrir eux-mêmes. Encore riche de son expérience comme caméraman d’actualités, le cinéaste opta pour un tournage-guérilla où l’improvisation et le jeu avec la foule furent exclusifs, tout en donnant lui-même la réplique à sa compagne Janine Magnan. On voit bien ce qui l’intéressait : faire du cinéma-vérité au sein d’une fiction, où le réalisateur baserait toute sa mise en scène sur sa façon à lui de jouer la comédie. Novatrice en l’état, cette bonne idée aura finalement été la pire de toutes. En voulant à la fois jouer, diriger et filmer en direct sans se baser sur un scénario établi en amont, Lelouch aura accumulé toutes les erreurs possibles par excès de prétention, aboutissant in fine à un résultat calamiteux. Il suffira alors d’une projection désastreuse à la Cinémathèque française pour que le cinéaste se retrouve au bord de la faillite. Outre le mépris total de la critique, Lelouch devra même endurer le décès de son père quelques jours plus tard… Bref, au début, tout va mal. Et ce n’est que le début…

L’AMOUR AVEC DES SI
France – 1962 – 1h25
Désormais couvert de dettes, Lelouch se retrouve de nouveau sous le coup d’un nouvel échec : adapté d’un scénario de Jean Fougères, La vie de château verra son tournage arrêté au bout d’une semaine par manque d’argent et absence d’une vraie trame. Dur. Son salut viendra des fameux « scopitones », ces petits films musicaux dont il deviendra en quelques années l’un des plus créateurs les plus branchés, remboursant ainsi toutes ses dettes et découvrant au passage la force capitale de la musique dans un film. Jusqu’en 1962, année durant laquelle le cinéaste revient au cinéma avec son premier film officieux L’amour avec des si. Tourné en deux semaines façon système D avec l’argent gagné par Lelouch sur les scopitones, ce petit film ne sortira finalement qu’en Suède, où il fera d’ailleurs un tabac après son passage dans un festival et ira même jusqu’à recevoir l’approbation d’Ingmar Bergman en personne. D’ailleurs, l’avis réel de Bergman sur le film vaut son pesant de cacahuètes : « C’est un film raté, mais c’est un grand cinéaste qui l’a fait ». En revoyant le film a posteriori, on ne peut que comprendre ce jugement.
Basé sur une anecdote bien réelle de Claude Lelouch, ce road-movie sur les routes enneigées de la Côte d’Opale se veut une réflexion malicieuse sur les apparences et le qu’en-dira-t-on. Tout part d’une situation hitchcockienne en diable : un homme prend une jeune femme en stop, et à la radio, on annonce l’évasion d’un violeur sadique dont le signalement correspond en tous points à celui du conducteur. Et si c’était vrai ? Et si cette femme cachait quelque chose ? Et si tout ceci n’était que le début d’une histoire d’amour ? Et si ceci, et si cela… ? Pas de doute, le film avait bien choisi son titre. Mais cette suite de possibilités se répercute hélas sur un film qui aurait dû gagner à resserrer sa narration à double fond. Lorsqu’il s’attarde sur ses deux acteurs en jouant sur l’ambiguïté de leurs regards, le cinéaste marque de sacrés points. Mais lorsqu’il tente de jouer l’esquive pour désorienter, ses effets convainquent moins. Lelouch aura beau insister sur le fait que le vrai sujet du film est l’impact de la radio (qui essayait à l’époque d’imiter la télévision), on en arrive à être un peu éjecté du récit à force de voir des informations de radio transformées en images (lorsque le héros écoute une chanson des Brutos, Lelouch case ici un de leurs scopitones dans le montage). Et les cassures narratives s’enchaînent alors, avec une course hippique, des photos de faits divers, des images mentales sur le D-Day, et même un micro-trottoir de Jacques Martin qui interroge les passantes sur le viol devant un cinéma qui diffuse Les Vierges de Jean-Pierre Mocky !
D’un bout à l’autre de son récit, Lelouch tente des choses, mais balbutie encore comme un élève de la Nouvelle Vague qui ferait joujou avec le montage, moins par souci d’expérimenter quelque chose de neuf que par souci de prouver à tout prix qu’il a de l’audace à revendre. Comme l’a bien souligné Bergman, on sent en permanence un vrai grand cinéaste derrière la caméra (la mise en valeur des paysages côtiers et les cadrages sophistiqués le prouvent), mais on sent aussi un jeune débutant qui veut trop en faire par peur de ne plus jamais pouvoir faire de film, et qui, par moments, dérape. L’utilisation ironique d’une chanson d’amour sur une course-poursuite rallongée et montée n’importe comment, la distinction profondément naïve et maladroite entre la méchanceté et la maladie au détour d’un dialogue, le montage parallèle absurde entre le débarquement des Alliés et une femme qui court entre les blockhaus, la description sonore des pensées de l’auto-stoppeuse sous forme d’une comptine ridicule qui dérive vers la reproduction sexuelle (!), un bon paquet de conneries dans les dialogues (« Le viol est une invention féminine »), des effets de zooms avant/arrière qui se calent sur la respiration du héros, des plans qui se répètent, etc… Des gaffes, L’amour avec des si en compile un grand nombre. Il n’en reste pas moins un essai attachant, duquel les plus attentifs pourront extraire les prémices de films comme Roman de gare ou Chacun sa vie.

LA FEMME SPECTACLE
France – 1963 – 1h24
« De tous les films que j’ai faits, c’est celui dont j’ai le plus honte. En acceptant cette commande sans en deviner le piège, j’ai trahi ce que j’aimais le plus au monde : les femmes et le cinéma »… À travers ces deux phrases expédiées dans son docu D’un film à l’autre, Claude Lelouch fait clairement comprendre que La femme spectacle – seul et unique film de commande de sa carrière – n’est pas un film sur lequel il (lui) faut s’attarder. On le comprend au vu de cette œuvre problématique, assimilable à un brûlot ultra-misogyne que Pierre Braunberger – l’un des producteurs de la Nouvelle Vague – lui aura proposé suite au succès de L’Amérique insolite de François Reichenbach. Le principe est ici le même que pour ce dernier : explorer un sujet d’étude dont il s’agit de capturer la part d’insolite. Les femmes étant son sujet de fascination préféré, Lelouch embraye donc sur une idée pour le moins osée : filmer les femmes qui ne lui font pas envie, qui lui font peur ou qui le dégoûtent, sous la forme d’un gros délire hétéroclite où les passages documentaires alterneraient avec des sketchs entre Jean Yanne et Gérard Sire. Sauf que le mélange fiction/réalité, aussi culotté soit-il, doit ici se coltiner un regard obscène sur la gent féminine, la prostitution et les travestis. En matière de dérapage, Lelouch battait donc ici tous les records.
Selon certaines rumeurs, Lelouch aurait réalisé un mondo sans s’en rendre compte. On confirme. L’action des sécateurs de la censure y aura été pour quelque chose : d’une durée initiale de 2h15, le résultat fut amputé d’une cinquantaine de minutes (des scènes-chocs d’une rare obscénité, paraît-il) et intégra une voix off débitant un commentaire puissamment débile avec un premier degré à peine croyable. D’où cette vraie-fausse expérience de cinéma-vérité où la « femme-objet » devient un rat de laboratoire disséqué avec un ton réac au possible. Ainsi donc, le spectacle d’une femme qui accouche est « le plus pathétique qui soit », la femme banale veut à tout prix être une femme fatale calquée sur le mythe Bardot (ah bon ?), les grands magasins ont été inventés pour elle (sic), la chirurgie esthétique est gage de perfection (« Comme la chrysalide devient papillon, un masque aux lignes plus harmonieuses sort du masque rectifié »), la femme moche devient meurtrière en voyant une jolie femme dans les bras de celui qu’elle convoite (ce qui nous vaut un surréaliste champ lexical de la jalousie en voix off !), l’intelligence féminine est dangereuse, un défilé de mannequins permet de distinguer les « pieds intelligents » des « pieds bêtes », on organise des concours de « Miss Spaghetti » et de « Miss Sourde-Muette », les prostituées s’exhibent parce qu’elles aiment ça, les strip-teaseuses sont d’obscènes communistes qui aimeraient voir les ouvriers gagner autant d’argent qu’elles, et les travestis zonant dans les bars interlopes de Paris sont des dépravés qui doivent être soignés… Tant d’âneries douteuses pour le plaisir des yeux et des oreilles, ça fait un drôle d’effet !
Bombardé de gimmicks formels et expérimentaux qui ne servent à rien, ce gros délire schizo impose un choix cornélien : hurler au scandale par pur réflexe moral ou rire nerveusement des conneries qu’il tente de nous faire avaler. Histoire d’être cohérent avec l’esprit du mondo (catégorie de films racoleurs représentant des ignominies grotesques avec une approche pseudo-documentaire), on opte pour la seconde option. C’est même d’autant plus facile qu’une pirouette assez roublarde en arrive à sauver le film. En effet, dès l’intro, Jean Yanne et Gérard Sire – présentés comme les vrais réalisateurs du film – tentent un générique parlé sous la pluie avec un sacré je-m’en-foutisme (genre « On s’en fout du titre, il ne veut rien dire ! », « On dit cinéma-vérité parce que ça marche toujours d’improviser ! », « Le réalisateur n’est même pas connu », etc…). On repère là une astuce que Lelouch reprendra souvent dans ses futurs films : jouer avec sa propre image comme avec l’artifice de sa mise en scène. Depuis, Lelouch tente à tout prix de faire oublier ce film. Avis aux cinéphiles en quête de raretés embarrassantes : voici un Graal inespéré… et inestimable !
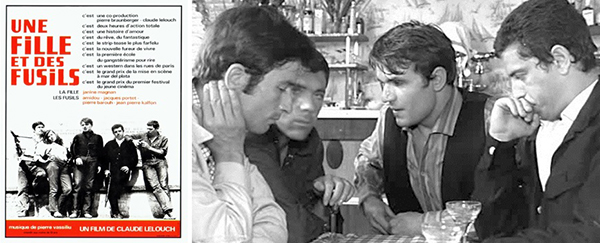
UNE FILLE ET DES FUSILS
France – 1964 – 1h44
Lorsqu’on le questionnait sur ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas réussi à percer dans le cinéma, Lelouch disait volontiers qu’il aurait pu devenir un voyou. Drôle de coïncidence quand on sait que le premier « succès » de sa carrière narre les aventures d’une petite bande d’ouvriers cinéphiles qui décident de devenir gangsters en utilisant les films qui les ont marqué – surtout les westerns et les polars avec James Cagney – comme base d’apprentissage. Une façon comme une autre pour Lelouch d’asseoir son amour immodéré pour le cinéma en évoquant par voie détournée le jeune cinéphile illuminé qu’il était dans son enfance, et qui, à force de se gaver de films au lieu d’aller à l’école, ne distinguait plus le rêve de la réalité. Improvisé en trois semaines avec Janine Magnan (ici dans le rôle d’une sourde-muette) et quatre amis aussi autodidactes que lui (Jean-Pierre Kalfon, Pierre Barouh, Jacques Portet et Amidou), Une fille et des fusils constitue au final une étape décisive dans la carrière de Lelouch, inaugurant cette longue liste de films de potes drôles et décomplexés comme Smic, Smac, Smoc ou L’aventure c’est l’aventure – dont il constitue d’ailleurs un brouillon assez évident.
C’est peut-être la seule fois où un film de Lelouch donnait l’impression de transpirer la Nouvelle Vague par tous les trous du celluloïd : pas de dialogues écrits à l’avance, des acteurs débutants, un tournage-guérilla, un sujet anticonformiste et gorgé de cinéphilie, un Paris filmé comme chez Jacques Rivette (amusante scène de visite parisienne où l’on communique en écrivant sur les murs), un effet de mise en abyme qui intègre un tournage de film dans le film, la voix off d’un Gérard Sire qui semble taper le scénario à la machine, etc… La différence venait du regard amusé et naïf que Lelouch posait alors sur des personnages qui l’étaient tout autant, d’où ce résultat assez instinctif qui prenait d’abord racine dans la comédie pure avant de basculer dans le drame lors de l’enlèvement raté d’un sosie de Brigitte Bardot. Jusqu’à un épilogue tragique que Lelouch voulait moral. À noter qu’il existait une autre fin, moins tragique, qualifiée de« pirouette minable » par le réalisateur (on y découvrait que le film entier n’était que le rêve d’un prisonnier), que Pierre Braunberger lui avait réclamée pour des raisons purement commerciales… Avec Une fille et des fusils, le cinéaste faisait encore ses gammes en douceur, mais réussissait au moins à toucher le public avec un petit objet sincère et sans prétention qui lui parlait. Tel sera dès lors son credo tout au long d’une carrière en dents de scie : lire l’échec comme une victoire déguisée, et se servir de lui pour avancer.

LES GRANDS MOMENTS
France – 1965 – 1h25
Une fille et des fusils avait-il sérieusement besoin d’une suite ? Vu son épilogue, on en doute fort… Toujours est-il qu’en sortant de ce petit succès public, Lelouch se retrouve encouragé par Pierre Braunberger à tourner un film bien plus ambitieux. Le réveil sera plus que brutal : en reprenant la même équipe de comédiens (lesquels jouent ici des rôles sensiblement différents) pour décliner le même concept sous la forme d’une parodie de James Bond (un genre très en vogue à l’époque), Lelouch commettait là ce qu’il juge encore aujourd’hui comme étant la pire erreur de sa carrière, le plus raté de tous ses films. D’autant plus raté qu’il bénéficiait là de gros moyens et utilisait pour la première fois le Scope pour mettre en valeur l’action. Mais hélas, une bonne enveloppe budgétaire et une bonne idée de départ, ça n’a jamais suffi à faire un bon film.
On ne peut rien dire de précis sur Les grands moments, si ce n’est quelques informations glanées ici et là dans les interviews de Lelouch : à première vue, le film comprenait quelques bancs-titres qui interpellaient le spectateur sur un mode potache (du genre « vous comprendrez la raison de cette scène de bagarre dans cinq minutes »). Mais là encore, tout porte à croire que le résultat était plus proche d’un brouillon que d’un vrai film, un peu comme si Lelouch continuait de pratiquer le cinéma comme on tenterait de faire une expérience de chimie les yeux bandés dans un laboratoire. Le cinéaste avait même tellement honte de son film qu’il aura été jusqu’à débourser un million de francs un an plus tard pour en racheter les droits, afin qu’il ne soit jamais montré. Selon la rumeur, il aurait même détruit le négatif après avoir assisté au rejet absolu de tous les distributeurs sollicités. C’est d’ailleurs en sortant d’un de ces rendez-vous qu’il décidera un soir de prendre sa voiture, roulant à 200 km/h en direction de Deauville, totalement déprimé et à deux pas du suicide. Arrivé à Deauville vers trois heures du matin, il s’endormira dans sa voiture face à la plage… Mais avant d’aller plus loin, il est temps d’ouvrir une parenthèse…

… POUR UN MAILLOT JAUNE
France – 1965 – 20min
À l’époque tricard dans la profession pour cause d’un enchaînement de bides désastreux (avec celui des Grands moments comme point d’orgue), Claude Lelouch se retrouva privé de fictions et, plus encore, menacé à nouveau d’une faillite de sa société qui prendra effet à la fin de l’année 1965. Le cinéaste n’avait donc que quelques mois devant lui pour trouver une solution au problème, et ce fut au travers d’une commande du directeur du Tour de France, Jacques Godet, qu’il trouva le moyen de sauver sa société de production en un temps record. Le voilà ainsi de nouveau dans la peau d’un caméraman d’actualités, lancé sur les routes du Tour de France en juillet 1965 pour enregistrer sur pellicule ce qui reste autant un événement sportif qu’une fête populaire. Lelouch avait alors pour consigne principale de réussir à capturer ce que le Tour pouvait avoir d’insolite, et en conséquence, son choix de rester focalisé sur tout ce qui ne relevait pas de la compétition s’est avéré être l’angle idéal.
Certes, dans la mesure où le film était financé par les sponsors du Tour, la caméra de Lelouch prend très souvent le soin de s’attarder sur les marques portées par les coureurs. Pour autant, tout ce que touche le Tour de près ou de loin et que les médias tendent à conserver en arrière-plan se retrouve ici habilement condensé, du travail des médecins jusqu’aux réactions des gens postés sur le bord des routes, en passant par la coordination des équipes et le ravitaillement des coureurs, le tout avec un regard objectif et dépourvu du moindre commentaire. Le seul détail un peu étrange que l’on pourrait relever concerne l’utilisation de la couleur (une première pour Lelouch), qu’il alterne ici avec des scènes en noir et blanc sans que le changement d’un format colorimétrique à l’autre ne soit clairement justifié. Un petit détail qui n’altère en rien la satisfaction de découvrir le Tour de France autrement qu’au travers des commentateurs pesants de France 2 et des éternels remous médiatiques sur le dopage des cyclistes.
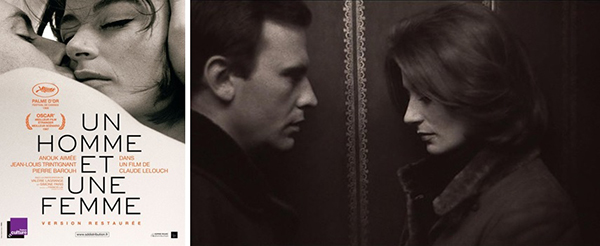
UN HOMME ET UNE FEMME
France – 1966 – 1h42
… et tout à coup, le soleil se lève sur les planches de Deauville. Il est six heures du matin, Claude Lelouch se réveille dans sa voiture, et aperçoit une femme et son enfant sur la plage. En s’avançant lentement vers eux, l’histoire d’Un homme et une femme lui vient en tête. Demi-tour. Le cinéaste griffonne tout le scénario dans un bar, rentre fissa à Paris et tente alors l’impossible pour tourner le film qui lui donnera enfin le succès et (surtout) une carrière. Palme d’Or à Cannes, deux Oscars, triomphe planétaire, duo vedette élevé au rang de couple mythique, bande-son surchargée de chabadabadas… Tant d’éloges, mais était-ce mérité ? Chacun jugera… Ce qui ressort aujourd’hui de ce film est malgré tout un constat un peu amer : là où Lelouch désigne Un homme et une femme comme étant sa vraie naissance en tant que cinéaste et ses cinq précédents films comme étant des expériences de laboratoire qui n’auraient jamais dû sortir, on préfèrera considérer qu’il est encore en train d’apprendre son art. C’est d’ailleurs là davantage un fait qu’une opinion subjective, tant Lelouch n’a jamais caché que chacun de ses films était le brouillon du suivant. Mais le vrai miracle d’Un homme et une femme – car miracle il y a quand même eu – tient dans une question d’alchimie toute simple, en tout cas autant que ne l’est déjà le scénario du film.
Les facultés d’analyse sont d’entrée bannies par le minimalisme absolu du titre, lequel résume bien de quoi il va être question. On a souvent réduit le film culte de Lelouch à un canevas simple : deux personnages se rencontrent, ils tombent amoureux, ils s’aiment, puis se séparent, puis se retrouvent, puis se séparent à nouveau, jusqu’à leur étreinte sur le quai de la gare Saint-Lazare. En choisissant de tourner une histoire aussi limpide avec une caméra portée et des acteurs qui improvisent le dialogue en direct, Lelouch est bien en quête d’une vérité cachée, fugace et impalpable, relative à la magie de la rencontre amoureuse qui fait tout naître à partir du hasard et des surprises. Dans un sens, le cinéaste ne s’est pas trompé, puisque le film tient tout entier sur la prestation de ses acteurs pour enregistrer l’irrationnel à travers le rationnel. La retenue déchirante d’Anouk Aimée, la tendre virilité de Jean-Louis Trintignant, leurs retrouvailles sur une plage de Deauville filmée comme un paradis hors du temps, l’idéalisation de leurs métiers respectifs (le cinéma pour elle, la course automobile pour lui), les chansons de Nicole Croisille et de Pierre Barouh qui les accompagnent en fond sonore… On se souvient de tout ça. Mais on en oublie le principal : derrière la romance faussement légère se cache la gravité, insidieuse mais bien réelle.
Ce que l’on voit ici est un dialogue douloureux qui amorce une réconciliation avec la vie. Un homme et une femme, soit, mais avant tout deux êtres veufs, inconsolables, chez qui la mort devient une langue qu’ils sont les seuls à pouvoir parler et comprendre. Les instants les plus bouleversants du film tiennent là-dedans, dans ce jeu de regards et de phrases à demi-mots que la mise en scène de Lelouch, toute entière au service de la spontanéité du jeu et du cadre, arrive à rendre frémissant. Les images, elles aussi, jouent avec nous, alternant la couleur pour les extérieurs et le noir et blanc pour les intérieurs. Lelouch tirera profit de cette contrainte budgétaire afin d’intégrer les flashbacks dans l’action présente, créant ainsi du contraste par le biais d’un montage souvenir/réalité où ce que ressentent les personnages vaut plus que ce qui leur arrive – l’image et le son priment ainsi sur l’intrigue. En revanche, les textes de Pierre Barouh sur fond de la musique de Francis Lai gâchent la fête à force d’être plaqués sur les images et de leur donner le relief d’un clip (composer la musique avant d’avoir tourné un seul mètre de pellicule est en général une mauvaise idée). Peu importe : aussi inégal soit-il, le souvenir laissé par Un homme et une femme reste malgré tout durable. La signature lelouchienne n’a pas encore utilisé toute son encre, mais elle est enfin là, offerte ici au détour d’une citation de Giacometti : entre l’art et la vie, Lelouch choisira toujours la vie – pour lui le plus grand cinéaste du monde.

VIVRE POUR VIVRE
France – 1967 – 2h05
Gérer l’après-succès est un exercice sur lequel tant de cinéastes se sont cassé les dents. En la matière, Lelouch avait fort à faire pour espérer transformer l’essai d’Un homme et une femme, et la découverte de Vivre pour vivre – auréolé lui aussi d’un beau succès et d’un Golden Globe à sa sortie – provoqua mine de rien un sentiment partagé. Mais son origine n’est pour le coup pas celle que l’on pourrait croire. Sous l’impulsion du producteur Alexandre Mnouchkine, le cinéaste se lança à l’époque dans un projet relatant une chasse aux nazis en Amérique du Sud, mais le projet coula sec face au désistement de Jean-Louis Trintignant. N’ayant que trois semaines pour trouver une nouvelle histoire à tourner, Lelouch puisa logiquement son inspiration à une source qui n’allait plus jamais se tarir à partir de maintenant : sa propre vie. Par envie ou par urgence, le cinéaste ne manqua jamais l’occasion de se mettre en scène par voie détournée, d’utiliser le tournage d’un film pour exorciser ses soucis personnels ou pour susciter la désorientation sur son rôle de cinéaste. Là, en l’occurrence, c’est avec son image qu’il jouait : celle d’un type brillant dans son travail (il a du succès) mais minable dans sa vie personnelle (il mène une double vie amoureuse). Ajoutez à cela le fait que le cinéaste avait entamé pendant le tournage une relation secrète avec Annie Girardot (ici dans le rôle de l’épouse trompée !), et vous obtenez une sacrée équation…
Le choix d’un grand reporter comme protagoniste (ici joué par Yves Montand) était bien sûr adéquat pour aborder frontalement l’adultère (c’est plutôt facile pour quelqu’un qui voyage tout le temps !), mais aussi pour évoquer le paradoxe que Lelouch, lui-même ancien reporter d’actualités, devait déceler en lui. Comment avoir la force de prétendre vouloir rapporter la vérité (surtout celle des sentiments) quand le mensonge finit par prendre trop d’importance dans sa vie personnelle ? Or, si Vivre pour vivre peut se lire comme la confession d’un artiste qui aimerait bien se désintoxiquer, les solutions de mise en scène que Lelouch met ici en pratique sont assez contradictoires. Entre une musique romanesque de Francis Lai qui inonde la plupart des séquences (coupant ainsi parfois la parole aux acteurs) et un scénario qui s’attarde davantage sur les reportages du héros autour du monde (au Kenya, au Vietnam, etc…) que sur le triangle adultérin, l’énergie du montage emporte le cœur au lieu d’inviter à l’introspection. Une poignée de moments intimistes sont souvent là pour créer de superbes ruptures dans le récit (notons une très puissante scène de confession dans un train et un superbe monologue de Girardot), mais Lelouch reste trop attaché à la dimension aventureuse de son travail pour toucher du doigt ce sur quoi d’autres (Pialat ou Bergman, au hasard) auraient facilement consacré un film entier, sans jamais tenter l’esquive ou la légèreté.
De même, on a beau lui savoir gré d’honorer la définition de l’humanisme par Jean Renoir (« Tout le monde a ses raisons ») lorsqu’il s’agit de définir et de creuser des personnages dans une histoire (Lelouch a-t-il déjà réellement filmé des « méchants » dans sa carrière ?), le fait de donner à Yves Montand le rôle d’un homme minable (et miroir de lui-même, on le répète) en faisant en sorte de ne pas trop fissurer sa carapace lorsqu’il est mis devant le fait accompli sonne presque comme un aveu d’impuissance de la part du cinéaste. Ou alors, est-ce la preuve qu’il résiste encore à l’envie d’aborder la douleur – et sa propre vérité – de plein fouet ? La suite de sa longue carrière ne manquera pas de démontrer qu’il en était bien capable… En attendant, Lelouch confirme au moins les espoirs placés en lui depuis Un homme et une femme, et progresse encore dans sa façon d’exploiter le découpage et la bande-son pour raconter une histoire et susciter des émotions. Cela suffit amplement à rendre Vivre pour vivre très recommandable.

LOIN DU VIETNAM (film collectif)
France – 1968 – 1h56
À cette époque, la guerre du Vietnam faisait rage, et les voix se faisaient entendre pour la condamner fermement. Le projet collectif Loin du Vietnam avait ainsi pour qualité première de suivre ce vaste mouvement contestataire créé par de nombreux intellectuels français, lesquels condamnaient le conflit avec ténacité, que ce soit en invectivant l’intervention américaine ou en soutenant autant que possible le peuple vietnamien. C’est à la suite d’un appel d’Agnès Varda et de son ami Chris Marker que quelques-uns de ces intellectuels (dont plusieurs cinéastes) décidèrent alors d’utiliser le cinéma comme une arme supplémentaire pour relayer leur colère. Parmi eux se trouvaient Claude Lelouch, Alain Resnais, Joris Ivens, Michèle Ray, William Klein et même un Jean-Luc Godard alors sur le point de monter le fameux « Groupe Dziga Vertov ». Ce film de soutien solidaire en réponse à l’oppression ne dût d’ailleurs son existence qu’au soutien de nombreux artistes (dont Roland Topor et Jorge Semprun) et au bénévolat de nombreux participants. Sa sortie fut polémique : la presse se montra hostile, le public lui fit un triomphe, mais la mise à sac du Kinopanorama par un groupuscule d’extrême-droite en 1967 aura mis un point final à sa diffusion en salles.
Concrètement, le projet tient dans une idée politique exprimée dès les premières scènes : une guerre de riches (les États-Unis) contre les pauvres (les Vietnamiens). Souvent construite avec des segments tournés en 1966 (c’est-à-dire avant le début officiel du conflit vietnamien), cette compilation de points de vue objectifs et subjectifs tend presque à se vouloir prophétique dans ses arguments. On laissera bien sûr aux spécialistes de cette guerre le soin de valider ou non cette hypothèse, mais ce qui reste le plus en mémoire après coup est bien cette exhaustivité du contenu. Ici, Lelouch reprend une simple position de caméraman d’actualités, se contentant de filmer les manifestations en France avec ce style documentaire qui caractérisait ses tous premiers travaux. Formellement assez limité, son travail n’est clairement pas ce qui retient l’attention ici. Outre un Godard qui fait du Godard (il se filme en réflexion sur le sujet au lieu de traiter le sujet !) et une interview de Fidel Castro par Chris Marker, c’est surtout à Alain Resnais que l’on doit le point d’orgue du film : un intellectuel de gauche joué par Bernard Fresson joue les orateurs de mauvaise foi face à une femme qui le regarde sans rien dire, témoin silencieux de ses contradictions et de son inaction. En dénonçant la passivité face à l’horreur, Resnais interpelle directement le spectateur et crée le malaise. Et de ce fait, il sort grand vainqueur de ce précieux film collectif.

TREIZE JOURS EN FRANCE
France – 1968 – 1h55
Fort de deux gros succès internationaux, Claude Lelouch pouvait à peu près tout se permettre en cette année 1968. Seconde rencontre pour lui avec le monde du sport, Treize jours en France fut à la base une commande commune du général de Gaulle (à l’époque président de la République) et d’André Malraux (à l’époque ministre de la Culture), visant à immortaliser l’exploit sportif durant les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble. C’est avec d’autres réalisateurs forts d’une expérience solide en tant que caméramans (François Reichenbach, Guy Gilles, Jean-Paul & Jean-Pierre Jansen…) que Lelouch se lance sans hésiter dans cette nouvelle aventure. Pour le coup, le parti pris de mise en scène sera le même que pour son petit documentaire sur le Tour de France : objectivité maximale, absence totale de commentaires, mélange de performances sportives et de coulisses, enregistrement de tout ce que les médias ne relayaient pas, montage assez frénétique où la sensation prime sur la pédagogie. Et les nombreuses images rapportées par l’équipe de Lelouch avaient de quoi permettre de voir (mieux, de vivre) les Jeux avec un œil nouveau.
Que ce soit pour filmer des exploits sportifs (dont un saut à ski en tremplin cadré sous différents angles) ou pour explorer les à-côtés de la manifestation sportive, ce n’est pas tant le sport en soi qui est mis en avant que le mouvement et l’énergie qui en découlent. Il faudra un moment culte pour en prendre le pouls : une fulgurante descente à ski en vue subjective où Willy Bogner, ancien champion olympique, suit un skieur à très grande vitesse en tenant la caméra au niveau des genoux et sans bâtons (on peut voir la totalité de ce plan dans D’un film à l’autre). Pour un sportif qui prend tous les risques et pour un cinéaste qui tente l’impossible en matière de plans innovants, ce genre de séquence vaut toutes les médailles d’or du monde. On ose à peine imaginer ce qu’aurait pu apporter ce film à la manière de mettre en scène le sport, si toutefois les événements de Mai 68 n’avaient pas prématurément détruit sa carrière. En effet, initialement prévu pour intégrer la sélection officielle du festival de Cannes, le film sera remisé fissa au placard en raison d’une édition cannoise clôturée au bout de quelques jours (les festivaliers avaient préféré se joindre à la manifestation nationale de soutien aux étudiants grévistes). Il faudra ainsi attendre les rattrapages de la section Cannes Classics de 2008 pour le découvrir enfin parmi d’autres films privés de compétition en 1968.
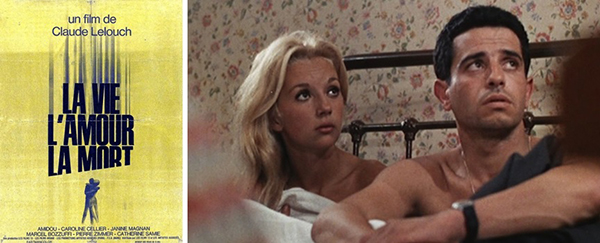
LA VIE, L’AMOUR, LA MORT
France – 1968 – 1h55
Cette fois-ci, les choses sérieuses commencent pour Claude Lelouch… On le croyait totalement enchaîné à la légèreté de la vie et à la force des sentiments amoureux. On le découvre ici fermement engagé sur un sujet sérieux et longtemps polémique : la peine de mort. La vie, l’amour, la mort est l’occasion pour le cinéaste d’embrasser les codes du film à thèse avec la ferme intention de faire changer cette loi. Ce que son ami avocat Robert Badinter, indirectement encouragé dans son action par le biais de ce film, finira par accomplir treize ans plus tard. Mais surtout, ce film montre enfin un Lelouch parfaitement épanoui dans sa science de la narration déstructurée, où le puzzle est dans son état final dès le début et où le récit va tâcher ensuite de revenir sur ses pièces les plus capitales afin d’éclairer l’ensemble. Il fallait bien en passer par là pour illustrer le destin édifiant de François Toledo (Amidou dans le meilleur rôle de sa carrière), homme marié mais infidèle, qui se retrouve un jour arrêté, emprisonné puis condamné à mort pour avoir étranglé trois prostituées. Détail important : la confirmation de ces trois meurtres n’interviendra ici qu’après le procès, sous forme de flashbacks qui surgiront durant les jours précédant l’exécution du condamné.
Au vu du point de vue développé, un tel système narratif constitue en soi une bien étrange idée : en remontant ainsi le temps pour confirmer le crime, le film serait logiquement à deux doigts de pousser son spectateur à accepter le sort réservé au condamné. Sauf que Lelouch, pleinement convaincu du fait qu’un meurtrier est avant tout un malade qu’il s’agit de soigner et non de supprimer, fuit sans cesse le manichéisme pour au contraire creuser le plus possible le personnage de Toledo, sa fragilité, sa douleur et surtout son impuissance (Toledo rend visite à des prostituées pour tenter de défier cette dernière et en arrive impulsivement au meurtre lorsqu’il se sent humilié). De quoi rendre cette longue marche vers la mort d’autant plus interminable et le coup de guillotine final d’autant plus traumatisant. L’influence du Robert Bresson d’Un condamné à mort s’est échappé se fait sentir en permanence au vu d’une mise en scène bien plus sèche et moins tourbillonnante (pas de musique dans un film de Lelouch : incroyable !), mais pas que : celle de Jean-Pierre Melville – grand ami de Lelouch dans la vie réelle – a également son mot à dire dans les premières scènes du film où se joue une longue filature silencieuse entre Toledo et les flics qui tardent à l’arrêter. Le travail sur le son participe là encore à la mise en place d’un climat surchargé de tension, presque anxiogène.
Les deux extrémités du récit illustrent bien le point de vue de cinéaste de Lelouch : démarrant sur la mort lente d’un taureau lors d’une corrida dans les arènes de Nîmes et s’achevant sur la mort rapide de Toledo sous la lame de la guillotine, le film est dans sa globalité le tableau sec d’une société où la mort n’est que spectacle, défini par un cérémonial profondément barbare. Tout comme d’autres cinéastes l’avaient fait avant lui (Cayatte avec Nous sommes tous des assassins, Brooks avec De sang froid, etc…), Lelouch tutoie les bases du réquisitoire symbolique. En témoignent l’excellente idée de présenter la femme de Toledo comme une ouvrière dans une usine de poupées (le simple fait de voir des têtes coupées de jouets dans un atelier annonce déjà l’issue à venir), ou encore ce violent basculement de la couleur au noir et blanc dès l’instant où Toledo, à l’issue du verdict le condamnant à la guillotine, se retrouve avec les menottes aux mains. Lorsque la mort l’emporte sur la vie, il n’y a plus de couleurs à afficher sur l’écran. En filmant le triomphe de l’engrenage d’une légalité sadique sur la dignité de l’être humain, Lelouch lâchait ici le premier grand geste de cinéma de sa carrière.

UN HOMME QUI ME PLAIT
France – 1969 – 1h47
D’abord un couple qui se construit (Un homme et une femme), ensuite un couple qui se détruit (Vivre pour vivre), et après ? Où Lelouch pouvait-il chercher la nouveauté en s’intéressant de nouveau à un couple ? Ni plus ni moins qu’en filmant une parenthèse (dés)enchantée entre un compositeur de musique (Jean-Paul Belmondo) et une actrice de cinéma (Annie Girardot) qui se rencontrent à l’occasion d’un tournage aux États-Unis et qui tombent amoureux… alors qu’ils ont déjà une vie amoureuse chacun de leur côté. Sur le thème de la rencontre entre deux êtres qui vivent une passion éphémère dans un pays qui n’est pas le leur, on pense tout de suite à un film bien plus récent, à savoir Lost in translation de Sofia Coppola qui aura magnifié l’idée à un degré d’émotion et de sensorialité encore inégalé. Lelouch avait tout pour réussir son coup : les décors mythiques de l’Ouest américain (Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon…), une focalisation totale sur ses deux immenses acteurs, une certaine aptitude dans l’évocation détournée de l’adultère, et un solide budget garanti par Alexandre Mnouchkine. À l’arrivée, le film sera un gros échec commercial. Mais l’échec était-il seulement « commercial » ?
L’ouverture sur un appareil de mesure d’unité de volume qui s’agite sous l’effet de différentes strates musicales ne laisse d’entrée aucun doute sur ce qui animait Lelouch sur ce film : se laisser aller par le rythme de l’instant. Un film décontracté, en somme, assimilable à un chouette road-movie dans de vastes décors américains. La première erreur, la voici : même avec un beau sujet qu’il finit par ne jamais traiter réellement, Lelouch finit par ne pas avoir grand-chose à raconter. Trop léger pour être une love-story sans espoir, trop volatile pour explorer avec clairvoyance la complexité des sentiments amoureux, Un homme qui me plait montre un cinéaste qui passe trop souvent à côté de son sujet. Et pour un film à la lisière de la récréation, on n’y retrouve même pas la fraîcheur juvénile de la mise en scène d’Une fille et des fusils, film lui aussi très léger et improvisé mais dans lequel la volonté de s’amuser était toujours perceptible. Malgré tout, de vrais moments de grâce arrivent à se glisser ici et là, qu’il s’agisse d’un Francis Lai en forme olympique (le thème du film reste l’une de ses plus belles créations), d’un célèbre dialogue sur une fausse musique de western qui fait soudain se confondre le réel et l’imaginaire, ou encore d’une scène finale pour le coup inoubliable, laquelle confirme après Vivre pour vivre qu’un plan fixe sur le regard intériorisé d’Annie Girardot vaut mille mots.
On en profite d’ailleurs de l’occasion pour lâcher une amusante hypothèse. Fan absolu du film (il avoue le visionner deux fois par an), Jean Dujardin ne l’avait-il pas précisément en tête en allant tourner son segment des Infidèles chez l’Oncle Sam, dans lequel lui et son compère Gilles Lellouche vivaient une passion soudaine et inattendue à Las Vegas entre une virée dans le désert et une biture dans un casino ? C’est bien possible… Fin de la parenthèse… Toujours est-il qu’en découvrant Un homme qui me plait, il n’est plus permis de s’interroger sur ce qui a donné envie à Jean Dujardin et Claude Lelouch de collaborer ensemble en 2015 sur Un + Une.
1970

LE VOYOU
France – 1970 – 2h00
Cela démarre par une scène de comédie musicale, avec un voyou du cinéma américain des années 30 qui tire à la mitrailleuse, entouré de jolies pépées. Sauf qu’il s’agit en réalité d’un film que regarde Jean-Louis Trintignant dans un cinéma de quartier. Mais en fait, si ce dernier est dans ce cinéma-là, c’est parce que… Stop ! Il vaut mieux ne pas en dire davantage. Parler du Voyou sans rentrer dans les détails de sa narration bluffante n’est pas une chose aisée. Disons simplement que le résultat, en plus de constituer l’un des plus beaux sommets de la carrière de Claude Lelouch, tricote les conventions du polar en se jouant habilement de ce que le spectateur peut croire ou supposer, et ce avant de retourner ses attentes comme une crêpe au travers d’une subtile volte-face temporelle. Le goût du cinéaste pour les montages trompeurs et/ou déchronologiques se vérifie au centuple dans ce film qui, une fois de plus, puise son origine dans un souvenir personnel du cinéaste. En effet, à l’époque, Lelouch était si bien établi dans le milieu du cinéma qu’il s’est retrouvé la cible d’un chantage orchestré par une bande de voyous. Il finira par sympathiser avec l’un d’eux, lequel ira même jusqu’à lui raconter une histoire risquée de kidnapping qu’il hésitait à réaliser. Lelouch saura le convaincre d’y renoncer, mais en profitera pour lui racheter l’idée afin d’écrire le scénario du premier polar de sa longue carrière.
Même en s’attaquant à un genre aussi sombre et codifié que le polar, Lelouch reste fidèle à sa fascination pour les gangsters, ce que son introduction décalée sous influence des films musicaux américains illustre à merveille. Pour autant, son regard évolue : ici dans un rôle à contre-emploi, Jean-Louis Trintignant n’a rien à voir avec les Pieds Nickelés qui faisaient les quatre cents coups dans Une fille et des fusils, et de même, Lelouch filme la voyoucratie moins comme un microcosme de violence à la Scarface que comme un domaine de faux-semblants où la réussite découle de l’aptitude à maîtriser l’art du paraître sans en révéler les signes extérieurs. De ce fait, en digne cinéaste-voyou qui prend plaisir à manipuler son spectateur, Lelouch en duplique le principe autant par son découpage (un puzzle qui ne se découvre qu’a posteriori) que par les enjeux subversifs de son scénario (en gros, voler l’argent des banques et égratigner la presse). La mécanique prend même une toute autre ampleur lorsque le cinéaste s’attarde sur des personnages à diverses facettes qu’il filme presque comme des poupées russes, en particulier ce père de famille prolo joué par Charles Denner – la scène mémorable où ce dernier subit un interrogatoire pour le moins stressant chez les policiers est particulièrement déstabilisante.
Véritable polar de contrebande qui cache remarquablement bien son jeu, Le Voyou subvertit en beauté les règles narratives du genre. Et en dépit d’un abus de placements de produits qui fait légèrement tiquer (on n’a jamais entendu autant de fois le mot « Simca » dans un film !), toute séquence est au service d’une mécanique imparable, construite et travaillée en amont. Pour une fois, Lelouch laissait de côté ses réflexions vibrantes sur la vie, le hasard et l’amour pour se couler dans un pur exercice de style où tout ce qu’il tente se solde par une réussite. Ne pas chercher quoi que ce soit de réflexif dans cette habile mécanique, mais se contenter juste d’un plaisir immédiat, celui de savourer un vrai et grand polar comme on dévorerait un bon roman à twists. Très admiratif de Lelouch à la base, Quentin Tarantino aura découvert Le Voyou tardivement, à savoir durant l’été 2013, et, lors d’une projection spéciale au Festival Lumière quelques mois plus tard, donnera son verdict : « Ce film, c’est Pulp fiction avec 25 ans d’avance ! ». Ça pour un compliment…

SMIC, SMAC, SMOC
France – 1971 – 1h30
Quelle mouche avait bien pu piquer Claude Lelouch lorsqu’il décida de réaliser Smic, Smac, Smoc ? Pourquoi un tel cinéaste, désormais confirmé auprès de la profession et reconnu à l’internationale, avait-il soudain ressenti le désir de retourner à la case départ ? En réalité, c’est très simple. Ici, tourner un film en seulement huit jours et pour un budget extrêmement faible n’avait pas pour « ambition » de rejouer le procédé conceptuel d’Une fille et des fusils, mais plutôt de tester une nouvelle caméra 16mm qui allait lui permettre, selon ses dires, de « libérer l’acteur pour filmer son inconscient et pas son savoir-faire ». Et comme faire des essais ou un court-métrage s’avère moins intéressant pour lui que de réaliser un vrai long-métrage, le cinéaste forme un casting composé de cinq de ses amis (dont son compositeur Francis Lai et son assistant Jean Collomb) et rédige un petit bout de scénario sur lequel tout le monde devra improviser durant une semaine à La Ciotat. Le carton d’introduction l’indique d’ailleurs très bien : ce n’est pas une histoire qui est racontée, mais une amitié, où Lelouch se définit comme un reporter qui souhaiterait saisir le temps qui passe à l’intérieur d’une fiction… Noble ambition…
Analyser Smic, Smac, Smoc relève de la gageure quand on voit à quel point tout, de son montage jusqu’à sa direction d’acteurs en passant par sa scénographie, tient uniquement dans un principe de cinéma-vérité, où la force du contenu ne peut prendre vie que par chance ou par accident. Là encore, le film apparaît « brouillon ». Mais c’est un brouillon qui tient la route en plus de s’avérer assez rafraîchissant d’un bout à l’autre, narrant avec simplicité les tribulations d’une bande de potes smicards confrontés au mariage – et donc au départ potentiel – de l’un d’eux. On ne saurait pas dire clairement pourquoi la recette a fonctionné, mais peut-être que les progrès considérables de Lelouch sur la direction d’acteurs et son utilisation de cette petite caméra 16mm (qui filme tout sans jamais se faire remarquer) y sont pour beaucoup. Le public, en tout cas, s’y est montré sensible et réceptif en faisant finalement de sa discrète sortie un petit succès (environ quatre cent mille entrées sur un nombre de copies très réduit). Lelouch étant de nature très superstitieuse, le fait qu’il s’agisse de son treizième long-métrage se devait sans doute d’être interprété comme un signe. À noter une petite nouveauté chez lui : un générique décalé et parlé en voix off pour interpeller le spectateur – le cinéaste réitèrera ce parti pris dans Mariage et La Belle Histoire.

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
France – 1972 – 2h00
Lorsque L’aventure c’est l’aventure est projeté en ouverture du festival de Cannes 1972, le paradoxe est total : la critique et le public hurlent tous de rire durant la projection, mais le lendemain matin, la première retourne sa veste en crachant sur le film et en n’assumant pas son rire. Dès cet instant, la rupture est consommée entre critique et public en ce qui concerne les films de Lelouch. Après avoir connu le succès pendant tant d’années, le cinéaste devient illico la tête de turc des intellos, et là, on ne peut pas dire qu’il ne l’avait pas cherché. L’origine de ce film culte le prouve : invité en 1971 à un dîner chez un ami réalisateur où étaient également conviés des journalistes des Cahiers du cinéma, Lelouch assiste à une joute entre critiques à laquelle il ne comprend strictement rien. Convaincu dans l’idée que les intellos baignent dans une contradiction permanente et que le vieil adage « Tout est politique » n’est rien d’autre qu’une fumisterie (après Mai 68, la politique servait d’alibi pour tout et n’importe quoi), le cinéaste décide d’enfoncer le clou de ce constat en filmant avec humour la confusion générale de la société. D’où cette inoubliable bande de Pieds Nickelés opportunistes, mi-crétins mi-voyous, qui se font du pognon en surfant sur les courants politiques. On espère de tout cœur que le Jean-Luc Godard ultra-politisé de l’époque n’a jamais jeté ne serait-ce qu’un petit coup d’œil à ce parangon de cynisme décomplexé – l’arrêt cardiaque n’aurait sans doute été pas loin…
Oser qualifier Lelouch de réac ou de facho sous prétexte qu’il expédiait là une violente tarte à la crème dans la tronche des tartuffes intellectuels était révélateur d’une belle connerie. La justesse du film réside au contraire dans le fait qu’il n’épargne rien ni personne, et surtout pas ses cinq antihéros. Dès cette scène provocatrice où Lino Ventura balance un cocktail-molotov dans la voiture de son fils pour le mettre en accord avec son rejet de la société de consommation, tout est dit : un esprit politisé, c’est bien joli, mais encore faut-il avoir l’honnêteté de joindre l’acte à la parole, sinon autant fermer sa gueule ! Et comme le père se contente juste après de répéter les paroles de son fils pour servir ses propres intérêts, la confusion se propage de partout. Le film se révèle d’une franchise à toute épreuve lorsqu’il révèle l’absence de franchise chez tout un chacun. Et Lelouch, encore très poil à gratter sous le vernis des apparences, n’hésite pas à forcer le trait de tous les côtés. Le tribunal républicain se résume à un étalage de démagogie hypocrite, l’opportunisme sert ici la soupe d’un Che Guevara d’opérette avant d’épouser une république bananière, les revendications hystériques du MLF sont ici parodiées dans un congrès de prostituées qui hurlent leur haine de « l’état policier polygame » et qui se définissent comme « les machines d’une usine qu’elles peuvent gérer » ! Sans oublier cette jubilatoire scène finale où les cinq compères, debout sur un podium africain, hurlent des inepties à un public qui les applaudit mécaniquement (« Vive Mao ! », « Yé oune Ferrari à vendre », « Vive la Suisse libre », « La politique c’est du show-business ! », etc…).
Extrêmement provocateur derrière sa forte drôlerie, mis en scène avec précision et sans chichis, le film doit aussi énormément à la complicité d’un casting fabuleux (Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione, Charles Gérard : une quinte flush parfaite !), que Lelouch laisse là aussi libres de se lâcher dans des scènes souvent improvisées. Certaines d’entre d’elles sont même passées à la postérité, notamment la fameuse marche-drague sur la plage que Jean Dujardin n’hésitera pas à reprendre dans une scène de Brice de Nice. En sortant là encore des sentiers intimistes qui ont fait sa réputation, Lelouch faisait mine de s’offrir une nouvelle récréation, laquelle dissimulait en fait un regard subversif qui fait encore illusion à l’heure où la politique se résume à une grosse lessiveuse d’egos et d’ambitions personnelles. Pas une ride au compteur, le plaisir de l’aventure est toujours là !

VISIONS OF EIGHT (film collectif)
Etats-Unis/France/Japon – 1973 – 1h50
Pour la deuxième fois consécutive de sa carrière, le nom de Claude Lelouch se retrouve rattaché à un documentaire sur les Jeux Olympiques, en l’occurrence ceux de Munich en 1972. Et pour la deuxième fois là aussi, le résultat – bien que récompensé par un Golden Globe – sera victime du mauvais sort : en raison des terribles événements de cette année-là (qui auront vu des terroristes de l’organisation palestinienne Septembre Noir prendre en otage et exécuter une partie de la délégation sportive israélienne), le film aura pâti d’une distribution relativement confidentielle. Comme le résultat était conçu à la base comme une captation subjective de la compétition par huit cinéastes différents (de Milos Forman à John Schlesinger en passant par Kon Ichikawa et Arthur Penn), il aura été décidé de ne jamais faire mention de cette tragédie (malgré une mention-hommage en toute fin de bobine en souvenir des sportifs israéliens assassinés). Le résultat constitue en tout cas un témoignage fascinant de l’ambiance des Jeux et de ses caractéristiques cachées, tant chez les sportifs que chez le public. Et contre toute attente, le segment réalisé par Claude Lelouch s’avère être le plus inhabituel des huit.
En effet, plutôt que de se tourner vers la puissance des athlètes (segment de Mai Zetterling) ou leur rapidité (segment de Kon Ichikawa), Claude Lelouch choisit de mettre en avant la déception de tout un chacun dans (ou face à) la compétition. Intitulé The Losers, ce chapitre démarre par le stress d’un spectateur en transe face à une compétition dont il perçoit vite qu’elle va se terminer par la défaite de son champion. Ce qui suivra ne se résumera qu’à des échecs en file indienne, que ce soit sur un ring de boxe, sur un tatami, sur une piste de cyclisme ou dans une piscine olympique. Toujours aussi obsédé par la thématique de l’échec, Lelouch filme des perdants qui subissent de plein fouet la terrible conséquence d’un effort hélas stoppé en plein élan, utilisant même parfois le ralenti moins pour répéter l’échec à des fins sensationnalistes (on ne regarde pas un bêtisier de Stade 2 !) que pour prendre le pouls de cet effort contrarié. La musique de Henry Mancini – très Philip Glass dans l’âme – épouse à merveille cette pudeur du traitement. Et c’est en terminant son chapitre sur la poignée de mains fraternelle entre deux lutteurs à la fin de leur combat que Lelouch se fait le plus digne vecteur de la célèbre phrase de Pierre de Coubertin : la victoire importe moins que la participation, et les perdants valent autant (sinon plus) que les gagnants. Là encore, le cinéaste parle indirectement de lui, souvent confronté à l’échec mais toujours gagné par la passion du geste.

LA BONNE ANNEE
France – 1973 – 1h55
Au début, on croit s’être trompé de film : des passages d’Un homme et une femme défilent à l’écran. Le titre La Bonne Année serait-il donc un clin d’œil à cette année 1966 qui aura tout changé pour Claude Lelouch ? En gros, le cinéaste se regarde-t-il le nombril en oubliant son public ? Tout faux, car le cinéaste joue encore avec nous : il s’agissait d’une projection de cinéma que le directeur d’une prison offrait à ses prisonniers pour leur souhaiter une bonne année, sauf que ceux-ci sifflent le film avec véhémence. Ce démarrage ironique ne sera pas le seul clin d’œil que Lelouch fera à son film le plus célèbre. En effet, un peu plus loin dans le récit, le braqueur Simon (Lino Ventura) se retrouve au milieu d’un dîner organisé par la belle antiquaire dont il est tombé amoureux (Françoise Fabian), où des intellectuels s’écoutent parler et le mettent presque en examen en l’interpellant sur son opinion. Or, Simon, pas snob pour un sou et très matérialiste (« La psychologie, c’est l’art de posséder les gens avant qu’ils ne vous possèdent »), n’a rien à leur répondre. Mais lorsqu’on lui demande comment il peut aller voir un film (comme, par exemple, Un homme et une femme !) sans avoir lu les critiques au préalable, sa réponse est cinglante : « Je fais comme quand je choisis une femme : je prends des risques ».
La Bonne Année doit-il donc se lire comme une vengeance personnelle, la seconde que Lelouch souhaitait exécuter après le ton subversif anti-intello de L’aventure c’est l’aventure ? Faux, puisqu’il n’y a pas de vengeance là-dedans. Juste un petit tacle que le cinéaste expédiait à ceux qui préféraient s’astiquer le poireau sous couvert d’un charabia politico-engagé (la critique d’Un homme et une femme par Jean-Louis Comolli est ici clairement citée au détour d’une phrase). Ce que raconte ici Lelouch n’est autre que la moelle épinière de son cinéma, qui plus est dans sa forme la plus digne. S’y croisent encore ses aphorismes sur la vie, son affection pour les voyous au grand cœur, sa maîtrise imparable des récits à double fond, son goût pour les coups du hasard et les couples du hasard, sa sensibilité pour les love-story impossibles, son jeu avec la couleur et le noir et blanc (l’une pour la partie séduction, l’autre pour la partie rédemption). Et au travers d’un film noir qui dévie vers la romance à teneur sociologique (ou comment un cambriolage de bijouterie va peu à peu dériver vers le braquage amoureux) au travers d’une mise en scène où cadre et découpage sont en parfaite alchimie, le cinéaste use du cinéma comme d’un redoutable outil de séduction qui parle au cœur, qui fait naître la magie de la façon dont les individus s’écoutent et se découvrent. Dit comme ça, ça a l’air tout simple, mais comme il n’y a rien de plus compliqué au cinéma que de réussir un film simple…
Qu’il soit en train de mélanger différentes natures d’images (flashbacks, images mentales, extraits de ses propres films) ou de jouer sur la confusion entre passé et présent (ici de façon plus simplifiée que dans Le Voyou), Lelouch accumule les trouvailles stylistiques, prouvant ainsi qu’émotion et expérimentation peuvent faire (très) bon ménage. Lâchons notre préférée : un saut dans le temps au travers d’un émouvant dialogue plaqué en voix off sur des cartons noirs – on saute ainsi plusieurs années en quelques secondes ! Même le thème du double trouve une place implicite dans ce film au détour de quelques piments qui illustrent la duplicité de l’artiste : Ventura déguisé en vieillard, travesti déguisé en Mireille Mathieu qui chante face à la vraie Mireille Mathieu… Enfin, une forte rumeur voulait que l’énigmatique scène finale du film ait servi d’inspiration principale à Stanley Kubrick – dont c’était l’un des films préférés – pour concevoir celle, tout aussi énigmatique, qui allait clôturer Eyes wide shut. L’anecdote sera confirmée par le cinéaste Sydney Pollack, lui aussi grand fan de La Bonne Année, qui précisera même que Kubrick avait été jusqu’à montrer le film à Tom Cruise avant le tournage.

TOUTE UNE VIE
France – 1973 – 2h30
Si les reproches faits au cinéma de Lelouch – à tort ou à raison – ont toujours été nombreux, il y en a toutefois un qui mérite que l’on s’attarde dessus : observer un cinéaste qui ressasse ses éternelles variations sur la vie, l’amour et le destin dans une forme de film choral où son ambition aura vite fait de se transformer en prétention, voire carrément en mégalomanie. Un reproche pour le coup assez justifié, et dont Toute une vie, premier stade du trop-plein d’ambition de Lelouch, fut logiquement la première cible. Pensez donc : une vaste fresque de 2h30 traversant tout le 20ème siècle pour ramener la définition de l’humain à la somme des événements – joyeux ou tragiques – qui auront composé sa vie et celle de ses aïeux. Un pari à peine casse-gueule, donc… Que le cinéaste ait visé trop haut avec un film trop gros arrivé trop tôt apparaît ici comme une évidence, tant il se casse très vite les dents sur l’élément capital de la réussite du projet : faire ressentir l’écoulement du temps et l’intra-connexion des époques par des transitions appropriées.
Sur l’idée d’explorer la causalité dans un ensemble d’intrigues rattachées par un lien cosmogonique que seul le montage réussit à incarner, il faudra attendre le Cloud Atlas des Wachowski quarante ans plus tard pour en prendre le pouls. La plupart des idées de Lelouch sont certes logiques, comme celle de faire jouer le parent et l’enfant par le même acteur, d’utiliser le personnage joué par André Dussollier pour faire un parallèle avec son propre parcours (ce dernier fait ses gammes dans la pub et le porno tout comme Lelouch a démarré dans le scopitone) ou de faire intervenir le médium ciné à des fins transitives (le film démarre sur un film muet illustrant une rencontre amoureuse grâce au cinématographe). De bonnes idées hélas noyées dans un fatras d’enjeux éparpillés et de pensées de comptoir qui joueront pour beaucoup dans le dédain qui accompagnera les futurs films de Lelouch. Outre un abus sonore de Gilbert Bécaud (ici dans son propre rôle), il faut se farcir des tautologies grotesques du genre « La vie, il faut la vivre, il ne faut pas en mourir » et même un épilogue ridicule suintant la dystopie new age. Sans parler de ce raccourci très discutable où Lelouch, pour justifier la naissance du cinéma parlant, intègre un plan de Hitler dans son montage, et se justifie en interview en disant que « sans le cinéma parlant, les discours de Hitler n’auraient pas eu la même portée ». Voilà donc un Lelouch peu mémorable, affichant mine de rien les prémices de ce film réellement mémoriel que sera Les Uns et les Autres.

MARIAGE
France – 1974 – 1h34
Parmi les films de Lelouch, Mariage n’est généralement pas le plus cité par ses défenseurs comme par ses détracteurs. À croire qu’il s’agirait d’une parenthèse à part, que l’on chercherait à passer sous silence comme s’il n’y avait rien à en tirer. Le cas est surtout assez problématique en l’état, car ce film, bien plus qu’une parenthèse, est surtout une anomalie dans sa carrière. Pour la première fois, Lelouch filme le mariage non pas comme un cocon d’amour et de bienfait, ni même comme une bulle légèrement agitée par la tentation de l’adultère, mais comme un enfer à ciel ouvert, théâtre de personnages étriqués et pathétiques qui suintent la plus rance des misanthropies. Le « crime parfait de l’amour », en somme, qui voit un homme (Rufus) et une femme (Bulle Ogier) vivre ensemble (ou plutôt, « se supporter ») pendant trente ans uniquement parce que personne ne les aime. Sorte de contre-pied total à l’idéalisme romantique de Toute une vie, le film reflète la vision noire que Lelouch avait du couple à cette époque-là (selon ses dires, il était alors au bord de la rupture) et le choix d’une colorimétrie totalement dénudée (on passe du noir et blanc au sépia) suit très clairement cette logique. On ira même jusqu’à dire que ces partis pris de mise en scène rendent l’expérience très inconfortable.
Hasard du calendrier, Ingmar Bergman tournait la même année Scènes de la vie conjugale, et la comparaison est assez fatale. Lelouch partage certes avec le génie suédois un goût évident pour la scénographie théâtrale et les longs plans-séquences, mais contrairement à lui, zappe ici l’empathie, la réflexion et l’élan vital. Pas nuancés pour un sou, ceux qu’il inscrit dans l’œil de sa caméra ne sont que des minables dont il ne fait même pas l’effort de rendre les défauts attachants. Reste l’idée savante de se concentrer sur un jour par décennie (toujours un 6 juin, de 1944 à 1974), ce qui lui permet de tenter un parallèle fort avec l’opportunisme des collabos ayant retourné leur veste à la Libération (ici, au détour d’un acte d’héroïsme dont il n’était pas acteur, le mari récupère la gloire à son propre compte). Le jeu de massacre de l’équilibre marital commence en aval de cet événement, laissant un amour naissant se noyer lentement dans un flacon de vitriol. Ainsi est fait Mariage : la guerre d’un couple en temps de paix après la paix d’un couple en temps de guerre, avec tout ce que cela suppose de haine, de rancœur, de frustration et de mauvaise foi. Avec, au final, un constat amer : mieux vaut vivre une vie pourrie à deux que tout seul. Un peu faible, quand même…

LE CHAT ET LA SOURIS
France – 1975 – 1h48
L’art des « figures libres » est une constante chez Claude Lelouch : inviter l’acteur moins à improviser qu’à tenter d’aller plus loin que le scénario. Dans Le Chat et la Souris, on en trouve de très beaux exemples, dont un resté célèbre : la fameuse scène du restaurant où Michèle Morgan, ayant trouvé un clou dans son assiette, est soudain prise d’un énorme fou rire. Sachant que Lelouch ne l’avait pas prévenue de l’existence de ce clou (c’est lui qui l’avait glissé dans son plat !), la scène épate par sa spontanéité. Mais c’est pourtant le film tout entier qui est à l’image de cette scène. De nouveau avec l’envie de s’amuser avec un récit, Lelouch réalise ici un polar qui n’en est pas vraiment un, où le récit choisit une direction qu’il s’ingénue à contredire par une multitude de digressions sentimentales. En somme, il joue au chat et à la souris avec nous, avec ses acteurs et avec son cinéma. Et surtout, il réalise ici son rêve de toujours : diriger la grande Michèle Morgan, selon lui « les plus beaux yeux du cinéma », dans un projet initialement prévu pour elle et Jean Gabin – ce dernier, hélas décédé, sera remplacé par Serge Reggiani.
Centrée sur l’enquête autour de la mort inexpliquée d’un promoteur immobilier, l’intrigue policière n’a ici aucune importance. D’ailleurs, on l’oubliera assez vite en milieu de bobine pour finir par la récupérer dans un dernier quart d’heure qui lâchera la clé de l’énigme. Tout tient ici dans le jeu de deux acteurs à contre-emploi, visiblement enjoués de la liberté offerte par la caméra de Lelouch, tous deux acquis à un jeu de séduction où l’un jauge l’autre et vice versa. La modestie sied très bien à ce petit film bizarrement construit, dont l’intérêt provient justement de sa narration déséquilibrante. Au menu des ruptures bienvenues, on pourra citer ces hallucinants travellings au ras du bitume en voiture et en moto (où Reggiani tente une série de chronométrages pour valider ou non l’alibi de Morgan) ou encore ces nombreux passages à la première personne qui invitent à épouser les perceptions des personnages. Ayant déjà utilisé ce principe dans l’une des dernières scènes de Mariage, Lelouch souhaitait à l’origine réaliser tout le film en caméra subjective pour mettre le spectateur dans le rôle de l’inspecteur. Il aura fini par renoncer à cette idée, ayant en tête que cela aurait donné un exercice de style dépourvu d’émotions – ce qui n’est pas forcément vrai. En revanche, donner le rôle le plus mémorable du film à un chien particulièrement agressif ne semble pas lui avoir fait peur !

LE BON ET LES MECHANTS
France – 1975 – 1h55
Ce fut la première fois que Lelouch s’intéressa aux petits et grands drames de l’Occupation, et ce fut peut-être aussi la plus controversée. Car aborder une période aussi sombre de l’Histoire sous la forme d’une comédie immorale dans la lignée de L’aventure c’est l’aventure (où les voyous écrasent les notions de patrie et d’idéologie sur l’autel de l’argent-roi) lui aura valu un malentendu critique assez considérable. À des années-lumière du « Tintin chez les collabos » que beaucoup ont cru voir (et on suppose donc qu’ils n’avaient rien vu du tout…), Le Bon et les Méchants s’intéresse avant tout à une lutte sans merci entre deux gangs : la « bande à Hitler » d’un côté (associé au fameux gang de Pierre Bonny et Henri Lafont), le « gang des Tractions Avant » de l’autre. Gestapistes et résistants se retrouvent donc ici non pas sur un pied d’égalité, mais plutôt dans un espace où se tissent d’insidieuses passerelles, révélant chez tout un chacun un opportunisme devenu roi ou un héroïsme remis en question.
Au vu d’une période aussi confuse où les règles n’ont plus cours, Lelouch ne pouvait que refaire appel à sa légèreté pour traiter le sujet en bonne et due forme. Mais s’il n’atteint jamais le degré de subversion sardonique du Black Book de Paul Verhoeven, son film n’en oublie pas d’être frontal dès qu’il s’agit d’illustrer les exactions des voyous collabos, qu’il s’agisse des vols ou des tortures. Shooté dans une très belle photo sépia pour coller aux actualités de l’époque, le film se veut donc réaliste sous une chape de divertissement grinçant où les bons finissent en dindons de la farce et où les méchants finissent décorés à la Libération. De ce fait, chose anormale chez Lelouch, le film appuie le manichéisme jusque dans son titre (pour le coup sans aucune ambiguïté). Fort heureusement, s’il ne fait pas dans la nuance, le cinéaste évite au moins de forcer le trait sur la caractérisation de ses personnages et prend soin de les creuser autant que possible. Le tandem formé par les deux Jacques (le désinvolte Dutronc et le rondouillard Villeret) aux côtés d’une Marlène Jobert plus pulpeuse que jamais emboîte le pas à Lelouch pour embarquer le public dans une sacrée aventure où franchir les lignes jaunes au risque de déraper devient la règle d’or narrative. En s’aventurant dans les zones les plus troubles de l’époque, à savoir celles où la valeur de l’engagement d’un côté comme de l’autre ne cessait jamais de se flouter, le cinéaste a finalement pris un risque payant et signé un film aussi juste qu’efficace, qui se redécouvre aujourd’hui comme un bon serial à l’ancienne.

SI C’ÉTAIT A REFAIRE
France – 1976 – 1h45
Ayant souvent eu la réputation d’un homme à femmes, Lelouch est avant tout un cinéaste qui a eu besoin de désirer ses acteurs et ses actrices pour pouvoir les filmer le mieux possible. Mais il arrive parfois que le blocage s’invite à la fête, souvent par accident – ce qui est encore plus gênant. Les deux collaborations du cinéaste avec la grande Catherine Deneuve restent encore aujourd’hui des déceptions qui se justifient en très grande partie pour cette seule raison. À chaque fois, un sujet potentiellement puissant, et à l’arrivée, un film qui s’abîme. Car filmer Deneuve, ce n’est pas juste filmer une actrice, c’est filmer un mythe trop beau pour ne pas être irradiant. On voit d’ici le blocage inévitable sur un drame intimiste qui se voulait le retour à la vie d’une femme sortie de prison : que ce soit dans les scènes de flashbacks précédant son séjour carcéral ou dans tout ce qui suit sa libération, l’actrice est strictement la même ! Toujours glamour, jamais éteinte, aucunement fragilisée… L’époque où Deneuve fera fissurer sa carapace glamour dans Place Vendôme de Nicole Garcia est encore bien lointaine ! Lelouch tente là encore de faire passer ce détail embêtant sous le prétexte d’un flashback dissimulé (le viol et le meurtre à l’origine du récit sont ici casés dans la continuité de la sortie de prison), mais comme on est désormais rodé à l’exercice, ça ne marche pas. La suite, hélas, ne marchera pas davantage.
C’est clairement sur la mise en scène que ce Lelouch-là montre ses limites. Le cinéaste se rattache ici à des éléments qu’il maîtrise toujours aussi bien (comme le plan en caméra subjective ou le récit grave qui se retrouve gagné par la légèreté), mais qu’il n’utilise jamais à bon escient. En même temps, il faut bien avouer qu’un tel scénario, bien qu’éloigné du pathos du récent Il y a longtemps que je t’aime de Philippe Claudel, évolue peu à peu vers une situation invraisemblable : après avoir désiré sa propre mère (Deneuve, donc) qui l’a mis au monde lors d’une passade expéditive avec un infirmier en prison, le fils finit par aller vivre avec l’amie de sa mère (Anouk Aimée, parfaite comme d’habitude) en même temps qu’il précipite sa mère dans les bras de son prof intello (Francis Huster, déjà très performant dans la démagogie pédante). Contredire à tout prix le vieil adage « On ne choisit pas sa famille » ? On est preneur, mais entamer fugacement la piste de l’inceste pour basculer ensuite dans une cellule familiale méli-mélo est d’autant plus grotesque que Lelouch n’ose pas interpénétrer les époques comme à son habitude. Du coup, le côté linéaire – voire pépère – du récit a vite fait de rendre ce dernier difficile à avaler. En fin de compte, Si c’était à refaire porte hélas trop bien son titre : voilà un film qu’il aurait fallu refaire autrement.

C’ÉTAIT UN RENDEZ-VOUS
France – 1976 – 9min
Il est étrange de constater que, si l’on met de côté Un homme et une femme, le film le plus culte de Claude Lelouch est… un court-métrage ! Qui plus est, un court-métrage où, bien qu’à nouveau mis en avant, le traitement de la rencontre amoureuse s’avère cette fois-ci bien plus surprenant. À la fin du tournage de Si c’était à refaire, Lelouch se retrouve avec environ 4000 mètres de pellicule non utilisée. Ayant envie de tourner un court-métrage, il a soudain une idée folle qui lui traverse l’esprit : tenter une traversée de Paris à très grande vitesse (entre 130 et 200 km/h !) de l’avenue Foch jusqu’à la basilique du Sacré-Cœur, au petit matin du 13 août 1976, le tout réalisé en un seul plan-séquence filmé depuis l’avant d’une Mercedes-Benz 450SEL. L’objectif ? Ne jamais s’arrêter : lancée à toute berzingue dans un Paris pas encore réveillé (il n’est même pas six heures du matin), la voiture de Lelouch grille les stops et les feux rouges, traverse les lignes blanches, esquive les piétons, fait voler les pigeons, prend certaines avenues à contre-sens et va même jusqu’à rouler carrément sur le trottoir pour contourner un camion-poubelle dans une rue à sens unique ! Tout ça pour, finalement, aboutir à une image mémorable : une jeune femme blonde (Gunilla Friden, alors compagne du cinéaste) surgit devant la voiture en montant les marches de Montmartre. Lelouch sort de la voiture et l’étreint. L’image se fige, apparition du titre : tout ceci n’était qu’un rendez-vous !
Comme le cinéaste l’aura précisé dans D’un film à l’autre, tout l’esprit de son cinéma se retrouve synthétisé dans ce furieux petit film de neuf minutes : foncer à la rencontre du public, quitte à frôler le dérapage ou l’accident, avec un niveau de sécurité quasi inexistant. Bien que terriblement polémique au vu de son tournage sans autorisation et du manque de sens civique dont elle fait constamment preuve, cette virée à 200 à l’heure continue malgré tout d’impressionner les spectateurs qui se laissent gagner par sa vitesse. Des spectateurs que l’on imagine d’ailleurs prompts à avoir envie d’écraser un frein imaginaire au détour de chaque virage de cette folle traversée. Cela dit, le plus amusant dans toute cette histoire reste sans conteste la convocation de Claude Lelouch dans le bureau du préfet de police après le tournage. Lorsque ce dernier lui dresse la liste de toutes les infractions commises pendant ces neuf minutes, le cinéaste se retrouve logiquement contraint de lui remettre son permis de conduire. Mais à peine le préfet a-t-il eu le temps de contempler son permis qu’il le lui rend avec un grand sourire. Et avec une phrase qui stupéfie Lelouch : « Mes enfants adorent votre petit film ! »

UN AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE
France – 1977 – 2h12
Suite au triomphe planétaire d’Un homme et une femme, les États-Unis ont toujours fait les yeux doux à Claude Lelouch pour l’inciter à venir y faire carrière, ce que ce dernier a toujours décliné. Un autre homme, une autre chance est pourtant la seule exception : même avec ses producteurs français de toujours derrière lui (Alexandre Mnouchkine et Georges Dancigers), la présence de capitaux américains en provenance d’United Artists offre au film un ADN américain auquel il pouvait difficilement échapper. Malgré tout en pleine possession de ses moyens et bénéficiaire du final cut, Lelouch y réalise alors un rêve personnel : tourner un western. Mais un western qu’il souhaite réaliste, centré sur les migrants européens (en l’occurrence les Français marqués par le gouvernement révolutionnaire de la Commune) qui partirent aux États-Unis dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure. Deux couples sont ici au centre des enjeux, l’un américain (James Caan et Jennifer Warren), l’autre français (Francis Huster et Geneviève Bujold), confrontés tous les deux en pleine conquête de l’Ouest à une terrible épreuve (l’épouse américaine est violée et assassinée, le photographe français est exécuté pour avoir photographié une pendaison) et voués à voir leurs membres restants se rapprocher amoureusement après avoir découvert que leurs enfants respectifs fréquentaient la même pension… Tiens, tiens… Cela ne vous rappelle rien ?
Coupons court aux suspicions : non, il ne s’agit pas d’un bête remake d’Un homme et une femme, mais d’une variation sur le même sujet – en soi intemporel – dans un contexte très différent. Le choix de la conquête de l’Ouest offrait d’ailleurs à Lelouch le cadre d’une transposition rêvée où les secondes noces auraient un impact supérieur aux premières sous l’effet du Scope et des grands espaces. Contre toute attente, le mélange des genres se révèle adéquat, cadrant souvent avec le regard romanesque d’un Michael Cimino sur La Porte du Paradis. Alors, certes, la réalisation pourtant ample de Lelouch – qui combine ici la caméra portée à un usage considérable de la grue Chapman – n’atteint jamais le génie symbolique de celle de Cimino, mais l’esprit narratif et romantique est globalement le même, qui plus est avec un scénario déconstruit où le cinéaste joue à nouveau avec le montage (il suffit de voir comment le récit nous fait prendre connaissance de la mort du photographe). Avec un scénario un peu plus resserré (certaines longueurs sont à regretter) et une bande-son un peu plus canalisée (on regrette un abus excessif de la 5ème symphonie de Beethoven !), le résultat aurait été quasi parfait. À noter quelques surprises dans le casting : d’abord la présence d’un Christopher Lloyd encore débutant dans la peau de Jesse James (nom de Zeus !), mais surtout une bande de cowboys violeurs qui inclut cette tronche mémorable de Michael Berryman, alias le sadique consanguin de La colline a des yeux de Wes Craven !

ROBERT ET ROBERT
France – 1978 – 1h46
Robert et Robert inaugure une longue période de la filmo lelouchienne où vont se succéder de façon bien plus significative les hauts et les bas, ne serait-ce qu’au niveau commercial. Celui-ci sera un succès en salle, mais on ne peut pas dire que le résultat soit des plus enthousiasmants. Un bon sujet, au départ, que Lelouch n’aura pas su traiter frontalement : deux hommes solitaires en quête de l’âme sœur (Jacques Villeret et Charles Denner) se rencontrent par hasard dans une agence matrimoniale, et entament alors une solide amitié qui les aidera à sortir de la grisaille existentielle. Simple comme bonjour. Le vrai point fort de ce scénario réside finalement là où on ne l’attendait pas, à savoir dans un décorticage assez malin des méthodes hasardeuses employées par les agences matrimoniales dans les années 70, dupant sans ménagement leur clientèle en exploitant leur naïveté et leur détresse morale. Rien de mensonger là-dedans, puisque Lelouch a joué lui-même les undercover dans ce microcosme-là, cachant son magnétophone dans les vêtements de faux clients et enregistrant ainsi un tas d’énormités qu’il a pris le soin de recracher ici telles quelles. Mais en matière de satire, ce n’est hélas pas au Lelouch de L’aventure c’est l’aventure que l’on a affaire ici.
Ce qui intéressait en priorité le cinéaste était-il cette amitié entre deux malheureux mis au ban de la société ? À vrai dire, on en doute un peu. Parce que le film, à la fois drôle et triste sans que l’on sache si c’était voulu, joue son jeu comme Charles Denner joue le sien, c’est-à-dire en en faisant toujours trop pour chercher à exister. Avec deux personnages définis d’entrée comme invivables parce que malheureux (Robert n°1 perpétuellement stressé, Robert n°2 perpétuellement déprimé), Lelouch tente de tracer une courbe mélancolique vers le haut pour évoluer peu à peu vers la lumière. Hélas, si ses acteurs sont tout à fait méritants (surtout Jacques Villeret, qui remporta ici son premier César), sa mise en scène encourage moins la compassion que la pitié. Ce « monde de petites gens » pour lequel s’attendrit le cinéaste est ici capturé à distance, faute d’une mise en scène qui aurait eu le cran de créer frontalement le contact – n’est pas Mike Leigh qui veut. Des dialogues déséquilibrés aux errances dans des endroits déprimants (on n’aurait jamais cru que les bals de célibataires étaient à ce point sinistres !), tout reste plombant au possible. Est-ce aussi parce que la chanson du générique de début – qui aurait davantage sa place sur une BO de La Boum – avait commis l’erreur de paraphraser tout le sujet du film au lieu de laisser Lelouch l’incarner sur les cent minutes qui allaient suivre ? Ou alors parce qu’en forçant la citation à Un homme et une femme dans la scène finale, Lelouch tente de faire passer en force une émotion qui semble artificielle ? Peut-être bien…

A NOUS DEUX
France – 1979 – 1h52
Lelouch n’a jamais été tendre avec ce film-là, considérant même l’avoir raté à cause de son tandem vedette. Pourtant, tout était là pour qu’il se sente une fois de plus dans ses pantoufles sur le motif du hasard amoureux : un professionnel du crime et une néophyte de l’escroquerie se retrouvent ici embarqués par la force des choses dans un road-movie qui se muera peu à peu en love-story. Mais une love-story un peu résistante par à-coups, où chacun se met à douter de la capacité à aimer. Dans la mesure où Dutronc dégageait une propension indéniable pour le je-m’en-foutisme et où Deneuve se faisait méfiante envers tout ce qui pouvait venir fissurer son aura glamour, il était programmé d’avance que confronter deux stars aussi antagonistes allait emmener les aspérités romantiques de Lelouch vers un mur. Deux acteurs qui cohabitent tant bien que mal à défaut de fusionner dans une vraie histoire d’amour, et qui, plus frustrant encore pour Lelouch, peinent à vouloir utiliser cette absence de symbiose pour révéler leurs fêlures respectives et la fragilité qui aurait pu les rapprocher. Ainsi soit-il : A nous deux ne sera donc que l’apparat d’une romance inattendue, ici esquivée par un postulat de fuite en avant à la Bonnie & Clyde qui, elle non plus, n’ira pas bien loin dans l’exaltation des sentiments et de l’aventure.
On peut comprendre la déception de Lelouch, c’est sûr. Pourtant, A nous deux est loin de tutoyer la catastrophe. Déjà parce qu’en faisant d’abord mine de concevoir une suite inavouée au Bon et les Méchants (on y retrouve le tandem Villeret-Dutronc et la déchéance du gang des Tractions Avant), le cinéaste réussit mine de rien un joli tour de passe-passe, choisissant de ne pas achever un voyage déjà entamé auparavant (et que l’on imagine d’ailleurs voué à prendre fin dans l’indifférence) pour embrayer fissa dans une autre direction où la grande histoire se met en retrait au profil de la petite. Ensuite parce que cette alchimie congelée entre Dutronc et Deneuve amène une micro-nouveauté pas désagréable chez Lelouch : chercher l’imprévisibilité narrative dans le fait de tout intérioriser et de ne rien laisser paraître sur cette cavale somme toute assez récréative. Un peu comme un voyage dans un cadre aventureux où tout le monde aurait la tête ailleurs à mesure que le paysage se dévoile. C’est évidemment un défaut. C’est aussi, en l’occurrence, une singularité d’autant plus tolérable que la chute finale se révèle ici douce-amère, à cheval entre espoir et désillusion. À noter enfin que Paul Préboist fait ici sa première apparition dans la galaxie lelouchienne, en y campant un vieux bouseux qui exprime son mépris des femmes dans de longs monologues. Sachant que Préboist sera plus tard le véhicule philosophico-verbal du propos de La Belle Histoire et d’Il y a des jours… et des lunes, le détail est plutôt croustillant.
1980

LES UNS ET LES AUTRES
France – 1981 – 3h04
À vrai dire, on ne sait pas trop pour quelle raison Claude Lelouch avait cru réaliser là son dernier film. Était-ce réellement à cause de l’échec d’A nous deux, lequel avait fini dans l’indifférence générale en clôture du festival de Cannes ? Ou était-ce plutôt parce que ce nouveau projet était pour lui le plus personnel de tous, du moins à cette époque ? Quoi qu’il en soit, le cinéaste l’avait bien dit : « J’ai décidé de miser mes derniers jetons sur Les Uns et les Autres. Ce serait le fiasco définitif ou le jackpot, mon chant du cygne ou la résurrection ». À l’arrivée, une saga musicale massive de trois heures qui creusa davantage le fossé entre une critique qui ricanait à loisir et un public qui applaudissait à tout rompre. Lelouch, en tout cas, ne s’était pas trompé cette fois-ci : il voulait réaliser le plus beau des testaments cinématographiques, il aura finalement réussi un feu d’artifices permanent qui, au-delà de l’avoir relancé à pleine puissance sur la voie du succès, aura su transformer le monde, sa mémoire et son Histoire en un tourbillon de destins foisonnants et déchirants. Un film choral et mémoriel qui englobait tout, en somme, mais sans jamais suinter le pensum mégalo ni même se perdre dans de folles envolées métaphysiques. Parce que le héros du film restait avant tout la musique, outil diabolique qui se vit au lieu de s’analyser, dessinant de façon implicite les transitions entre les époques et constituant avant tout le plus euphorisant des guides.
Résumant tous ses précédents films et préfigurant de manière certaine ceux à venir, Les Uns et les Autres ne se limite heureusement pas à un bête condensé des obsessions de Lelouch. Il s’agit aussi du regard d’un artiste sur les époques qu’il aura traversé, décryptées au travers du prisme de sa propre vie et de sa sensibilité musicale, ce que l’on repère ici très facilement au détour de quelques scènes. Ce vertigineux travelling vertical et circulaire dans un escalier en spirale, en hommage à Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov – le film qui aura tout déclenché. Cette scène d’anthologie dans une gare à la Libération qui saisit dans la continuité d’un unique plan-séquence un retour (celui des rescapés) et un départ (celui des vaincus humiliés) – une période que le cinéaste aura vécu en direct. Ces parenthèses musicales sous forme de scopitones (ici avec Nicole Croisille), que Lelouch aura enchaînés au début de sa carrière. Ou, plus généralement, cet usage de la musique et de la danse à des fins transitives, où la puissance lyrique des deux fait se rejoindre les uns et les autres dans un même ballet, qu’ils soient séparés par des décennies ou par des frontières. Tout y est : la mémoire du monde, la brutalité de la guerre, la célébration de l’amour, la musique, la danse et le cinéma, tout ça compilé dans une intrigue-fleuve d’une lisibilité parfaite où tout, des destins aux personnages en passant par les coups de théâtre, est multiplié par trois.
Comme il l’avait déjà fait dans l’inégal Toute une vie, Lelouch réitère ici sa technique d’emploi des mêmes acteurs pour incarner les pères et les fils – on perçoit déjà là sa croyance naïve envers l’idée de la réincarnation qui fera bientôt le sel polémique de La Belle Histoire. Le procédé peut donner l’impression d’éparpiller un peu les sous-intrigues, mais là encore, c’est toute la science d’un montage précis et virevoltant qui guide le regard sans le perdre d’une époque à l’autre. Alors, certes, sur la célébration ultime de l’art comme passerelle joyeuse et tragique entre différents destins, Lelouch donne un peu l’impression d’arriver après la bataille : bien qu’axés davantage sur l’équilibre fragile entre la vie et la représentation, les Enfants du Paradis de Marcel Carné ne font hélas qu’une bouchée des trois heures des Uns et les Autres. Mais l’ambition n’est jamais la même : Lelouch vise avant tout le spectacle pur, lyrique, en funambule casse-cou sur le fil du hasard. Au final, la chute est constamment évitée. Par la grâce d’une musique écrite en amont qui se cale sur des images rêvées en amont, Lelouch réussit tout ce qu’il entreprend, place Francis Lai et Michel Legrand (ici associés) sur un piédestal, magnifie le travail chorégraphique de Maurice Béjart, et signe le plus beau climax de sa carrière avec cet inoubliable ballet mémoriel sur l’esplanade du Trocadéro, lequel réunit toutes les intrigues et tous les personnages (dont Sharon Stone dans son tout premier rôle !) sur fond du magnifique Boléro de Ravel. Des feux d’artifices de partout, plein les yeux, plein les oreilles.

EDITH ET MARCEL
France – 1983 – 2h42
La forte admiration de Lelouch pour Edith Piaf ne date pas d’hier. Il faut remonter à l’époque du Propre de l’homme, en ce jour de l’année 1960 où Lelouch, gêné par une voiture qui l’empêchait de tourner un plan devant les Galeries Lafayette, s’en alla alerter le conducteur et tomba nez à nez avec la chanteuse. S’en suivra un dialogue où Piaf racontera à Lelouch – lui-même fan de boxe – son histoire amoureuse avec le boxeur Marcel Cerdan. Une idée de film germera illico dans la tête du cinéaste et mûrira jusqu’à cette année 1983 où, auréolé du triomphe planétaire des Uns et les Autres, il se sent enfin capable de réaliser son rêve. Un rêve qui, on s’en souvient, bifurqua brutalement vers la tragédie totale en raison du suicide inexpliqué de Patrick Dewaere, que Lelouch avait choisi pour incarner Marcel Cerdan. Et la tragédie se prolongera ensuite par le cuisant échec commercial d’un film malmené autant par la critique que par les médias. Sans parler du fait qu’aujourd’hui, l’existence d’un film internationalement célébré comme La Môme aura fini par reléguer au placard les précédentes tentatives d’adaptation du mythe Piaf sur grand écran – celle-ci en particulier.
La comparaison avec le film d’Olivier Dahan sera facile à expédier : là où Marion Cotillard écrasera de son génie absolu une narration-puzzle totalement incompréhensible, le film de Claude Lelouch visait de son côté la clarté absolue au détriment du lyrisme des chansons et des sentiments. On ne sait pas quelle était au final l’option la plus judicieuse, mais une chose est certaine : Lelouch était déjà suffisamment calé sur la direction d’acteurs et la reconstitution historique pour qu’un tel classicisme – certes non dénué de certains éclairs d’inventivité visuelle – puisse susciter une quelconque satisfaction. Il est donc bien logique qu’Edith et Marcel ait été un échec : le film ne décolle jamais. Les bonnes idées ne sont pourtant pas en manque : ouverture marquante qui rassemblent les proches de Piaf dans un état de stress reflété par l’usage du plan-séquence, montage parallèle entre une scène de Piaf et un combat réussi de Cerdan (deux entrées de scène qui se soldent par des triomphes), ironie amusante d’une Piaf qui évoque Dieu comme « quelque chose qui tourne autour de moi, qui me protège » (à ce moment-là, Lelouch – compagnon d’Evelyne Bouix à l’époque – fait tourner sa caméra autour d’elle !), précision monomaniaque de la reconstitution d’époque. Mais la mécanique du mélodrame a tôt fait de se gripper par la faute d’un choix narratif qui reste encore aujourd’hui de l’ordre du mystère.
Pourquoi diable Lelouch s’est-il senti investi de la nécessité de plaquer sur cette romance tragique entre Piaf et Cerdan une histoire parallèle, elle aussi romantique, entre un sosie de Piaf et un prisonnier de guerre (joué par Jacques Villeret) ? Dans la mesure où les deux femmes – un double rôle casse-gueule pour Evelyne Bouix – installent une sorte d’effet-miroir entre les tragédies de la vie de Piaf et celles relatives à l’Histoire, le cinéaste voulait sans doute illustrer la fragilité d’une romance par un parallèle culotté. Mais à condition que l’équilibre entre les deux strates narratives soit bon, ce qui n’est hélas jamais le cas. D’abord indépendantes par la force des choses, les deux intrigues finissent par se déséquilibrer lorsque Piaf rencontre Cerdan – cette histoire prend le dessus sur l’autre. De ce fait, le film n’a plus rien à offrir qu’une direction narrative pour le moins erratique, que l’on suit alors en se tournant un peu les pouces. Côté casting, si l’on met de côté un Francis Huster décidément indécrottable en matière d’hystérie (il mériterait un sévère entartage pour avoir à ce point massacré Cyrano de Bergerac !), on ne peut pas dire que les efforts pourtant méritants d’Evelyne Bouix et de Marcel Cerdan Jr (qui remplaça Dewaere au pied levé) soient à la hauteur des attentes : la première singe Piaf sans jamais réussir à l’incarner, et le second se contente de ressembler à son père. Ni plus ni moins. Dommage, on attendait plus.

VIVA LA VIE
France – 1984 – 1h50
Le terrible échec d’Edith et Marcel aura fini par mettre Lelouch KO. Voyant tout en noir, le cinéaste se persuada alors que le soleil finirait par ne plus se lever au-dessus de lui. D’où l’idée assez dingue de Viva la vie, sans doute l’un de ses films les plus polémiques. À première vue, le cinéaste se frottait ici à un genre encore inexploré chez lui : la science-fiction à teneur paranoïaque. Évidemment, on aurait dû s’en douter, une SF lelouchienne n’a rien à voir avec des histoires de petits hommes verts ni même avec une fable fantastique sous influence de Steven Spielberg. À vrai dire, si l’on pense souvent à Rencontres du troisième type en raison de son point de départ, le résultat évoque plutôt un épisode de X-Files revu et corrigé à la sauce Lelouch sur l’amour, le hasard, la vérité, le mensonge et la manipulation, le tout dans un récit à triple fond de tiroir qui cache remarquablement bien son jeu. On vous résume le pitch ? Ici, grosso modo, un chef d’entreprise (Michel Piccoli) et une jeune comédienne (Evelyne Bouix) ne se connaissent pas, et pourtant, tous les deux vont mystérieusement disparaître le même jour à la même heure… avant de réapparaître trois jours plus tard au même moment, comme si rien ne s’était passé ! Ce très étrange événement se reproduira peu de temps après, laissant psychiatres et médecins dans le flou total. Et un beau matin, un autre événement incroyable se produit : une journée entière dans la nuit. Que se passe-t-il ?
Bien malin sera celui qui réussira à deviner la clé finale de l’énigme, lâchée au terme d’une suite de twists que les détracteurs de Lelouch auront tôt fait de résumer à un prêchi-prêcha un peu bêbête sur le danger nucléaire et la nécessité de sauvegarder la paix planétaire. Chez Spielberg, une telle idée passerait comme une lettre à la poste en raison de la faculté d’émerveillement déployée par la mise en scène, mais chez Lelouch, la démonstration est plus terre-à-terre, pour ne pas dire plus niaise. On pourrait donc déchanter, mais lire le film sous l’angle exclusif de la science-fiction revient à tomber dans un piège : comme dirait l’autre, la vérité est ailleurs… Sans déflorer le virage à 180° pris par le scénario en bout de parcours, on se contentera de dire que le véritable sujet de Viva la vie est le pouvoir du rêve, donc le pouvoir du cinéma par extension. Dans ce gigantesque trompe-l’œil qui enchaîne différents niveaux d’interprétation (un adultère, un complot mondial, un rêve) pour résoudre une énigme narrative, Lelouch transforme chaque nouvelle hypothèse de récit (espionnage, extraterrestres, épidémie, catastrophe nucléaire…) en machine à théoriser et à réfléchir sur le cinéma et le destin. Avec le rêve qui sert autant d’arme anti-déterministe que de passerelle implicite entre la vie et le théâtre (les personnages en viennent à redistribuer leurs propres rôles). Ce jeu de miroirs permanent entre le rationnel et l’irrationnel aurait pu nous faire friser l’indigestion, mais le piège fonctionne à fond, façonnant au final une fable d’anticipation au sens premier du terme – le verbe « anticiper » sert ici de motif narratif dissimulé. D’autant plus fort que l’intemporalité du film encourage à des visions répétées.
Toujours prompt à jouer avec sa propre image de démiurge, Lelouch avait franchi une nouvelle étape avec Viva la vie. Avant la sortie du film, rien n’avait filtré, si ce n’est une bande-annonce assez osée dans laquelle il affirmait son désir de ne rien offrir en amont au spectateur afin de garder intact son goût de la surprise. Dès le début du film, outre une oppressante scène de panique digne d’une bonne fable post-apo, le cinéaste va même jusqu’à intervenir dans un simulacre d’émission radiophonique avec Martin Lamotte pour dire aux spectateurs de ne pas révéler la fin, suivi par Didier Barbelivien (compositeur de la BO) qui nous vante les bons chiffres du disque avant même la sortie du film ! Super-mégalo, le Lelouch ? Pas vraiment : on le sent surtout désireux de s’amuser avec nous comme avec lui-même, usant de la mise en abyme pour mieux se raccorder avec la manipulation qu’il a lui-même élaboré. Il y a ici une réplique de Jean-Louis Trintignant que l’on garde ici en mémoire : « Spielberg raconte des histoires, Fellini refuse de les raconter et Godard explique comment on les raconte ». Ne plus savoir dans laquelle de ces trois catégories on devrait caser Lelouch est l’ultime coup de génie de ce film mal-aimé. En brouillant les cartes, le cinéaste rend sa stratégie de plus en plus fascinante à décrypter, au risque d’en laisser quelques-uns sur le bord de la route.

PARTIR, REVENIR
France – 1985 – 2h00
… faudrait choisir ! Oui, bon, celle-là, elle était un peu facile, on l’admet… Mais en même temps, on a toutes les raisons de penser que Lelouch tentait ici davantage une redite qu’autre chose. Toujours lancé à plein régime sur la voie gagnante du cinéma choral, le cinéaste visait ici large : une fresque polyphonique où la musique – en l’occurrence le concerto pour piano de Serguei Rachmaninov revisité par Michel Legrand – serait la colonne vertébrale d’une vaste superposition des époques, d’une narration éclatée et dépourvue d’un maximum de dialogues. Sauf que ce film-là, Lelouch l’avait déjà réalisé avant : il s’appelle Les Uns et les Autres. Alors à quoi bon partir si c’était pour revenir ? Tout simplement parce qu’une fois de plus, le cinéaste casse nos premières appréhensions avec un film qui intègre une solide part d’inédit. Au premier abord, on pense avoir affaire à un autre film sur l’Occupation, et plus précisément sur la délation : une famille juive recueillie chez des amis dans un petit château, puis soudainement déportée à la suite d’une dénonciation, ce qui engendre du même coup une série de suspicions au sein d’un village (à noter que Lelouch y fera logiquement un petit clin d’œil au Corbeau d’Henri-Georges Clouzot). Et on s’en doute bien, le cinéaste ne s’est pas privé d’y injecter beaucoup de son propre vécu d’enfant juif sous l’Occupation, ayant dû autrefois fuir avec sa famille après que celle-ci ait été dénoncée à la Gestapo.
Mais voilà, au-delà d’un récit très personnel où les rêves et les cauchemars du jeune Claude Lelouch reprennent vie à l’écran apparait très vite un autre parti pris qui transcende tout. À l’image de ce que tentera longtemps après (et de façon bien maladroite !) le cinéaste Tran Anh Hung avec Eternité, Lelouch vise ici la déstructuration intégrale du récit au profit d’une émotion et d’un découpage entièrement guidés par la musique. Comprenons par là que, si l’on suit le film en se contentant des images sans prêter attention à la bande-son, ressembler toutes les pièces de cette intrigue-puzzle relève de la gageure. Mais si on se laisse absorber par la musique en oubliant la place laissée aux dialogues (ici plutôt rares), la vérité se fait éclatante : cette rythmique narrative, aussi inhabituelle soit-elle, intensifie les émotions vécues et tend même à abolir le schéma manichéen en replaçant tous les personnages sur un pied d’égalité face à la cruauté du destin. En fin de compte, plus le film bannit les repères temporels, plus il incite le spectateur à le conjuguer à n’importe quel temps (le cinéaste y évoque enfin frontalement sa croyance mystique dans la réincarnation). La seule petite maladresse aura été de démarrer l’intrigue par l’émission Apostrophes de Bernard Pivot (avec BHL sur le plateau !) où l’héroïne survivante annonce ses souhaits de casting pour l’adaptation de son livre par Claude Lelouch – un effet de mise en abyme qui tombe lamentablement à plat. Une maladresse, oui, mais une toute petite.

UN HOMME ET UNE FEMME : VINGT ANS DEJA
France – 1986 – 1h48
En général, Claude Lelouch et les suites, c’est un couple qui ne marche pas – remember Les grands moments. Cela dit, le cas de Vingt ans déjà est très intéressant : on avait quitté autrefois Anne Gauthier (Anouk Aimée) et Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant) sur une étreinte en pleine Gare Saint-Lazare, alors pourquoi ne pas extrapoler ce que ce couple mythique serait devenu depuis tout ce temps ? Le tout était de savoir comment s’y prendre. Sans surprise, Lelouch aura tout fait une fois de plus pour déstabiliser son public. Là où Un homme est une femme était d’une simplicité narrative assez évidente, Vingt ans déjà sera complexe, gigogne, carrément surchargé de toutes parts. Suite logique ? Remake détourné ? Variation nostalgique ? Mise en abyme pirandellienne ? Disons un melting-pot de tout ça, auquel viennent se rajouter plein d’autres ingrédients qui ont tôt fait de rendre le menu indigeste. A bien y réfléchir, et histoire de faire corps avec les intentions initiales d’un Lelouch qui a finalement voulu faire trop compliqué, on se serait volontiers contenté de revoir ces deux ex-amants faire le bilan d’une histoire d’amour qui n’a finalement pas eu lieu, revenir sur leurs parcours respectifs durant tout ce temps (il n’est plus pilote et habite sur une péniche, elle est une productrice de films qui enchaîne les flops), peut-être avec un zeste de mise en abyme pour faire réfléchir (sur) la nostalgie – Anne veut produire un film sur sa romance passée avec Jean-Louis.
Hélas, comme le cinéaste vient d’enchaîner des films choraux assimilables à des tourbillons narratifs et émotionnels, le coffre de sa nouvelle voiture s’avère ici tellement bondé qu’on n’arrive même plus à le fermer. Viennent donc se greffer sur ce scénario gigogne un survival sur les dunes du Paris-Dakar, une comédie musicale avec Richard Berry (chanter chez Jacques Demy ne lui a donc pas suffi…), un polar sur un criminel sexuel évadé de l’asile, du name dropping en cascade, des gens connus qui sont là juste pour montrer qu’ils sont là (PPDA, Gérard Oury, Michèle Morgan, Bernard Pivot, Thierry Sabine et même le critique Henry Chapier !) et tout un tas d’autres trucs qui auraient gagné à rester chacun dans un tiroir pour un autre film. Le frisson ne survient ici que dans une scène précise, par ailleurs celle que tout le monde attendait : les retrouvailles du couple mythique dans un restaurant de Turin, shootées dans un décor unique à deux caméras, sans effet de style, où se ressent là encore le goût de Lelouch pour l’improvisation des acteurs sur une situation donnée. L’émotion s’y fait hésitante, maladroite, donc vraie et séduisante par la force des choses. Elle ne l’est en revanche plus du tout lorsque Lelouch ressasse sa théorie – désormais un peu rassie – sur la fusion perpétuelle de la vie et du cinéma (parce que l’un est l’autre, et vice-versa, et blablabla, et chabadabada…). Son traditionnel montage éclaté n’aide pas non plus à corriger le tir : cette enfilade de scènes en puzzle ne réussit qu’à nous égarer davantage dans un vaste désert émotionnel.
Souvent chez Lelouch, il suffit d’une réplique entendue dans une scène pour juger la cohérence et/ou la direction générale d’un de ses films. Dans le cas de Vingt ans déjà, c’est à mi-parcours que le jeu s’arrête, au moment où le personnage joué par Evelyne Bouix donne son verdict sur la comédie musicale inspirée de l’histoire d’Anne et Jean-Louis : « Une histoire simple, il faut que ça reste simple ». On le voit bien : dans l’intrigue du film, faire un film sur cette love-story en la couplant à un ton qui ne lui correspond pas est synonyme de perte de repères. On s’en doutait même un peu dès le début du générique, où le thème culte de Francis Lai se voyait revisité à la sauce rock de bas étage (on aurait cru entendre du sous-Eric Serra). Sans que l’on sache s’il s’était rendu compte un peu tard de son erreur, Lelouch en est arrivé malgré tout à inclure lui-même son aveu d’échec dans son film, nous laissant ainsi avec une grosse moitié de scénario (située en grande partie dans un désert… comme par hasard !) à se tourner les pouces en attendant que le récit prenne fin. Tant d’ambitions folles pour un film qui n’avait au final qu’à nous démontrer qu’il n’aurait jamais dû exister ? C’est à croire que le foutage de gueule, lui aussi, peut être une poupée russe.

ATTENTION BANDITS !
France – 1987 – 1h44
Nouvel échec, donc nouveau rappel d’ascenseur pour rebondir… Le bide prévisible de Vingt ans déjà contraint vite Lelouch à faire profil bas pour son nouveau film. Cette fois-ci, pas de récit choral et déstructuré, pas de thématiques à la lisière du hors-sujet, pas de considérations gigognes sur la vie et le cinéma. Attention bandits ! sera un polar à l’ancienne, carré et linéaire du début à la fin, du genre à ne pas casser trois pattes à un canard, avec juste ce qu’il faut de rebondissements et de figures libres. Lelouch tente cela dit quelque chose d’inhabituel avec ce film : on le savait attaché aux Pieds Nickelés et aux voyous au grand cœur (qu’il avait filmés jusqu’ici avec un art consommé du romanesque), mais pas aux truands professionnels qui n’hésitent pas à revendiquer leur caractère négatif (« Il n’y a pas de gentils bandits », dira ici Jean Yanne à sa fille) ou à abattre les salauds qui leur causent des ennuis. En cela, la simplicité du récit et la modestie de la mise en scène se révèlent adéquats avec la volonté de jouer cartes sur table et de ne rien cacher de quoi que ce soit.
Pour autant, Lelouch n’en oublie pas sa sensibilité pour le thème de la filiation : si cette histoire d’un tandem de truands (Jean Yanne et Patrick Bruel) cherchant à se venger de ceux qui ont tué la femme du premier constitue bel et bien la colonne vertébrale du récit, on sent bien que l’intérêt de Lelouch tangue clairement en direction des retrouvailles entre un père bandit et sa fille princesse (jouée par Marie-Sophie L., à l’époque nouvelle épouse du cinéaste). Le simple fait d’apprendre que Lelouch aurait rêvé de Jean Gabin pour incarner le personnage de Jean Yanne (ce dernier en est presque ici un double réactualisé) donne un indice supplémentaire sur sa modeste ambition : rendre hommage au cinéma des années 50, dans la lignée du très culte Touchez pas au grisbi. D’une certaine manière, on a peut-être ici affaire au moins lelouchien de ses films, pour ne pas dire à une catégorie de polars dans laquelle Alain Delon ou Alain Corneau ont eu l’habitude de trouver chaussure à leur pied. Mais comme Lelouch maîtrise sa ligne narrative aussi bien que l’art du divertissement, ce petit casse sans grand relief s’avère être au final une bonne affaire pour tâcher de se relancer. D’autant que, on le répète, le polar est ici un prétexte pour se concentrer sur l’humain, sans jamais abuser des larmes ou de la violence. Un calcul plutôt bon en fin de compte, puisque le film sera un joli succès en salle. Et pourtant, au fond de lui, Lelouch commence à douter, à s’interroger… Le film suivant allait être déterminant…

ITINERAIRE D’UN ENFANT GATE
France – 1988 – 2h05
L’enfant gâté du titre, c’est évidemment Claude Lelouch. Quelqu’un qui, assailli par la terrible crise de la cinquantaine, en vient à se lasser de toutes les bonnes choses que la vie lui a apportées. Alors en pleine désarroi suite à une accumulation de soucis qui le coupent de la tranquillité, Lelouch se réveille un matin avec un énorme coup de blues. Que faire ? Tout larguer, couper les ponts, disparaître de la circulation, partir sans revenir. Presque un suicide déguisé en fuite qui, heureusement, ne durera que quelques heures. C’est peu dire que ce processus créatif rejoint en tous points celui d’Un homme et une femme : une crise engendre une fuite, un imprévu stoppe la fuite, et le cinéaste fait marche arrière avec une excellente idée de film dans la tête. Que Lelouch puisse être à son plus haut degré d’inspiration lorsqu’il est au creux de la vague est devenu une réalité, et Itinéraire d’un enfant gâté le prouve en dessinant en creux l’autoportrait d’un artiste qui essaie de faire le point par voie détournée. Avec un alter ego de rêve : Jean-Paul Belmondo, toujours bankable mais fragilisé par une série de revers commerciaux qui le placent à peu près dans le même désarroi que Lelouch. Le défi est lancé : un tournage aux quatre coins du globe, histoire de saisir cet instant imperceptible où l’être humain, à force d’être habitué à tout et d’avoir sensiblement tout vécu, se laisse tenter par la fuite avant de recevoir le signal d’alerte. Défi délicat à relever, mais payant à tous les niveaux – le succès sera plus qu’au rendez-vous.
La force du film tient là encore à une question d’alchimie surnaturelle entre différents paramètres. Le jeu de Belmondo d’abord, qui fait table rase de sa dimension de cascadeur casse-cou pour embrasser enfin un puissant rôle de composition qui lui vaudra son premier César – l’acteur a-t-il un jour trouvé un meilleur rôle que celui-là ? Le jeu de Richard Anconina aussi, tenant tête à un Belmondo pourtant tenace dans une scène désormais passée à la postérité (celle où ce dernier lui apprend à dire bonjour et à ne jamais paraître étonné). L’incroyable force lyrique du thème central de Francis Lai – peut-être sa plus belle création – qui donne de sacrés frissons dans un prologue rythmique parcourant toute une vie d’artiste jusqu’à l’accident fatal. La caméra virtuose d’un Lelouch en état de grâce qui cale son découpage sur l’apprivoisement des décors visités : virevoltante sous un chapiteau, planante au-dessus des chutes Victoria, patiente dans les atolls de Polynésie, tangente dans les eaux agitées de l’Atlantique. Le regard serein d’un cinéaste qui ose enfin affronter la vie en face, avec ses bons et ses mauvais moments, sans chercher à tout prix les premiers et dénigrer les seconds. Pour lui comme pour son acteur vedette, Itinéraire d’un enfant gâté avait tout du trajet à risque, mais il fallait à tout prix en passer par là, contournant les écueils du récit psychanalytique pour au contraire communier à nouveau avec le monde et rompre ainsi le blues du businessman. Le voyage en valait vraiment la peine.
1990

IL Y A DES JOURS… ET DES LUNES
France – 1990 – 1h53
S’il fallait ne garder qu’un seul film capable de résumer le plus simplement possible ce qu’il est convenu d’appeler la « mécanique lelouchienne », nul doute qu’Il y a des jours… et des lunes conviendrait à merveille. Ce n’est certes pas la première fois que Lelouch tente une nouvelle variation sur le thème de la fatalité, avec tout ce que cela comporte de hasards et de sous-intrigues superposées, mais c’est peut-être avec ce film-là qu’il s’essaie à une approche frontale de ce thème, qui plus est à partir d’un angle de lecture tout à fait adapté : le passage à l’heure d’été. Cette nuit de Mars où, forcés de rattraper une heure de leur vie, les êtres humains rentrent dans une mécanique de décalage qui les rend surexcités et propices à de multiples quiproquos. Ajoutez à cela un fond très marqué par la superstition – l’un des crédos favoris de Lelouch – qui fait combiner cette journée plus courte avec une journée de pleine lune, et le tour est joué. Attisant les sentiments et défiant la raison, l’image de cette lune ronde hante donc le découpage du récit à intervalles réguliers, comme pour réguler cette toile de destins qui avancent sans s’en rendre compte vers l’inéluctable. Lelouch met d’ailleurs cartes sur table dès le début. En effet, juste après un excellent monologue de Paul Préboist sur la symbolique lunaire, le cinéaste prend la parole en voix off pour nous alerter : à la fin de ce film choral, l’un des personnages mourra sous nos yeux.
Au premier plan, l’idée consiste à deviner qui finira agonisant dans la dernière scène – cet enjeu est celui qui guide la narration. Mais au second plan, l’ambition du film se révèle toute autre : relier l’individuel et le collectif en vue de décrire en profondeur une humanité qui s’enferme dans un gros pétage de plombs généralisé. Ce jour-là, tout se détraque : un camionneur perd son emploi et son épouse, un restaurateur et sa femme décident de leur rupture à pile ou face, un retraité marie sa fille, une hôtesse de l’air laisse tomber son mari pianiste et son amant chirurgien, un prêtre gay se lance dans le théâtre, etc… Pour paraphraser le titre d’un célèbre film de Luigi Comencini, on se retrouve ici face à un grand embouteillage de genres où tout se télescope d’une scène à l’autre : polar, burlesque, comédie musicale, drame conjugal… L’effet de surprise guide la narration par un découpage avant tout musical. Cela dit, autant on apprécie ici l’usage de la musique comme figure omnisciente qui semble influer sur l’action à force de l’accompagner (plan mémorable d’un pianiste qui semble jouer sur la lentille de la caméra !), autant cet usage se fait plus erratique lorsqu’il ressasse des motifs lelouchiens déjà bien usités (on finit par en avoir un sadoul des génériques chantés par Nicole Croisille !) ou lorsqu’il frise le ridicule dans de rares scènes (quid de cette comédie musicale dans un restoroute ?). Pour autant, ces légères imperfections se noient dans un bain choral qui, contre toute attente, fait rejaillir la violence des caractères – surtout celui de Gérard Lanvin – au détriment d’une bienveillance que l’on perçoit pourtant dans chaque strate de la mise en scène – on est quand même dans un film de Lelouch !
S’il ne mange évidemment pas du même pain subversif que Joel Schumacher sur Chute libre, le cinéaste reprend mine de rien cette vision d’un infiniment petit piégé par un infiniment grand qui se joue de lui, avec la lune et le décalage horaire pour jouer les agitateurs vicelards. On a beau avoir fini par saisir la bienveillance de Lelouch pour tous ceux qui viennent s’imprimer dans l’œil de sa caméra, on ne le savait pas aussi prompt à ne pas ménager qui que ce soit, surtout quand la lâcheté de tout un chacun devient le grain de sable qui fait dérailler la machine humaine. Il y a une scène du film qui résume tout cela : un conducteur joué par Jean-Claude Dreyfus s’excuse d’avoir causé un accident sur l’autoroute, avant de nier soudain sa responsabilité face aux gendarmes lorsqu’il découvre que le couple accidenté est mort. Quant à cette fin collective qui stoppe net le battement d’ailes du papillon, il est amusant d’y lire de façon très claire un clin d’œil au film suivant du réalisateur – ne pas oublier que ce dernier fait chaque film en réaction au précédent. Il y a des jours comme ça, où la tragique histoire finit, au moment de sa chute finale, par annoncer La Belle Histoire…

LA BELLE HISTOIRE
France – 1992 – 3h23
Dans un sens, La Belle Histoire est bel et bien le film de Claude Lelouch que l’on appréhendait le plus en se lançant dans cette rétrospective. Non pas parce qu’il s’agit du plus long de ses films (et donc, éventuellement, du plus fourni), mais parce qu’on savait d’avance à quel point en faire une analyse fouillée allait ressembler à un calvaire. Existe-t-il film plus polémique que celui-là dans la filmo du cinéaste ? Non, sans doute pas. Jusqu’à présent, Lelouch a toujours su nous faire avaler ses théories naïves sur l’amour et le destin par un alliage savant de la mise en scène et de la narration éclatée. Mais là, ça coince sévère. En étant aussi fermement arrimé à son intime conviction sur la réincarnation, au point de vouloir passer cette fois-ci de la théorie à la pratique, le cinéaste ose un pari de cinéma mystique des plus ambitieux et des plus risqués. Sauf qu’approcher le divin par des voies cinématographiques nécessite un angle avant tout sensoriel et symbolique, à l’image de ce que des cinéastes comme Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman et Bruno Dumont ont su démontrer. On n’est donc pas surpris du résultat : utilisant à nouveau Paul Préboist comme porte-parole d’une idée cette fois-ci plus grotesque qu’autre chose, Lelouch se fait lourdement professoral, prêchant l’amour et l’éducation spirituelle à la manière d’un vieux gourou aussi mégalo que siphonné.
Histoire que les néophytes ne tombent pas dans le panneau, démystifions un peu les choses : cette légende des abeilles d’Israël est une invention de Lelouch – on croise encore dans certains dîners de cons des spectateurs qui se sont fait avoir. On vous résume le principe : le jour de sa crucifixion, ces abeilles seraient venues butiner le sang du Christ pour en extraire le nectar de sa bonté à travers le miel, offrant ainsi l’immortalité à tous ceux qui viendraient déguster ce miel ! Au rayon du ridicule, le pitch envoie déjà du (très) lourd. C’est donc au travers de deux époques mises en parallèle que cette théorie sur la réincarnation est censée converger vers une vérité supposément indéniable. Sauf que Lelouch rabaisse l’impact de son éclatement narratif en visant le simplisme pur et dur. Par exemple, il ne suffit pas de filmer la rencontre de deux personnages à deux époques différentes (l’Antiquité et les années 90) et qui se disent dans la seconde époque « J’ai l’impression qu’on s’est déjà rencontrés… » pour faire passer cette idée de la réincarnation comme une lettre à la poste. Il en est de même lorsque Marie-Sophie L. escalade une falaise : faire se rejoindre son ascension avec celle que son aïeule de l’Antiquité avait autrefois pratiqué pour récupérer les abeilles d’Israël illustre une idée sans l’incarner ni la démontrer. D’autant que le discours supplante ici le pouvoir de l’image au vu d’un prêchi-prêcha plus sentencieux tu meurs : « C’est notre inconscient qui nous dicte notre mémoire, qui nous fait aspirer aux plus belles choses. Comme la Terre a besoin d’espace, nous avons besoin de nos rêves. Alors, les enfants, n’ayez pas peur de vous en servir, de vous en souvenir ! N’ayez plus peur d’avoir peur ! ».
Tel est le paradoxe muré que Lelouch s’est pris malheureusement en pleine face : alors qu’il faisait autrefois passer sa théorie par le pouvoir exclusif et polyphonique de la mise en scène (on y croyait à fond dans Les Uns et les Autres et Partir, revenir), le voilà qui échoue à incarner sa mise en pratique au point de rendre sa théorie plus vaseuse qu’autre chose. Son utopie d’un rassemblement intime de toutes les religions était évidemment des plus défendables, mais sa démonstration s’est révélée grossière. On peine aussi à déceler en quoi cette exploration de la tauromachie et du monde gitan pouvait donner du grain à moudre à sa démonstration. De son intro sur fond de La valse à mille temps de Jacques Brel jusqu’à sa scène finale piquée par une abeille « divine », et sans que l’on sache si sa durée interminable était vraiment nécessaire (une heure de plus ou de moins n’aurait rien changé au problème), La Belle Histoire enfile les hasards lourdauds et les coïncidences plombantes dans un salmigondis judéo-crétin qui fait constamment toc. Il y avait de l’ambition dans cet évangile millénariste selon saint Claude, c’est sûr. Mais quand celui-ci n’amène finalement à rien d’autre que la grosse tête, peut-être était-il préférable de faire machine arrière dès le départ et éviter ainsi de faire passer ses vessies pour des lanternes.

TOUT ÇA… POUR ÇA !
France – 1993 – 1h56
Osons là encore adhérer à cette idée selon laquelle chaque film de Lelouch est une réponse au précédent : le titre de ce nouveau film désigne assez bien la première réaction que l’on pouvait avoir en sortant du précédent ! Oublié le salmigondis mystique-toc-toc de La Belle Histoire : Lelouch revient ici à son meilleur dans une forme déjà plus modeste. Avec un sujet en or : la guerre des couples sur fond de guerre des sexes, avec l’adultère et l’échangisme vus comme les outils rêvés pour relancer une vie conjugale au point mort. Le réalisateur sait très bien de quoi il parle, puisqu’il est le premier concerné : après sept années de vie commune, son mariage avec Marie-Sophie L. est alors au bord de l’abîme. Et si, pour sortir de la tourmente, un couple décidait de se tourner vers l’autre alternative ? Reste la question du point de vue posé sur une telle situation : qui va juger qui, et de quel droit ? D’où l’idée d’opposer à ce savoureux marivaudage sexuel une autre intrigue elle aussi bien tordue sur les choses de l’amour : trois hommes arrêtés par la police (Lindon, Darmon, Gamblin), réunis par hasard pour des histoires de femmes qui les ont amenés au fond du trou et poussés vers l’illégalité, se retrouvent au tribunal, jugés par un procureur (Francis Huster) et défendus par un couple d’avocats (Fabrice Luchini et Marie-Sophie L.). Et comme le procureur est l’amant de l’avocate, tout se détraque : les juges deviennent les jugés, les accusés enfilent la robe du magistrat, les intellos font pâle figure à côté des naïfs, et on glisse du Johnny Hallyday dans les plaidoiries… « C’est haaaaallucinant », comme dirait l’autre…
Histoire de rompre un peu avec sa logique du récit déstructuré, Lelouch s’en tient à une narration en trois étapes qui met en situation les juges avant les accusés, avec un troisième acte qui remet en cause l’attitude des uns et des autres. Le plus fort là-dedans, c’est qu’on se retrouve devant un Lelouch plus léger, plus drôle, voire même plus amoral, qui fait volontairement déglinguer son analyse du genre humain pour finalement se laisser contaminer par un art consommé du laisser-aller. Le cinéaste avait visiblement envie de rire un bon coup pour se sortir d’une tempête conjugale et professionnelle, et, summum de l’inconscience, va jusqu’à installer sa vie privée au cœur du prisme en faisant tourner ici les trois femmes de sa vie : l’ancienne (Evelyne Bouix), l’actuelle (Marie-Sophie L.) et la future (Alessandra Martines, autrefois jeune héroïne de La caverne de la Rose d’Or). Tout ça pour se finir en procès de la monogamie où l’extraordinaire Fabrice Luchini – césarisé à juste titre pour ce rôle – fait tout valdinguer avec un génie qui n’appartient qu’à lui. On doit ici à l’acteur une scène mémorable, celle de la tente, qui vaut bien le simulacre d’orgasme de Quand Harry rencontre Sally. Même en connaissant très bien le degré de liberté que Lelouch accorde à tous ses acteurs, la capacité de Luchini à improviser une scène jusqu’à se la réapproprier intégralement laisse à penser que le cinéaste est tombé cette fois-ci sur plus fort que lui. Leur collaboration, en tout cas, a su casser des briques.

LES MISERABLES
France – 1994 – 2h48
Claude Lelouch et Victor Hugo, même combat ? Oui, si l’on s’en tient au fait que les deux artistes ont puisé chacun dans leur vie privée pour bâtir leur œuvre. Voir le cinéaste se frotter aux Misérables pour sa première tentative d’adaptation d’un livre existant n’était donc pas si saugrenu que cela. Et pour couronner le tout, l’œuvre-phare de Hugo, sorte de synthèse intemporelle de toutes les souffrances du monde, pouvait autant se couler dans le moule lelouchien que se retrouver déclinée à toutes les sauces. La confiance régnait surtout en raison des précédentes adaptations, parfois correctes chez Raymond Bernard et Robert Hossein, parfois désastreuses chez Bille August et Tom Hooper, mais toujours limitées à une transposition scolaire du livre. Avec Lelouch aux commandes, le mot « adaptation » reprend soudain tout son sens : conserver l’âme intemporelle du roman afin de la remodeler dans un autre contexte. Donc acte : Lelouch avance le curseur temporel (l’action se situe ici pendant l’Occupation), compresse la trame originelle pour n’en garder que la sève la plus humaniste, et surtout, audace suprême, intègre le livre lui-même dans son propre scénario. Cette idée aurait pu couler le film en osant une mise en abyme inappropriée. C’est pourtant elle qui intronisera Lelouch comme le seul cinéaste à avoir réellement capturé et assimilé l’esprit du roman-fleuve d’Hugo.
En effet, le roman de Victor Hugo devient ici une sorte de prisme qui renvoie les personnages à leur propre condition. En particulier ce déménageur bienveillant, Henri Fortin (Jean-Paul Belmondo), qui n’arrête pas de s’étonner du fait que les gens le surnomment Jean Valjean. Ne sachant ni lire ni écrire, il n’a jamais pu lire le roman d’Hugo, et ce sont ses clients qui lui feront la lecture, éclairant ainsi sa vie : son père injustement emprisonné à Cayenne comme le fut Valjean ; sa mère Catherine en simili-Fantine qui échoua chez des aubergistes aussi salopards et grippe-sous que les Thénardier ; son histoire personnelle rappelant celle de Cosette ; sa destinée qui le verra, en aidant une famille juive à fuir les nazis, prendre sous son aile une petite fille comme si elle était une nouvelle Cosette. L’intemporalité de cette relecture redouble encore de volume lorsque Lelouch intègre d’autres sous-intrigues qui ajoutent en équilibrant au lieu de soustraire en éclatant. Se croisent ici des réminiscences du Bon et les Méchants avec la présence des Tractions Avant et du gang Bonny-Lafont, une sous-intrigue digne d’Underground (une femme dissimule la fin de la guerre à l’homme juif qu’elle a caché dans sa ferme), des parallèles diffus entre l’action et le livre d’Hugo (les scènes se calent à merveille dans le montage), un bal d’ouverture où la caméra tournoie moins pour inviter à l’euphorie dansante que pour annoncer le vertige des drames à venir, et une jolie dose de piano forte qui laisse dans un état de tension permanente.
Les grands moyens sont donc autant là que l’art de l’enchevêtrement des époques propre à Lelouch, et l’âme des Misérables en sort magistralement grandie. Pour un cinéaste aussi attaché à capter les correspondances entre le hasard et la fatalité, c’est dire que sa mise en scène s’avère parfaite, riche d’une inventivité peu commune (le champ/contrechamp sur Valjean et Javert dans la voiture, cadré uniquement par leurs reflets dans les rétroviseurs !), et osant même braver le pathos pesant. L’impact de l’image supplante ici sa dialectique, imprimant ainsi une bonne douzaine de scènes dans notre mémoire. L’évasion ratée de Fortin par le puits du bagne – très Alexandre Dumas dans l’âme. La relecture du roman d’Hugo par un Darry Cowl impayable en bouquiniste zozoteur. La détresse de Clémentine Célarié face aux galères qui lui tombent dessus. L’émotion d’un Belmondo là encore transfiguré en une scène qui file de sacrés frissons (celle du « petit ramoneur », qui accompagne le générique de début). Et surtout, au-dessus de tout le reste, une Annie Girardot qui paraît projeter sur son personnage une mise en abyme de ses doutes personnels en tant que femme et actrice, et qui sort ici une mémorable improvisation face à un Michel Boujenah incapable d’articuler le moindre mot. Une scène qui légitime d’autant plus le César reçu par l’actrice – son discours de remerciements reste encore dans toutes les mémoires. Calcul gagnant au final. On s’attendait à un solide feuilleton à l’ancienne. On récolte finalement un grand film.

HOMMES, FEMMES, MODE D’EMPLOI
France – 1996 – 2h02
Le titre annonce un mode d’emploi du genre humain, mais n’était-ce pas déjà le cas de tous les précédents films de Lelouch ? Le générique de début annonce « une comédie inhumaine », mais est-ce vraiment concevable chez un tel cinéaste ? D’entrée, on sent pourtant de quoi contredire ces deux aprioris, puisque l’analyse du cerveau – avec ses hauts et ses bas – forme intrinsèquement le sujet même du film. En se servant du personnage de Pierre Arditi comme porte-parole, Lelouch y dissèque ici une croyance visiblement très ancrée dans le domaine médical, mettant en lumière le rôle insoupçonné du mental dans le développement d’une maladie. En gros, soit le malade se persuade d’être souffrant et ses défenses s’écroulent, soit il choisit de juger sa maladie comme étant bénigne et son cerveau se met en guerre contre les toxines. En gros, ici, le moral est la morale. Et comme on est chez Lelouch, c’est le moral (positif) qui ordonne tout (de la mise en scène à la tonalité générale du récit), qui injecte une chaleur humaine permanente comme anticorps dans un corps esthétique glacial transpirant au départ l’omniprésence de la maladie (il neige beaucoup dans le film), qui transforme même la tragédie en comédie sous l’effet du mensonge. Qui a dit que le cinéaste n’était pas le démiurge bienveillant de son public, ce dernier devenant sa « création » au même titre que son propre film ?
Hommes, femmes, mode d’emploi pourrait être ainsi défini : un film d’arnaque où les personnages tentent d’arnaquer leur propre cerveau, et où le spectateur joue à se faire arnaquer, le tout à des fins curatives (réplique mémorable de Pierre Arditi : « Les charlatans sont les seuls qui ont le culot de se servir du mensonge comme thérapie ! »). Il aura pourtant fallu d’un détail médiatisé à outrance pour que l’incompréhension prédomine : Bernard Tapie fait l’acteur chez Claude Lelouch ! Suffisait-il d’une idée pareille – pourtant parfaitement logique au vu du sujet et de son traitement – pour faire illico du cinéaste d’Un homme et une femme la « honte du cinéma français » ? On aurait juste envie de rappeler à certains qu’à bien des égards, Tapie est un acteur-né. Entrepreneur, président de l’OM, homme politique, présentateur télé, directeur de journal, navigateur, escroc : on n’enfile pas autant de casquettes en une seule carrière sans avoir le goût de la comédie gravé dans un coin du cerveau. Le gros paradoxe ici, c’est que Lelouch garde le contrôle de sa mise en scène en laissant Tapie « bouffer » le film. Il réussit même l’impensable : filmer la défaite de Fabrice Luchini face à un improvisateur bien plus déstabilisant que lui ! Culte en puissance, leur dialogue en voiture autour du pari de Pascal constitue une synthèse optimale du film, imposant la prise de risques comme supérieure au fait de rester dans un sillon sécurisé – c’est Tapie qui parle mais on sent que Lelouch acquiesce. Et ce avant un smash scénaristique bien senti qui, au cours d’une visite à Lourdes, justifie la théorie pascalienne tout en la contredisant.
Quitte à nous arnaquer en beauté lorsque sa bobine s’apprête à envoyer ses dernières cartouches, Lelouch prend même le risque d’éclater sa théorie sur le mensonge en mille morceaux avant d’en ressusciter l’hypothèse lors d’un final qui mêle les niveaux de réalité – Luchini y joue le rôle de Tapie dans un film. Preuve d’un film malin et gigogne où les personnages, d’emblée définis et reliés par leur écoute commune de l’horoscope, optent consciemment pour l’auto-persuasion (souvent au risque de rencontrer l’échec) et se laissent aller en fonction de leur moral : un chef d’entreprise choisit ses dirigeants en les interrogeant sur une cravate (le « piège à cons » idéal), des flics de bonne humeur osent laisser partir des délinquants, une infirmière intervertit des résultats de biopsie par vengeance personnelle, etc… Le seul mode d’emploi qui existe ici est celui des acteurs et des êtres, les premiers jouant les autres, les seconds se jouant des autres. Si un sujet pareil avait atterri dans les mains d’Arnaud Desplechin, le résultat n’aurait sans doute pas été bien différent.

HASARDS OU COÏNCIDENCES
France – 1998 – 1h56
Il y a un « ou » dans le titre. C’est bizarre : en général, dans ses histoires, Lelouch s’intéresse autant au hasard qu’aux coïncidences – son parcours en est la preuve. Ici, il semble qu’il soit nécessaire de faire un choix. En tout cas pour sa nouvelle héroïne, Myriam (Alessandra Martines), qui, après être passée d’une heureuse coïncidence à une autre dans sa vie, voit la tragédie la plus totale lui tomber brutalement dessus, la forçant du même coup à affronter les lois du hasard, en espérant que la chance survienne à un moment donné. En plus clair, il était question ici de capter ce point de bascule au travers du pire drame envisagé (perdre brutalement ses proches), histoire d’en extraire une force de vie plus intense qu’au départ. Sur le papier, rien de surprenant : on reconnaît bien Lelouch. À l’écran aussi, mais on se crispe souvent. Pour tout dire, c’est peut-être avec Hasards ou coïncidences que Lelouch entame sa glissade sur la mauvaise pente : on a désormais l’impression que le film, aussi brillant soit-il en termes narratifs et esthétiques, commente lui-même son intention par la parole au lieu de laisser l’image tout exprimer à sa place. Lelouch l’a certes souvent fait, mais jusqu’ici sans excès. Ici, le verbe parle et l’image se contente de le suivre. De là vient cette sensation de naïveté gratinée au prêchi-prêcha le plus pompeux qui fait encore aujourd’hui la colère de tous les « lelouchophobes ». Et pour le coup, on aurait bien du mal à leur donner tort.
Avec ce sujet, Lelouch avait tout en main pour signer sinon son film le plus émouvant, en tout cas la synthèse potentielle de tout ce qui forge son regard d’auteur. Certains moments de grâce laissent à penser qu’il allait y parvenir, comme lorsque son envie de faire parler l’indicible s’exprime par une confiance absolue dans le cadre et les regards. À vrai dire, un plan fixe sur le regard éteint et d’Alessandra Martines (définitivement une très grande actrice) en dit mille fois plus que ces longues tirades pompeuses et rébarbatives sur les « zazards zou les coïncidences » qui servent de motifs de drague entre elle et Pierre Arditi. L’idée de suivre un potentiel nouveau départ (nouvel amour ?) en la personne d’un professeur de prospective (cette « science » qui tente d’anticiper l’avenir) va même dans ce sens : la théorie et le discours servent ici de paraphrase un peu lourde alors que le montage, judicieusement éclaté pour contourner le pathos de la linéarité, use déjà à merveille du flash forward afin d’anticiper les événements par petits signes bien disposés. Quant à cette idée peu accomplie de filmer les derviches tourneurs pour capturer « ce moment où le danseur communie avec le divin » (ce sont les mots de Lelouch), on préfèrera toujours revoir Baraka de Ron Fricke, qui incarnait cette idée de façon sensorielle au lieu de s’en tenir à une banale théorie mystique.
Reste qu’en dépit de ses évidents points faibles, Hasards ou coïncidences propose de très belles idées qui nous donnent envie de l’aimer. Cette relecture inspirée de la vie et du cinéma comme espaces emboîtés, où un spectacle mêlant la scène et l’écran de cinéma abat le mur séparant le réel et le virtuel, où une petite caméra numérique qui parcourt le globe peut aider à reconstituer le fil d’une mémoire inventée, où le dialogue progressif par le biais unique des images filmées accroît le caractère immortel du cinéma. Cette vision romantique d’un phare comme cocon protecteur d’une cellule familiale, presque en retrait du monde extérieur. Cet optimisme à vouloir puiser dans le deuil aussi bien un mécanisme de survie que de nouvelles mécaniques de vie. Cette persistance du cinéaste à lire l’échec comme une victoire déguisée, consistant à rester perpétuellement dirigé vers l’avenir au lieu de se retourner vers le précipice. En dépit d’un sujet tout sauf joyeux, Lelouch disait avoir fait là son film le plus optimiste. C’est vrai que l’épilogue du film balance clairement dans cette direction, mais comme tout y est placé en suspens, alors tout est possible. Cela n’aura en tout cas pas suffi à convaincre qui que ce soit, puisque l’échec en salles fut ici absolu.
2000

UNE POUR TOUTES
France – 2000 – 1h57
Pour Claude Lelouch, les années 2000 vont être synonymes de poisse. La traversée du désert va être rude, et elle commence en beauté avec Une pour toutes, film par lequel sa petite mécanique va se gripper illico. On y retrouve le mauvais côté de Lelouch, ce côté « escroc de la narration poupée russe » qui brise la linéarité et encombre inutilement le contenu jusqu’à ne trouver comme seule porte de sortie que de justifier son échec par un effet de mise en abyme hypocrite – on a déjà vu ce que ça donnait dans Vingt ans déjà. Parce que oui, ici, si « coupable » il doit y avoir, ça ne doit pas être le metteur en scène lui-même mais davantage son alter ego intégré dans le film. À savoir un flic joué par Jean-Pierre Marielle qui veut tourner un film sur quatre filles (une hôtesse poseuse de bombes et trois actrices à prénoms russes) qui draguent des hommes fortunés dans le Concorde afin de les dépouiller (et ces idiots tombent dans le piège sans rien remarquer !). En l’état, ce genre de situation simpliste ferait merveille pour une sitcom AB. Mais pour contourner les démons de la petite lucarne, Lelouch dégaine sa carte fétiche : le film dans le film. En gros, l’intrigue suit l’écriture d’un film tourné par Claude Lelouch lui-même à partir d’une histoire vraie (celle racontée dans le film, donc pas vraiment vraie) qui devient Une pour toutes. Entre réalité et fiction, on ne sait plus où donner de la tête. Peut-être parce que le film lui-même avance sans queue ni tête ?
À vrai dire, cette filouterie scénaristique montre vite ses limites. On ne sait pas trop si Lelouch voulait se dédouaner d’avoir peut-être titillé un léger fond de misogynie : en gros, les hommes sont ici de pauvres timides facilement manipulables, et les femmes des actrices vicieuses qui abusent de leur vulnérabilité par leur pouvoir de séduction. On ne sait pas non plus s’il souhaitait juste s’en tenir à un renversement des faux-semblants sur l’amour et le hasard (pas facile de tutoyer Marivaux dans ce cas-là…). Mais il finit en tout cas piégé dans ses propres filets : tenter la mise en scène de sa propre mise en scène est un exercice qui vire ici à la crise d’ego. En cela, le voir parachever son gros joujou gigogne en intégrant l’affiche du film dans la diégèse – le film est-il un faux documentaire sur sa façon de créer des films ? – ne réussit qu’à faire couler la narration. Une narration qui, d’ailleurs, n’existe pas vraiment : ce que l’on voit ici est moins un film qu’une suite de séquences désordonnées. À l’exception du dialogue entre François Perrot et Jean-Pierre Marielle, on pourrait monter toutes les scènes dans un ordre différent que ça ne changerait rien. Troué de partout, Une pour toutes ne peut même pas compter sur sa quinte flush d’actrices pour justifier un bluff aussi kamikaze : hormis Alessandra Martines (la plus douée et la plus sexy de la bande), les quatre pies voleuses de l’amour ne servent pas les figures libres si chères à Lelouch – elles sont aussi mauvaises dans le jeu masqué que dans l’improvisation. Les voir chialer face caméra ajoute encore au calvaire.

AND NOW… LADIES AND GENTLEMEN
France – 2002 – 2h08
Le titre du film indique sans ambiguïté l’intention de Lelouch : jouer les Monsieur Loyal en annonçant une entrée. Fort heureusement, à l’inverse du film précédent, l’entrée en question ne sera pas la sienne. Le cinéaste entrecroise deux souvenirs réels : d’une part sa découverte d’une chanteuse mélancolique au piano-bar d’un hôtel du Zimbabwe qui n’était ni écoutée ni regardée, d’autre part sa rencontre avec un ex-voleur au look de gentleman, venu lui rendre l’argent qu’il lui avait dérobé au siège des Films 13 quelques années auparavant. Une « lady » et un « gentleman » : mettez ça dans un Lelouch, la recette sera facile à suivre. Revoilà donc le pitch dérivé d’Un homme et une femme, avec la rencontre amoureuse de deux fatigués de l’amour dans un endroit loin de chez eux – le Maroc en l’occurrence – et même le thème de Nicole Croisille chantonné par Kaas au détour d’une scène. On voit d’ici tout le tableau, et pourtant, le visionnage crée d’autant plus la surprise que le cinéaste lui-même se montre encore aujourd’hui très négatif sur le résultat (« Certains de mes films ont bien vieilli, d’autres moins. Celui-là s’est d’autant plus vite usé qu’il était récent »). Osons une hypothèse : en mettant la pédale douce sur ses ambitions gigognes (ouf…) et en tentant même un fragile cross-over avec la patte décomplexée d’un Hitchcock (période La main au collet), Lelouch avait-il la sensation de perdre son regard au profit d’un autre un peu trop désorienté ? On peut supposer que oui. Mais à la revoyure, ce marivaudage sous le soleil du Maghreb a bien des qualités à revendre.
L’absence de complexes se ressent dès le premier quart d’heure, assez rigolo, où une série de hold-up exécutés par un Jeremy Irons en gentleman cambrioleur (très Cary Grant dans l’âme), montrent ce dernier grimé en toutes sortes de personnages (vieille Anglaise, escroc retraité, travesti poudré, hippie guitariste, etc…). Juste après, lorsque Patricia Kaas arrive, on a là aussi envie de rire (sa chanson « coup de fil » sent le playback à plein nez), et puis plus du tout (on la voit plaquée par son amant pour une Black en disant « Je lui offrais la vie en rose, mais il a préféré la vie en noir ! »). Cette intro en montage alterné annonce un dérapage incontrôlé, mais Lelouch rééquilibre assez vite la balance par un goût de l’évasion naïve qui laisse un peu ses mauvais penchants sur le siège arrière. Infusée dans des décors orientaux magnifiés par un très beau Scope, la magie de ce film fragile surgit évidemment des regards entre Kaas et Irons, pris en défaut dans des effets de champ/contrechamp où leur visage ne peut plus dissimuler l’indicible. Bien sûr, le cinéaste joue aussi avec l’image, comme dans ces instants furtifs où la Patricia – qui ne nous les Kaas jamais quand elle chante ! – se dessine soudain en noir et blanc dans une image couleur lorsque son moral se met soudain à chuter. On la savait bonne chanteuse, on la découvre bonne actrice, même si elle sert ici d’épicentre pour une BO jazzy qu’elle rend sensuelle à souhait avec son beau timbre vocal. Face à elle, Jeremy Irons impose sa classe récurrente en singeant le charme british avec retenue, y compris quand il se laisse aller à des déguisements improbables. Leur tandem est à l’image du film : complexé à l’intérieur, décomplexé à l’extérieur.
Certes, le manque de modestie dont le cinéaste fait preuve de plus en plus se ressent ici, comme dans son idée de placer de la star Paris Match dans chaque recoin de décor (Thierry Lhermitte, Bernard Montiel, Claudia Cardinale, Daniela Lumbroso, Stéphane Ferrara, etc…), d’utiliser Jean-Marie Bigard en médecin philosophe pour plaquer ses considérations sur la vie et l’amour (on n’est pas loin du gourou à catogan joué par Patrick Sébastien dans T’aime !) ou de tourner à nouveau les pages du petit Lelouch illustré (la passion de la boxe, les manèges de fête foraine, les orchestres, l’éloge du cinéma, le romanesque à tendance rocambolesque, les œillades en amorce, etc…). Il n’empêche qu’en osant une telle escroquerie au charme dans des décors qui ont tout pour dépayser les sens et encourager l’attraction amoureuse par le biais de l’accident, le cinéaste réussit à nous avoir à l’usure sans mentir sur la marchandise. Le trop-plein de tout continue d’un film à l’autre de le placer sur une pente glissante, c’est évident, mais la serre des désirs humains qu’il persiste à vouloir fétichiser par le grand spectacle laisse encore pousser de jolies fleurs au milieu des ronces.

11’09’’01 – SEPTEMBER 11 (film collectif)
Egypte/Etats-Unis/France/Inde/Iran/Japon… – 2004 – 2h10
Le cinéma n’aura pas attendu bien longtemps pour s’emparer du 11 septembre 2001, histoire d’en faire le sujet d’une longue lignée de thrillers politiques ou de films à suspense. L’opportunisme hollywoodien n’est en revanche pas ce qui caractérise ce film collectif, avant tout destiné à refléter l’impression intime et subjective de onze cinéastes internationaux sur cette immense tragédie. De cette manière, la résonance de cet événement dans le monde entier par le prisme de l’art pouvait acquérir un nouveau relief. Parmi les cinéastes ayant répondu à l’appel du producteur Alain Brigand, Claude Lelouch opte pour un point de vue qui surprend en plus de détonner radicalement avec celui des autres cinéastes invités (citons notamment Sean Penn ou Ken Loach, qui restent ici dans la lignée de leur films respectifs). Certes, une fois de plus, Lelouch filme un couple, en l’occurrence un couple qui se dispute dans un appartement de Manhattan en ce petit matin du 11 septembre 2001. L’homme quitte l’appartement, la femme se retrouve toute seule. Mais la surprise vient d’ailleurs : la jeune femme, ici jouée par Emmanuelle Laborit, est sourde. Et le film, dans sa quasi-totalité, opte donc pour un silence de mort alors que le bruit du chaos s’intensifie à l’extérieur.
Au-delà de l’émotion, c’est une performance totale de mise en scène qu’accomplit ici Lelouch. En optant pour une bande-son avec une audiométrie au plus bas niveau (subjectivité sensorielle absolue pour adopter la surdité de l’héroïne), en limitant son montage à des cadrages simples qui ne laissent rien transparaître de ce qui se passe, en choisissant d’utiliser une télévision comme seul relais visible – et forcément inaudible – des images de l’attaque sur le World Trade Center, et en construisant un suspense ultra-stressant sur l’instant où la femme va enfin comprendre la situation (à quel moment son regard va-t-il enfin croiser les images de la télévision ?), le cinéaste ose un pari de cinéma rare : couper l’un des cinq sens du spectateur pour finalement l’inciter à le récupérer attentivement tout en intensifiant les quatre autres par toutes sortes d’idées de mise en scène. Mais ce n’est pas tout, car Lelouch reste Lelouch : son court-métrage enregistre surtout la sensation de coupure avec les enjeux du monde extérieur, non pas à cause d’un handicap (encore heureux !) mais à cause d’un lien affectif qui brise autant l’émotion que l’élan vital – on reconnaît bien là son sentimentalisme. Et c’est donc en voyant son compagnon revenir la mine défaite et le corps recouvert de cendres que la vérité éclatera. Ou comment faire se rejoindre symboliquement le chaos du monde au chaos de l’intime. Et inviter in fine à tout rebâtir ensemble, puisque tout est intrinsèquement lié.

LES PARISIENS
France – 2004 – 1h54
Cet échec-là, Lelouch doit encore aujourd’hui l’avoir en travers de la gorge. C’est logique : prendre le risque d’endetter sa société de production avec un coûteux projet de trilogie après plusieurs revers commerciaux et se manger finalement le plus gros bide de sa carrière, ça assomme direct. Plus encore quand, en guise d’ultime coup de dés, il va jusqu’à proposer une séance gratuite dans tous les cinémas de Paris le même jour à la même heure. Peine perdue : le bouche-à-oreille ne peut contrer la critique – ici plus qu’assassine. De là à croire que Lelouch était en train de revivre le bide absolu du Propre de l’homme, il n’y a qu’un pas. On comprend sa douleur. Sans pour autant tempérer les réserves que l’on peut avoir sur le résultat… Cette trilogie, le cinéaste rêvait sans doute d’en faire son film-somme, ce qui tombe sous le sens quand on en lit le titre : Le Genre Humain. Rien que ça ! Après avoir été jugé mégalo par tout un chacun, Lelouch se prenait-il enfin réellement pour Dieu ? En fait, seul Ticky Holgado a ici le culot de dire s’appeler Dieu. Et donc ici, le Créateur n’est autre qu’un SDF qui observe avec lucidité et bienveillance la foule parisienne (alias la « goutte d’eau » qui résume un globe d’humanité, d’accord, merci, on a pigé). On pourrait donc dire que la meilleure idée du film est purement accidentelle : le décès de l’acteur quelques mois avant la sortie du film rend ses scènes fatalement touchantes. Mais à part ça, le paquebot lelouchien prend souvent l’eau et fait boire la tasse à ses passagers, acteurs comme spectateurs.
Même si on n’y retrouve pas le même taux de mysticisme neuneu (encore heureux…), Les Parisiens mange malgré tout du même pain que La Belle Histoire. Soit un glissement à risque de la fresque chorale vers un récit généralisateur, partant du global pour se resserrer sur le particulier, avec un assemblage de sous-intrigues que le cinéaste décrit comme « un inventaire à la Prévert » (mouais…). On peut adhérer à l’idée, d’autant que Lelouch n’aime rien tant que de saisir l’inconscient des êtres – ici au travers d’une caméra HD qui lui donne davantage de liberté. Mais il faut voir avec quels ingrédients il cuisine son marshmallow et avec quels outils il nous le fait avaler. Accompagner tant de destins entrecroisés pour, au final, en larguer la moitié en cours de route a le don de gâcher une fiction potentiellement foisonnante. Sans parler du fait que chaque destin ne sert qu’à ressasser les traditionnelles pensées lelouchiennes sur la vie, le destin, l’amour, la musique, le succès, le miel et les abeilles. Des pensées qui, à ce stade-là, se muent parfois en inepties. Petit best-of : Michel Leeb et Arielle Dombasle se draguent en dissertant sur les pizzas (peu avant que le premier crève d’un infarctus dans une boîte à partouzes !), Jésus prend la pose crucifié sur les escaliers du Sacré Cœur (attention symbole !), deux SDF philosophent comme les deux vieillards du Muppet Show, Robert Namias met cyniquement en perspective son job à TF1, Victor Hugo sert ici de caution auteuriste sans même avoir été concerté, et les deux héros nous cassent les tympans à répétition avec une chanson débile (le refrain : « Le bonheur, c’est mieux que la vie / C’est pas moi, c’est Philippe qui l’a dit », waow…).
Les deux héros – ici chanteurs de rue – ne sont d’ailleurs pas gâtés par leurs interprètes. Lui, c’est Massimo Ranieri, ancienne gloire de la variété italienne et sosie d’Eddie Constantine, au charisme pour le coup néantisé. Elle, c’est Maïwenn, certes pas encore réalisatrice à l’époque, mais qui, lorsqu’elle se met à chanter, fait un peu clone suraigu de Nolwenn. Grosso modo, la seconde largue le premier quand un succès à la Mylène Farmer lui tend les bras, mais cruel destin oblige, le succès ne dure pas et c’est son ancien compère qui deviendra star musicale à sa place. Quand cette peinture d’un couple séparé par la gloire tape dans le mille, ça donne Une étoile est née ou La La Land. Mais en dépit de quelques jolis moments, Lelouch rame ici à magnifier le succès et l’échec, quitte à s’appuyer sur son vécu comme il l’a toujours fait. L’esquive qu’il tente alors pour s’en sortir achève de tout foutre en l’air : le voilà qui, surprise, débarque dans le film et joue son propre rôle. Etalage narcissique d’un auteur qui tombe amoureux de cette histoire tragique (celle que l’on suit, donc celle qu’il a lui-même écrite) et décide d’en faire un film (celui que l’on regarde, donc… oui, bon, vous avez déjà compris). Tout vire dès lors à l’auto-fellation déplacée : Lelouch qui adore sa femme, Lelouch qui adore le cinéma, Lelouch qui adore les acteurs qui le lui rendent bien, Lelouch qui sort son film dans une salle bondée et conquise, Lelouch ceci, Lelouch cela… En se berçant des pires illusions, le cinéaste a oublié l’essentiel : enfiler les lapalissades et batailler contre son propre ego ne mène à rien. Et la salle n’avait donc rien à lui offrir en retour.

LE COURAGE D’AIMER
France – 2005 – 1h41
Le bide monumental des Parisiens aura-t-il donné envie à Lelouch de stopper net la mise en chantier de sa trilogie sur le « genre humain » ? La sortie relativement rapide du Courage d’aimer nous poussait à croire que oui, mais la réalité est assez différente, pour ne pas dire assez tordue. Ce n’est pas au second épisode de sa trilogie que l’on a affaire ici, ni même à un nouveau film qui ferait table rase d’un projet laissé à l’abandon, mais un authentique digest des deux premiers épisodes – le troisième passant définitivement à la casserole pour raisons budgétaires. Quel intérêt ? Il y a bien sûr l’envie d’éviter de créer un film « orphelin » – à savoir le deuxième qui était prévu à la base – au vu du faible nombre de spectateurs ayant visionné le premier épisode, mais pas seulement. En fait, Lelouch ne cherche pas à refaire le même film en pensant peut-être l’avoir précédemment raté, mais à exploiter le matériau narratif déjà tourné afin de concentrer les temps forts de sa trilogie inachevée en un film unique. D’un point de vue purement conceptuel, l’idée est intéressante : un film ne serait donc pas « un » mais « plusieurs ». La caractéristique première du Courage d’aimer est donc de relier la création d’un film de cinéma à un travail perpétuellement inachevé, tel un puits qui ferait sans cesse surgir de nouvelles histoires. Soit, mais encore faut-il que les scènes inédites réintégrées dans ce nouveau montage aient de quoi justifier ce parti pris. Et c’est sur ce point-là que cette « leloucherie » montre ce qu’elle a réellement dans le ventre, à savoir presque rien.
A la frénésie chorale des Parisiens – qui avait au moins le mérite de nous entraîner un minimum – se succède ici une trame aussi bipolaire qu’équilibrée, plaçant alors une intrigue tragique (celle de Maïwenn et de Massimo Ranieri) et une intrigue de vaudeville (celle d’Arielle Dombasle et de Michel Leeb) selon un principe de symétrie. Avec un trait d’union pour appuyer symboliquement cet effet narratif : Mathilde Seigner dans un double rôle on ne peut plus cohérent avec l’idée de départ – deux sœurs jumelles où l’une sert de miroir déformé à l’autre. Mais sur le fond, rien ne change : les tics du précédent film n’ont pas été éjectés du montage, la présence de Lelouch au casting produit le même agacement, et la fin transformée ne change rien à la philosophie de départ. Le résultat se révèle donc franchement inutile, hormis pour ceux qui n’auraient pas vu le premier film – et on leur conseillerait plutôt de voir ce dernier plutôt que sa « version alternative ». Par ailleurs, il y a quelque chose d’inhabituel que l’on constate en visionnant à la chaîne Les Parisiens et Le courage d’aimer : ces deux films révèlent un Lelouch plus dépouillé, chez qui les mouvements de caméra plus ou moins ostentatoires ont visiblement abdiqué face au plan fixe. Le cinéaste était-il en train de croire qu’aller droit à l’essentiel lui serait bénéfique ? Son film suivant allait lui donner la plus belle des réponses.

ROMAN DE GARE
France – 2007 – 1h40
En signant Roman de gare sous un nom d’emprunt (celui de son ami Hervé Picard), Claude Lelouch espérait-il vraiment contrer la bouderie (publique) et la malédiction (critique) qui lui collaient à la peau depuis dix ans ? Le succès du film dans les deux camps – il était temps ! – aurait tendance à valider son petit jeu. Mais de notre côté, on préfère penser que la mystification n’aurait pas fait long feu si elle avait perduré au-delà de la sortie du film. Parce qu’il n’aurait clairement pas fallu plus de dix minutes aux cinéphiles – et surtout à ses fans – pour reconnaître sa signature : générique surchargé de célébrités (il adore ça), récit en trompe-l’œil façon Le Voyou, plan subjectif d’une voiture qui traverse Paris à toute berzingue (existe-t-il des cinéphiles qui n’ont jamais vu C’était un rendez-vous ?), vrai-faux psychopathe évadé de prison qui drague une potentielle victime (comme dans L’amour avec des si), du Gilbert Bécaud à fond les ballons, on en passe et des meilleurs… Le cinéaste aurait donc tout à gagner à ne pas se bercer d’illusions dans son rapport tumultueux avec la critique : si ce nouveau film lui a visiblement redonné un coup de jeune, c’est tout simplement parce que la réussite crève l’écran. Lelouch n’a ici rien enlevé à ses habitudes ni boudé ses thèmes favoris. Il a juste visé l’épure parfaite, la solidité à toute épreuve du récit et de la mise en scène sans bout de gras, la pleine concentration de son style dans un jeu ludique et obsessionnel sur les notions fluctuantes de vérité et d’identité.
Le conteur qui excelle à jouer de l’ambiguïté des êtres supplante ici le philosophe qui se fragilise à vouloir retranscrire la complexité du monde, et ce n’est pas plus mal. De nouveau fidèle à sa logique d’une narration déstructurée qui prend le temps de recomposer un puzzle éclaté en jouant sur les apparences, Lelouch renoue donc avec les règles du polar. Qui est réellement Dominique Pinon là-dedans : un prof fatigué de sa propre vie ? Un tueur en cavale ? Un nègre littéraire ? Un double de Lelouch qui puise l’inspiration dans son observation des individus ? Tout ça à la fois, forcément, mais en même temps rien de tout ça, car le polar selon Lelouch reste affaire de duperie malicieuse. On ne l’avait cependant jamais vu aussi perfectionné dans l’épure commune du sens et de l’image, l’infinie subtilité de l’un coulant de source à travers la sobre maîtrise de l’autre. Cela dit, pourquoi avoir opté pour le titre Roman de gare ? On y voit bien sûr une signature décalée : phonétiquement, cela fait penser à Romain Gary, passé à la postérité en matière de mystification en signant La vie devant soi sous le pseudonyme d’Emile Ajar. Mais c’est aussi un jeu que s’autorise le cinéaste avec une forme de littérature populaire à laquelle le titre « roman de gare » donne un caractère péjoratif. Ainsi donc, le cinéaste fait tout passer par un premier degré total, qu’il s’agisse d’un mariage kitsch sur fond de folklore écossais ou d’une partie de campagne chez les fermiers savoyards. Et si tout sonne juste, c’est parce qu’il fait mine de ne pas choisir entre assumer le superficiel et dialoguer avec la surface.
Du noir et blanc à la couleur, de l’incertitude à la possible certitude, la mise en scène de Lelouch est déjà un piège en soi. On la sent sophistiquée mais on voit qu’elle est très simple – à moins que ce ne soit l’inverse ? On suit une mise en place d’indices qui pourrait aboutir à une résolution choc, sauf que le pourquoi du comment se révèle être une facilité de « roman de gare », assumée comme telle à la manière d’un coup tordu. Rien de surprenant : la prétention n’existe pas ici. Et durant tout le film, Lelouch n’a que faire de transcender un genre ou, pire encore, de le mettre en abyme à des fins narcissiques. Seul compte le plaisir de jouer avec le genre comme avec nous, en prenant soin d’aller droit à l’essentiel et en usant de la mise en scène pour mieux cacher son jeu. Les acteurs lui emboîtent le pas avec brio : dirigeant pour la première fois un Dominique Pinon en forme olympique et une Fanny Ardant hitchcockienne en diable, le cinéaste en profite aussi pour révéler une actrice époustouflante en la personne d’Audrey Dana – inconnue à l’époque de la sortie du film. Ces trois-là s’amusent des stéréotypes qu’ils incarnent (l’artiste, le manipulé, la victime : qui joue qui ?), tous mis en valeur par un cinéaste qui en fait moins des marionnettes que des pièces maîtresses. Lelouch n’avait jamais fait mieux avant. Et il n’a jamais fait mieux depuis.

CHACUN SON CINEMA (film collectif)
France – 2007 – 1h58
On a beau se méfier – à raison – des films à sketchs, ne serait-ce que parce que leur aspect éclaté et hétéroclite permet parfois de compiler un peu n’importe quoi sous le prétexte de la variété, il y a de belles exceptions qui valent le détour. La démarche de Gilles Jacob pour fêter les soixante ans du Festival de Cannes aura donné l’un des plus beaux exemples. L’objectif de Chacun son cinéma était aussi simple qu’alléchant : demander à 35 cinéastes reconnus de tourner un court-métrage sur le thème de la salle de cinéma, et ce dans une totale liberté. Tant de possibilités offertes, et au final, tant de petits films à déguster comme on dégusterait un apéritif filmique juste avant le lancement d’un long-métrage. Au beau milieu d’un ensemble très riche et très varié (mention spéciale aux segments signés David Lynch et Lars Von Trier, peut-être les plus surprenants), le court-métrage réalisé par Claude Lelouch, intitulé Cinéma de boulevard, n’étonnera guère ceux qui connaissent déjà le parcours du cinéaste et, surtout, les différentes étapes de son enfance qui l’auront mené vers le 7ème Art.
En 1936, année du Front Populaire et des congés payés, son père (ici joué par Zinedine Soualem) et sa mère (ici jouée par Audrey Dana) se rencontrent dans un cinéma de quartier où était projeté un film hollywoodien avec Ginger Rogers et Fred Astaire (au vu de la chanson entendue, il s’agit de Top Hat de Mark Sandrich). Dès cette petite drague improvisée par le père, les dates se succèdent : le petit bébé – encore dans le ventre de sa mère – sera bercé par les plus grands-films d’avant-guerre entre février et octobre 1937, le jeune enfant se cachera dans ce même cinéma de quartier en 1943 pour échapper aux rafles anti-juives (le cinéma deviendra alors son école), le jeune adulte découvre Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov en 1957 (le film qui fera de lui un cinéaste), et sa mère continuera en 1960 de fréquenter ce cinéma jusqu’à voir son fils triompher à Hollywood, recevant un Oscar des mains de Fred Astaire et Ginger Rogers. La boucle est bouclée… En quelques petites minutes, on assiste au témoignage de gratitude d’un artiste envers ceux qui ont fait de lui ce qu’il est devenu, ses parents d’une part, le cinéma d’autre part. En magnifiant ainsi les hasards de la vie (c’est son dada) tout en rendant un magnifique hommage au pouvoir mémoriel de la salle de cinéma, Lelouch ne pouvait pas trouver meilleur moyen de se définir.
2010

CES AMOURS-LA
France – 2010 – 2h00
Le vrai film-somme de Lelouch, le voici. Il faut dire que 2010 est une date-clé pour Claude Lelouch : il fête alors ses cinquante ans de cinéma. Quoi de plus adapté, donc, que de réaliser un film pour fêter l’occasion, dédié autant au public qu’à ses enfants ? Enfin remis sur pied grâce au succès amplement mérité de Roman de gare, le réalisateur synthétise à nouveau toutes ses obsessions : l’amour, les hommes et les femmes, la guerre, la déportation, la Libération, le jazz, les concertos de Sergueï Rachmaninov, la salle de cinéma comme lieu précieux où les espoirs et les drames jouent une valse tourbillonnante, et même ses propres films. En s’attachant à une femme (jouée par Audrey Dana) qui revisite ici ses amours passés au rythme d’un orchestre symphonique, Lelouch profite de l’occasion pour revisiter le cinéma qu’il aime (on y voit des extraits de Remorques et d’Hôtel du Nord) en y mixant ses précédents travaux. On revoit ainsi une large partie de la première demi-heure de Toute une vie : le début muet, la joie d’un soldat devenu père en pleine guerre des tranchées, l’apparition du cinéma parlant par le biais d’un film de propagande nazie. On revoit aussi le parachutage des soldats alliés en France des Uns et les Autres et la « course du siècle » d’Un autre homme, une autre chance. Sans parler d’une scène finale qui combine des images de tous les films de Lelouch, y compris ceux sans aucun rapport direct avec l’intrigue de celui-ci.
Le gros point faible du film est hélas à relever dans ce choix narratif : revoir un film constitué en grande partie de films déjà vus (et potentiellement hors sujet) sent presque l’opération opportuniste et ne permet pas de savourer pleinement un film de cinéma dans sa supposée autonomie. Comme si ça ne suffisait pas, ce n’est pas tant le bilan d’une vie gagnée par l’amour du cinéma et l’amour au sens large que l’on déguste ici, mais plutôt une redite de thématiques déjà exploitées en mieux avant. Cela dit, si l’on sent bien que la nostalgie dévore ici le cinéaste à un degré rarement atteint, c’est surtout parce qu’il ressent l’envie de revenir à sa propre source sans en réitérer les effets de mise en scène trop visibles. Toute fresque qu’il soit, Ces amours-là est ainsi un film étrangement apaisé, sans effets de style ni dialogues lourdauds, où le cinéaste boucle la boucle en faisant profil bas. Il n’est certes pas toujours exempt d’erreurs (mauvaise idée de filmer un massacre de résistants sur fond d’une chanson douce de Liane Foly !), mais son amour de la musique et du 7ème Art transpire littéralement de l’image et du son. Il est juste franchement regrettable qu’en lieu et place du grand film testamentaire que l’on était en droit d’attendre, on soit juste contraint de se farcir à nouveau les mignons radotages d’un cinéaste familier, un peu comme des enfants forcés d’écouter les souvenirs nostalgiques de leur grand-père à chaque fois qu’ils lui rendent visite.

D’UN FILM A L’AUTRE
France – 2011 – 1h44
On ne va pas se le cacher : visionner ce documentaire – conçu pour fêter le 50ème anniversaire de sa boîte de production Les Films 13 – ne pouvait qu’être un atout précieux pour accompagner l’écriture de cette rétrospective. En effet, bien que très sommaire et schématique dans son contenu, D’un film à l’autre a néanmoins le grand mérite d’éclaircir d’entrée le moteur principal de Claude Lelouch (en gros, foncer à la rencontre du public en prenant le risque de l’échec) en choisissant de caser l’intégralité de son court-métrage C’était un rendez-vous en début de bobine. Une introduction logique qui inaugure un long voyage sur une carrière longue comme le bras, où le bonhomme décortique toute sa filmographie, expose ses choix et ses convictions en le défendant le mieux possible, revient sans peur sur les crises et les moments d’égarement qui ont marqué son parcours, et offre à son public un best-of de ses scènes les plus mémorables : les retrouvailles sur la plage dans Un homme et une femme, le monologue d’Annie Girardot dans Vivre pour vivre, le dîner tendu de La Bonne Année, le fou rire nerveux de Michèle Morgan dans Le Chat et la Souris, le majestueux Boléro des Uns et les Autres, le célèbre « test » de Belmondo à Anconina dans Itinéraire d’un enfant gâté, l’éloge de la fellation par Fabrice Luchini dans Tout ça… pour ça !, etc…
Même si le retour sur une vie de cinéma ne pouvait qu’imposer le recours à la première personne (Agnès Varda avait fait pareil sur Les plages d’Agnès), même si Lelouch ne cache rien de ses échecs et de ses erreurs au point de se remettre très souvent en question, on ne sera pas surpris de voir une grosse propension à l’hagiographie dans ce docu. Il suffit de voir comment il s’arrange, lorsqu’il s’agit d’évoquer certains films, pour caser surtout des plans d’interviews où James Caan et Jean-Louis Trintignant ne cessent de vanter son génie et sa direction d’acteurs. On sent malgré tout dans ses paroles la fragilité d’un homme qui, malgré ses cinquante ans de carrière, est toujours resté un adolescent dans sa tête, désireux de toucher le public et d’assumer sa naïveté avec un certain courage. Au milieu de mille anecdotes généreusement amenées, ce qui émeut le plus reste de découvrir enfin des petits extraits de ses premiers films détruits (dont Le propre de l’homme et Les grands moments), et surtout de visualiser ces fameux essais vidéos de Lelouch sur Evelyne Bouix et Patrick Dewaere pendant la préparation d’Edith et Marcel, quelques heures seulement avant que l’acteur ne mette fin à ses jours. Mémoriel, on l’est ou on ne l’est pas…

SALAUD, ON T’AIME
France – 2014 – 1h59
Bon… Maintenant que le bilan a été fait, qu’allait donc bien pouvoir faire Lelouch ? Certainement pas abandonner la mise en scène, en tout cas. On voit mal ce qui aurait pu l’en empêcher, lui qui n’a jamais respiré autrement qu’à travers ses images, au point parfois de faire primer son travail sur une cellule familiale déjà fort remplie (sept enfants issus de cinq relations différentes). Si vous sentez un sujet de film dans cette phrase, pas de bol, le cinéaste vous a pris de vitesse. A déjà 77 ans, le vieux patriarche poursuit donc son autoportrait, cette fois-ci avec la retraite et la mort en ligne de mire, donc avec l’envie de refermer le fossé et de ressouder les liens qui auraient été tantôt brisés tantôt laissés de côté. D’où cette histoire de retrouvailles alpines entre un vieux photographe de guerre (Johnny Hallyday) et ses quatre filles dont il n’a jamais vraiment pris le temps de s’occuper. Sauf que si celles-ci acceptent de revenir vers lui, c’est pour une raison tragique, en réalité inventée de toutes pièces par le meilleur ami de leur père (Eddy Mitchell, toujours très fan de westerns). Un détail qui, à lui seul, va tout bouleverser… Encore un jeu sur la vérité et le non-dit, en somme ? En quelque sorte. Mais on sent que le cinéaste, plus serein que jamais, a désormais le cœur tourné vers autre chose…
Le choix de Johnny Hallyday en simili-Lelouch est d’entrée ce qui séduit le plus : le visage buriné de l’artiste se lit désormais comme un paysage à part entière, à l’image de ces magnifiques reliefs alpins qui servent de toile de fond au récit. Salaud, on t’aime n’est ainsi jamais meilleur que lorsqu’il se concentre pleinement sur ce roc de tendresse bourrue et mélancolique, niché au milieu d’une vallée de chaleur humaine où se croisent la trop rare Irène Jacob et surtout Sandrine Bonnaire (alias le plus beau sourire du cinéma français !). La beauté à peine croyable de ces Alpes hors du temps – jamais Lelouch n’avait aussi bien mis un décor en valeur – noie la première moitié du film dans un cocon chaleureux, où les tics récurrents du cinéaste se font tous petits et où même la bande-son Nostalgie fait du bien aux tympans – on préfèrera toujours Georges Moustaki à Nicole Croisille ! À ce stade, on regarde le film comme on s’allongerait sur une chaise longue en observant un beau paysage, apaisé et heureux de voir la beauté surgir de tous les côtés. Mais comme le bonheur et le malheur sont faits pour être alternés chez Lelouch, la joie ne va pas durer. Dès que le récit rédempteur et chaleureux lorgne brutalement vers le mélodrame à mi-parcours et vers le polar au détour d’un flashback, un autre film semble démarrer. Ce serait être de mauvaise foi que de dire qu’on n’avait pas envisagé un tel revirement narratif, qui plus est avec cet art de la cassure temporelle et de la rupture de ton qui ne cesse d’amuser Lelouch au plus haut point.
Même en étant plus mesuré dans sa mise en scène, le cinéaste continue de se faire marionnettiste de nos émotions, peut-être de façon un peu maladroite : on n’a rien contre son envie de laisser son spectateur en état de choc avec une scène tragique à mi-parcours, mais on peut trouver un chouïa malhonnête qu’il ait choisi ensuite de le rassurer au travers d’une résolution polardeuse pas fondamentale pour un sou. Tout ça pour finir avec une touchante réunion de famille où le partage d’un joint chez les jeunes générations devient autant un signe de fraternité qu’un gage de paix retrouvée. En somme, Lelouch nous touche d’abord au cœur, nous le frappe violemment ensuite, et ressort enfin sa pommade de bons sentiments afin de ne surtout pas faire triompher ceux qui grincent. Ce genre de yo-yo émotionnel aurait pu nous irriter, mais le cinéaste sait encore viser juste sur notre rapport d’identification aux êtres pour que l’on quitte la projection sur un petit nuage. Salaud, va. Mais on t’aime quand même.

UN + UNE
France – 2015 – 1h54
Le cinéma de Claude Lelouch peut-il facilement s’acclimater au public d’aujourd’hui ? Pas facile d’y répondre. Auréolé mine de rien d’un joli succès critique et public à sa sortie en salles, Un + Une a le mérite de nous poser un cas de conscience. Incontestablement, lorsque Lelouch revient aux bases de son cinéma et choisit la simplicité pour ses jeux gigognes avec le spectateur, on peut considérer qu’il est au meilleur de sa forme – Roman de gare l’a bien prouvé. Et à l’inverse, lorsqu’il décline à nouveau son thème fétiche – la rencontre amoureuse – avec une autre structure éclatée qu’il s’agit de reconstituer, on peut supposer qu’il se répète. Pour les fans comme pour les néophytes, ce nouveau film risque de susciter l’agacement au premier visionnage : les uns auront envie de ricaner, les autres auront juste l’impression de subir un remake d’Un homme qui me plait, film inégal mais culte que Jean Dujardin se repasse tous les six mois, et qui dévoile un coup de foudre dans un pays étranger entre deux êtres déjà mariés. Or, plutôt qu’une redite, on parlera surtout d’une refonte. En y intégrant une trame romanesque dans une Inde filmée comme un terreau de spiritualité, Lelouch répare à peu près tout ce qui clochait dans le trip US du tandem Belmondo/Girardot. Avec un angle salutaire : tout est ici affaire de croyance, fort heureusement sans le caractère sentencieux et limite sectaire que pouvait avoir La Belle Histoire.
Au début, comme il en a l’habitude, Lelouch superpose trois débuts d’intrigue sans les relier très clairement, histoire que le spectateur se sente alors acteur du film et relie les blocs. Des blocs qui, a priori, peuvent sembler disparates : quel rapport entre un coup de foudre à la suite d’un vol de bijoux en Inde, un documentaire sur la figure spirituelle Mata Amritanandamayi (alias « Amma » – revoir Darshan de Jan Kounen pour en savoir plus) et une rencontre amoureuse entre un compositeur de musique et l’épouse de l’ambassadeur français en Inde ? Lelouch compose tout cela à la façon d’une peinture cubiste, où tout est perpétuellement mis en abyme (une histoire dans une histoire, un film dans un film, un rêve dans une réalité), et dont la force naît du recalcul incessant des possibilités. Ne pas chercher plus loin la signification du titre : une simple formule avec « zéro » ou « deux » comme réponses possibles, reliant le coup de foudre au concept d’équation. Le tout est donc ici de trouver l’inconnu(e) au gré des hasards de la vie. Ce que Lelouch réussit à incarner par une réalisation encore plus fluide et énergique qu’avant, laissant croire par l’efficacité de son découpage qu’il a su rajeunir à force de vieillir. A moins que, histoire d’aller dans le sens de ce qu’il ne cesse d’affirmer, il lui fallait se tester à travers plusieurs films pour aboutir à un film qui puisse sembler à ce point aussi équilibré que ne l’était déjà Roman de gare. Sans parler du fait que recevoir le darshan d’Amma un an plus tôt a dû jouer un rôle déterminant dans la façon dont il réussit à filmer l’Inde comme une pure terre de miracles. Là où tout – même la plus ridicule des assertions – peut tout à coup sonner juste.
Plus « figures libres » que jamais, les rires réciproques – et surtout les œillades charnelles – entre Jean Dujardin et Elsa Zylberstein n’ont ici rien de chiqué. Le premier paraît sans cesse déstabilisé en inconnu pragmatique largué dans un pays gorgé de spiritualité, tandis que la seconde se la joue mystique à deux balles avec ses explications sur tout et son contraire (l’amour, le cosmos, la spiritualité, l’eau du Gange, les étreintes, les hirondelles, les PTT, les boomerangs, etc…). Ce que vivent ici les deux amoureux est une mutation intérieure qui se vit – et qui se voit – en temps réel, déclinée par la même occasion sur certains seconds rôles (dont un Christophe Lambert pour le moins désarmant avec sa voix cassée). La mise en scène de Lelouch, elle, est ici le sortilège qui recompose le miracle visualisé de la rencontre jusqu’à nous le faire partager – bon courage pour ne pas frémir d’émotions devant le dernier quart d’heure. En allant en Inde pour y affiner sa légèreté romanesque sur les uns et les autres, Lelouch prouve que les miracles, ça existe. Si tant est que l’on daigne accepter une fois pour toutes que le cinéma est plus que jamais un lieu de croyance…

CHACUN SA VIE
France – 2017 – 1h53
L’existence selon Lelouch a toujours gardé la même définition : une vaste valse de destins qui, circonscrits dans une narration brisée qui les isole autant qu’elle les fait bouillir, en viennent à incarner un vrai puzzle de vie(s), improbable et familier, foutraque et cohérent, délirant et tragique, à l’image de ce Rubik’s Cube qui prend place sur l’affiche. Cette suite de probabilités devient un pur jeu de combinaisons dans Chacun sa vie, opus d’une grande légèreté et dépourvu de toute prétention, où tout se résume à cette assertion d’Eric Dupont-Moretti (« Aquittator » pour les intimes) qui ouvre le film : « La seule règle est celle de l’intime conviction ». Un procès est donc au cœur du récit, et une personne sera donc jugée par une dizaine de personnes – on vous laissera découvrir vous-mêmes qui est l’accusé et qui sont les jurés. Ainsi, toutes les stars qui se déversent sur l’affiche ne seront pas là pour remplir une trentaine de numéros de Vivement dimanche prochain avec Michel Drucker, mais plutôt les pièces d’un vaste jeu de société où la règle consiste à faire la part des choses avant de poser un jugement sur les uns et les autres. Mais comme la tragédie prend vite ici des allures de fourre-tout zinzin, c’est surtout le fou rire nerveux qui supplante l’émotion.
Dès l’intro où l’on passe d’une théorie d’Einstein (« Le hasard est le costume que Dieu a enfilé pour circuler incognito parmi les hommes ! ») à un concert de Johnny Hallyday (qui joue à la fois le vrai Johnny et son sosie un peu timbré), on sait que la légèreté va emporter tout le film. Sans cesse sur la corde raide entre justesse et ridicule, ce Maxi Best Of lelouchien prend des proportions assez fofolles. Faisons un peu le tour : tout le casting défile à l’écran en mode Amélie Poulain (chacun récite « Mon intime conviction, c’est que… »), l’infirmier Jean-Marie Bigard circule en hoverboard dans un hôpital pour distribuer des blagues aux patients qui n’ont pas le moral (?!?), Gérard Darmon nous offre le full frontal le plus gênant de l’histoire du cinéma, Christophe Lambert joue le pochtron qui pleurniche, Julie Ferrier joue des jumelles (dont une actrice cagole avec un accent à défriser Mado la Niçoise !), le couple Lellouche/Demouy nous ramène à la grande époque de Max Pécas, plusieurs personnages sont pris de malaise au même moment sans qu’on sache pourquoi, et un best-of RMC-Nostalgie sert ici de discours philosophique (avec une Liane Foly gay-jazzy et Kendji Girac qui chante des onomatopées). N’oublions pas aussi cette overdose de considérations horoscopiques (ainsi donc, les Poissons sont patients et les Sagittaires sont impatients… ok merci) et ces dialogues « lelouchissimes » qu’on s’empressera de tester sur sa moitié en cas de lassitude (on hésite entre « On est devenus comme ces chansons qu’on adorait et qu’on ne supporte plus » et « L’amour, c’est quand la question du bon coup ne se pose plus »).
Comment diable le film peut-il fonctionner s’il franchit à ce point les limites de la drôlerie involontaire d’une scène à l’autre ? Sans doute parce que l’euphorie qu’il fait naître est transportée par une liberté narrative qui tranche avec la logique formatée de la plupart des séries télévisées, nous laissant ainsi piocher chacune des sous-intrigues un peu comme on ouvrirait une pochette-surprise. Sans doute aussi parce que le délicieux cadre ensoleillé de la ville de Beaune (où Lelouch a très récemment créé et financé une école de cinéma) participe à sa manière au charme de ce manège un peu zinzin, léger comme un bon vin de Bourgogne que l’on dégusterait entre amis à l’ombre d’un arbre en écoutant du jazz – vous visualisez ? Qu’il s’attache à laisser ses acteurs s’amuser comme des fous dans un récit (dé)composé ou qu’il fasse lui-même joujou avec ses plans-séquences, Lelouch se fait simplement plaisir. Et surtout, il n’oublie jamais son spectateur : ce dernier est ici la pièce du puzzle qui finit par éclairer l’ensemble en usant de son intime conviction. A vous de juger…

LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE
France – 2019 – 1h30
C’est évidemment LA question qu’on se pose avant même de voir le film : pourquoi une deuxième suite à Un homme et une femme ? A moins que celle-ci soit sensée effacer la précédente (Vingt ans déjà), dont le trop-plein d’éléments disparates et le caractère over-gigogne de la mise en abyme avaient en leur temps rebuté critique et public ? On penche très vite pour la seconde option, tant Les plus belles années d’une vie nous font sentir un Lelouch désireux de corriger le tir et de conclure sa plus célèbre romance de cinéma en bonne et due forme. Et surtout, nous sommes face à un film simple, très simple, presque trop simple. Des retrouvailles, voilà tout, entre Anne Gauthier (Anouk Aimée) et Jean-Louis Duroc (Jean-Louis Trintignant), séparés depuis bien trop longtemps en raison du statut de « coureur tout court » de cet ancien coureur automobile. Si la première accepte de rendre visite au second, c’est sous l’impulsion du fils de ce dernier : Jean-Louis végète dans une luxueuse maison de retraite et perd de plus en plus la mémoire. La présence d’Anne – dont il ne cesse pourtant de parler – sera-t-elle le déclic du ré-enclenchement d’une histoire d’amour qui, au fond, n’avait jamais vraiment pris fin ? Puisqu’on est chez Lelouch, vous connaissez déjà la réponse…
S’il y a bien un dialogue que l’on garde en tête, c’est bien celui qui clôture le film : « C’est drôle, j’ai l’impression d’avoir déjà vu cela… – C’est normal, tu n’arrêtes pas de rêver ! ». De qui parle-t-on alors ? Du personnage joué par Trintignant, de Trintignant lui-même ou de Lelouch ? Les trois à la fois, bien sûr. C’est moins d’amour que de mémoire dont il est principalement question ici. Dans ce récit linéaire et malicieux qui manipule à loisir notre suspension d’incrédulité pour obéir à la logique du rêve et de la flânerie. Dans ces dialogues un tantinet plombants qui se jouent souvent de l’idée même d’évolution pour au contraire s’en tenir à ressasser les mêmes mots, les mêmes motifs, les mêmes souvenirs, les mêmes poèmes (on cite beaucoup Boris Vian et Jacques Prévert), les mêmes morceaux de musique (Nicole Croisille persiste, Calogero s’invite, un candidat strabique de The Voice s’offre cinq secondes de gloire, etc…), un peu comme une chanson qui revient sans cesse au refrain entre chaque nouveau couplet – le film a d’ailleurs cette musicalité-là. Dans cette mise en scène si caractéristique de la patte lelouchienne, où gros plans fixes et plans-séquences, souvent très longs, donnent l’impression que le temps s’est arrêté – le récit démarre sur le long regard pénétrant d’un Trintignant égaré qui ne trouve ni ses mots ni ses souvenirs. Dans ce choix casse-gueule d’intégrer de longs extraits d’Un homme et une femme dans son montage – histoire d’enfoncer le clou du film mémoriel – et d’aller même jusqu’à revisiter à sa sauce l’intégralité du court-métrage C’est un rendez-vous en guise de bouquet final.
C’est ce dernier point qui affaiblit l’ambition modeste et minimale de Lelouch. Certes, le cinéaste n’est pas le premier à avoir tenté cela : après tout, avec L’amour en fuite en 1979, François Truffaut avait fait de même vis-à-vis du personnage d’Antoine Doinel. Mais on a trop souvent l’impression d’assister à un film peu autonome et trop dépendant du passé pour pouvoir exister pleinement – c’était déjà le reproche principal que l’on faisait à l’inégal Ces amours-là. D’un autre côté, ce parti pris offre à Lelouch de se mettre lui-même sur un pied d’égalité avec son acteur principal (on sent bien que les deux se rapprochent de la fin), de fusionner deux trajectoires qui se rejoignent par effet de superposition, et ainsi de boucler la boucle de leurs carrières respectives – lesquelles avaient soudain pris leur envol en 1966. Il est donc évident que l’on ne sortira pas de là bouleversé, encore moins les larmes aux yeux, mais que l’émotion sera au rendez-vous chez quiconque ne présente pas d’allergie trop prononcée à la nostalgie. Et comme un film « terminal » se fait toujours plus émouvant lorsqu’il évite de trop s’encombrer du superflu, on décoche un vrai et beau sourire en voyant un grand acteur et un grand cinéaste tirer ainsi leur révérence, main dans la main, face à leur public. Avec, au centre de leur obsession, cette femme qui a changé la vie de l’un (dans la fiction) et lancé la carrière de l’autre (dans la réalité).

LA VERTU DES IMPONDERABLES
France – 2019 – 1h24
L’affaire avait fait du bruit : en janvier 2018, Claude Lelouch se faisait voler le scénario d’un nouveau film intitulé Oui et Non, et, convaincu que la douceur de l’inespéré succède toujours à la brutalité de l’imprévu, choisissait de tirer profit d’un événement spontané en accouchant d’un film spontané. Rien de surprenant pour quiconque s’est déjà familiarisé avec la mécanique lelouchienne. Même la recette gagnante de Chacun sa vie semble se reproduire : encore un tournage à Beaune avec le concours d’étudiants en cinéma, et qui déroule une intrigue chorale qui fait s’entrecroiser plusieurs histoires intimes sur fond d’une fête des vendanges et d’un festival de jazz. On ne s’attendait pas à ce que ce nouveau film en soit l’exact négatif. Malgré une pandémie du Covid-19 érigée en cause officielle, on miserait plusieurs jetons sur l’impossibilité d’un tel film à trouver le chemin des salles. La raison est double. D’abord cette mauvaise idée de Lelouch d’avoir opté pour un tournage à l’iPhone : se sentir libéré de toute la machinerie d’usage ne le prive pas pour autant de livrer les plans les plus hideux et les moins travaillés de sa carrière – même les derniers films fauchés de Jean-Pierre Mocky ont plus de gueule ! Ensuite, il y a l’idée centrale du projet qui coince d’entrée au détour d’un extrait de la chanson-titre : « Tout est compliqué avant d’être simple ». Il n’est pas commun qu’un film de Lelouch paraisse pénible en raison de sa simplicité, et c’est surtout parce que cette dernière n’est qu’un simplisme mal déguisé. De ce fait, le titre est une arnaque : c’est le pondérable qui mène la danse et c’est la vertu qui joue du pipeau durant 1h24.
Déjà, il faut vraiment que Lelouch arrête de caser le titre de son film toutes les deux minutes dans la narration (dialogue, chanson, nom de livre, émission de radio…), surtout quand celui-ci sonne aussi littéraire et pompeux en matière d’intention. La propension du bonhomme à convertir un propos prémâché à l’échelle d’une chanson entière ne s’est pas non plus évaporée : non seulement celle-ci tourne ici en boucle jusqu’à nous dégoûter d’aimer le jazz (on a envie de fuir quand le karaoké final démarre), mais elle rabaisse le cinéaste en donneur de leçons imposant à autrui ce qu’il faut dire, croire ou penser. Que Lelouch laisse au public et à la critique le soin de déduire subjectivement le sens du récit, sous peine de récolter le désintérêt de l’un et la colère de l’autre. Au vu de tout ça, La Vertu des impondérables a pour seul exploit d’amplifier la malédiction des Parisiens, laquelle se répercute sur le casting. Pour un Stéphane de Groodt qui apprivoise naturellement les figures libres propres à Lelouch et qui offre au film sa seule bonne scène (celle de l’aire d’autoroute), les autres déroulent le champ lexical de la déconfiture. Béatrice Dalle n’a rien à défendre, Marianne Denicourt pleure sur un canapé et disserte sur les truites, Elsa Zylberstein singe l’hystérie carabinée, Ary Abittan se tape une serveuse avant de disparaître dans une voiture piégée (!) et Philippe Lellouche joue toujours comme s’il revenait du bar d’à côté. Quant aux Franglaises, on sent que Lelouch a eu envie de transformer Beaune en mini-Rochefort avec leur complicité, allant même jusqu’à citer oralement le film de Jacques Demy (au cas où l’on serait trop bête !). Sauf que sa fanfare de zinzins enfile les sourires figés et les yeux écarquillés comme des perles, beuglant non-stop des aphorismes plus lourdauds et grandiloquents tu meurs.
D’aucuns n’ont pas hésité à voir dans La Vertu des impondérables le plus ophülsien des films de Lelouch – comme s’il y avait de la Ronde et du Plaisir là-dedans ! – ou d’y dénicher un rapport évident avec la théorie du « Chacun a ses raisons » si chère à Jean Renoir. On imagine que ceux-ci ne sont pas allés bien loin dans leur exploration de la filmo lelouchienne : fuir le manichéisme et filmer la complexité des êtres sont des données acquises chez lui depuis des décennies ! Et pour les habitués que nous sommes, voir une telle mécanique déclinée sous la forme d’un tricotage choral aussi lâche a quelque chose d’affligeant. Zéro ampleur ici, la faute à des enjeux éparpillés dont les jointures se devinent toujours avec un coup d’avance : un vol de voiture, deux disputes conjugales, un coup de foudre, un orchestre en quête de succès, une patronne de bar en garde à vue, un attentat qui n’en est finalement pas un, etc… Tout ça pour aboutir à quoi, au final ? Au fait qu’une femme trompée aura enfin son mec pour elle toute seule en allant se recueillir sur sa tombe au cimetière, qu’une troupe musicale aura une maison de disques pour la seule raison qu’elle a vécu un traumatisme médiatisé, et qu’une romancière s’étant fait voler son manuscrit va réussir à réinventer son écriture et sa propre vie suite à cet impondérable. Bien sûr, un livre sera écrit à partir de cette histoire « incroyable ». Bien sûr, il portera le nom de cette chanson jugée « prémonitoire » par la radio, les musiciens, les clochards, les policiers, les pécheurs, les intellos et ma femme de ménage. Et bien sûr, il finira sous la forme d’un film projeté au cinéma et réalisé par on sait qui, le tout pour rendre hommage aux victimes des malheurs de la vie. Hé ben…
2020

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
France – 2021 – 1h55
Une rumeur insistante laissait entendre que ce « 50ème film de Claude Lelouch » serait bel et bien le dernier. Sauf que non. D’abord, ce n’est pas le 50ème (désolé Claude, mais La Femme spectacle et tes deux films détruits, ça compte !), mais surtout, cet indécrottable optimiste de la vie annonce d’entrée qu’il s’agit du premier épisode d’une trilogie. Visiblement, la méga-gifle des Parisiens n’a pas servi de leçon. A vrai dire, on supplie déjà le « gars du dessus » (le producteur fils de Serge Dassault, pas l’autre !) d’arrêter les frais dès maintenant. Que dire encore du Lelouch feignasse qui n’ait déjà été furieusement surligné au Stabilo sur certaines étapes décevantes de cette rétrospective ? Qu’il est passé du brillant auteur en pleine maîtrise de ses figures libres et de l’inconscient des êtres au vieux papy gâteux qui tourne en rond dans son manège de la rodomontade pédante. Qu’il dirige désormais ses acteurs comme on bourre sa poubelle – ils sont là juste pour faire péter une affiche. Qu’il a perdu sa magie narrative et sa confiance dans le récit qui nous faisaient parfois avaler les concepts les plus kamikazes – même La Belle Histoire serait gage de prix Nobel en comparaison. Et surtout qu’ON N’EN PEUT PLUS de ces aphorismes même pas dignes d’un fortune cookie, débités à tire-larigot dans des chansons consternantes où l’excès de prêchi-prêcha a le chic pour réveiller en nous des pulsions enfouies de nihilisme. Sans parler du pire : le titre, qui fera inévitablement tilt chez ceux qui ont encore Les Parisiens en tête. Non seulement il ne veut rien dire (parce que si aimer c’est mieux que vivre, comment fait-on pour aimer si on est mort ?!?), mais on n’a même pas réussi à recenser le nombre incalculable de fois où on l’entend – on a baissé les bras à mi-parcours…
Vu qu’attente il y avait, lâchons-la : un chant du cygne digne d’une synthèse (au mieux) ou d’un best-of (au pire). En un sens, c’est le cas, car Lelouch, ici clairement amoureux de lui-même avant de fantasmer sur la vie, tombe tête la première dans le piège fatal de l’autocitation. Le film dialogue ainsi avec sa filmo, osant la suite détournée de L’aventure c’est l’aventure et de La Bonne Année (Sandrine Bonnaire a ici un lien de parenté avec Lino Ventura) ou filmant un Robert Hossein sorti de l’Ehpad qui replonge dans le souvenir des Uns et les Autres (le mariage avec Nicole Garcia, le Boléro de Ravel, etc…). A part ça, il vante l’intelligence et le talent littéraire de sa compagne Valérie Perrin au détour d’une réplique (mais comme on sait que c’est elle qui écrit les dialogues…), et s’en remet à un énième pitch vite fait mal fait sur l’amitié entre trois repentis qui voient dans l’honnêteté la meilleure combine qui soit (attention, un autre clin d’œil !). Autour d’eux, on a un confinement qui pointe à l’horizon, des policiers qui chouinent sur leur brutalité envers les gilets jaunes, un jeune boxeur qui se dispute avec sa compagne, et surtout la patronne d’une boîte d’escort-girls qui se fait payer pour aimer un vieux cancéreux – ce qui nous vaut de splendides théories sur la prostitution. Et comme Lelouch a encore de temps en temps quelques rechutes de ravi de la crèche, il se la joue béni-oui-oui avec la métaphysique de bazar en mouillant Jésus dans son arnaque ! Ce qui nous vaut des scènes à peine croyables où ce dernier, quand il ne se fait pas interroger par un duo de flics en ayant la tête d’Elsa Zylberstein (no comment, par pitié…), hante les rues de Paris en faisant un micro-trottoir avec le sourire niais de Francis Lalanne ou en bossant bénévolement au SAMU pour remettre les mourants sur pied… Voilà, voilà… Et sinon, vous, ça va ?
Même si son script vaniteux et son amateurisme visuel en faisaient presque le pire film de Lelouch, La Vertu des impondérables nous apparaît désormais comme le signal d’alerte d’une mauvaise passe chez un cinéaste qui aurait tout à gagner à prendre sa retraite. Alors, certes, ce nouveau film ne tombe pas aussi bas en raison d’une finition plus affirmée question mise en scène et de quelques petits zestes de grâce qui, on le sait, nous font toujours sortir d’un mauvais Lelouch avec quelque chose à sauver. Outre un générique qui nous offre un tour du monde en cinq minutes (merci), c’est du côté du casting que la défense peut trouver du grain à moudre. On aurait pu croire que mettre Ary Abittan et Kev Adams dans le même film – voire dans la même scène – serait une promesse de calvaire, mais, double miracle, le premier réussit à être drôle en jouant le dragueur cochon (ah, les hasards et coïncidences de l’actualité judiciaire !) et le second arrive enfin à muscler son jeu (dans tous les sens du terme). On a aussi le « killer smile » de Sandrine Bonnaire qui intervient neuf fois sur dix – ça aide pas mal. Et surtout Béatrice Dalle qui, fringuée en zombie du Père Lachaise, nous offre ici son interprétation toute personnelle de la Grande Faucheuse. C’est d’ailleurs à notre madone punk préférée que l’on doit la seule et unique porte de sortie pour fuir ce cauchemar. Déjà qu’entendre Bonnaire et Darmon multiplier ad nauseam les « Je t’aime » nous aura dégoûté à vie de réentendre ces deux mots, mais à la fin, le temps d’un horripilant climax jazzy où tout le monde doit chanter non-stop le titre du film (oh que oui, vous allez serrer les dents…), voilà que Béa a soudain la Dalle, balançant un très cinglant « Dégage ! » au simili-Pascal Sevran qui lui tend le micro ! De quoi justifier cet autre aphorisme que ce navet valide à son corps défendant : la mort, c’est mieux que l’ennui. Est-ce là une intime conviction ? Oui, non, on s’en fout. Allons plutôt vivre, ça vaudra mieux…

2 Comments
Cette rétrospective en plus d’être un travail monumental est passionnante, d’une densité incroyable et mérite que l’on s’y attarde. C’est donc décennie par décennie que s’est portée ma lecture et se poursuivront mes relectures pleines de curiosité et d’intérêt. D’autant que je connais peu d’œuvres (une quinzaine environ) dans cette si vaste filmographie. C’est avec attention et avec passion que je vais relire ces chapitres où l’on suit la mise en parallèle entre l’évolution d’un style et la vie d’un cinéaste souvent contesté, à tort ou parfois à raison, mais talentueux et incompris. Je continue donc mon voyage avec Lelouch chapitre par chapitre.
Merci Mr LELOUCH….pour vos Merveilleux films et celui qui m a touché au fond ..itinéraire d un ….