
REALISATION : Walter Hill, Jack Sholder, Francis Ford Coppola
PRODUCTION : Hammerhead Productions, Metro-Goldwyn-Mayer, Screenland Pictures, United Artists
AVEC : James Spader, Angela Bassett, Peter Facinelli, Lou Diamond Phillips, Robin Tunney, Robert Forster, Wilson Cruz, Eddy Rice Jr, Knox White, Vanessa Marshall
SCENARIO : William Malone, David C. Wilson, Daniel Chuba
PHOTOGRAPHIE : Lloyd Ahern
MONTAGE : Melissa Kent, Michael Schweitzer, Francis Ford Coppola
BANDE ORIGINALE : David C. Williams
ORIGINE : Etats-Unis, Suisse
GENRE : Fantastique, Science-fiction, Thriller
DATE DE SORTIE : 6 septembre 2000
DUREE : 1h30
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Aux confins les plus reculés de l’univers, le vaisseau spatial médical Nightingale effectue une mission de routine. Répondant à un signal de détresse, l’équipe décide de faire un saut périlleux dans l’hyper-espace, mais le vaisseau se retrouve alors au milieu d’un orage magnétique provoqué par une étoile sur le point d’exploser, avec un autre vaisseau à la dérive dans la même situation. Après avoir recueilli un énigmatique survivant, l’équipage se retrouve face à un double défi : d’abord trouver un moyen de retourner dans notre galaxie avant que l’étoile ne se transforme en supernova, mais aussi faire face à un étrange artefact alien…
C’est toujours très simple de pratiquer l’invective sur un film jugé raté. Ça l’est tout de suite beaucoup moins lorsque le film en question conserve les miettes d’un beau destin qui aurait pu être le sien. Nous y voilà avec le film maudit de Walter Hill…
Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas tant un film qu’un studio dont on va se payer la tête. Déroulons le tapis rouge de la honte à l’autrefois prestigieuse Metro-Goldwyn-Mayer (ou MGM), amatrice de brainstormings foireux que de jeunes technocrates médaillés d’or en ingérence et accros aux études de marché imposent pour rendre leurs projets sexy et accessibles aux yeux d’une cible aussi décervelée qu’eux. A peine un an avant de massacrer le Rollerball de John McTiernan, la firme au « lion qui rugit » (ce n’est hélas plus qu’une image…) avait frappé très fort avec Supernova. Flash-back. Au départ, un simple script de série B futuriste intitulé Dead Star, écrit en 1990 par William Malone (futur réalisateur de La Maison de l’horreur) et envisagé comme un survival spatial qui confronterait un équipage d’astronautes à un dangereux artefact alien. Une fois acheté par MGM, le scénario fut réécrit à dix mains pendant des années pour être finalement remanié en une intrigue relativement similaire (lire le synopsis plus haut). Certes producteur de la saga Alien mais peu habitué de son propre aveu à la science-fiction, Walter Hill se retrouva très vite catapulté aux commandes du projet qu’en raison du désistement du précédent réalisateur (Geoffrey Wright) et au soutien indéfectible de l’acteur James Spader. Sa vision du scénario divergeant nettement de celle du studio, il milita alors pour le réécrire. Faux espoir. Le tournage fut alors lancé à toute vitesse sans réfléchir, laissant Hill se dépatouiller avec un matériau inachevé, un budget autant réduit de moitié que le nombre de CGI, et une épuration considérable des scènes les plus fortes. Au terme d’un tournage galère, le studio se tira lui-même une balle dans le pied en testant la copie de travail sur le public alors même que celle-ci, en plus d’être un brouillon incohérent, ne contenait aucun plan d’effets spéciaux ! Verdict : la cata. Ses demandes de réécriture et de rallonge budgétaire ayant fini par tomber dans l’oreille d’un sourd, Hill claqua la porte. Premier signe de la catastrophe à venir…

Aussitôt après, la MGM engagea le réalisateur Jack Sholder pour sauver les meubles. Certes familier de la série B efficace et inventive tel qu’on l’imagine (Hidden, c’est lui) mais aussi de celle capable de saborder une mythologie existante par un goût de l’outrance carabinée (La Revanche de Freddy, c’est lui aussi), le bougre s’empressa alors de bidouiller le script de toutes parts, d’atténuer le sérieux du propos au profit d’un humour très bas de plafond, et de remplacer la bande-son électro-rock initialement voulue par Hill par une partition plus conventionnelle de David C. Williams. Bien que mieux accueilli lors d’une nouvelle projection-test, ce nouveau montage n’empêcha pas le studio de tirer à nouveau la tronche, et pour cause : le jeu des « sièges éjectables » étant alors en place au sein de la direction de MGM et d’United Artists, les nouveaux dirigeants s’empressèrent de mettre le film en veilleuse. Quelques mois plus tard, ce fut alors l’immense Francis Ford Coppola qui récupéra la patate chaude, sollicité par MGM pour retravailler le film au sein de son studio Zoetrope contre un gros chèque. Quelques efforts méritants de l’immense cinéaste d’Apocalypse Now furent menés ici et là pour réagencer le montage selon les souhaits initiaux de Walter Hill, mais le désastre d’une troisième projection-test brisa tous les espoirs. Sonné pour de bon par ce coup fatal, le studio baissa alors les bras et se résigna à sortir le film en salle avec deux ans de retard. La critique, déjà très au fait de ses galères de fabrication, lui tailla un bonnet d’âne sur mesure, et le public ne se précipita même pas pour prendre acte du carnage. Walter Hill, de son côté, eut si honte du résultat qu’il le signa du prête-nom Thomas Lee (Alan Smithee étant désormais trop identifiable). Vu l’historique de la chose, on le comprend. Cela dit, tout pété de thunes qu’il soit, le résultat final ne mérite peut-être pas d’être éjecté fissa dans le vide intersidéral…

Supernova nous renvoie pour ainsi dire à une position délicate pour le critique : faire face à un projet ambitieux qui, pour cause d’égarement de ses créateurs en cours de route, n’a pu aboutir qu’à un résultat au mieux handicapé, au pire charcuté. Certes, les cicatrices se voient comme le nez au milieu de la figure si l’on prend la chose sans un minimum de distance. Le scénario, d’abord, parlons-en. Même si le spectre d’Alien se faisait sentir dès la lecture du synopsis, on pense davantage au vrai inspirateur du chef-d’œuvre de Ridley Scott, à savoir La Planète des Vampires de Mario Bava. Le space-opera selon Walter Hill n’en donne ici qu’une pâle redite, plaçant l’équipage d’un vaisseau spatial face à une menace extraterrestre qui les élimine en attendant que l’univers tout entier soit à sa portée. Double menace, en l’occurrence : d’abord un artefact alien au look de lampe rose fluo (du genre qu’on trouve à Ikea pour pas cher), ensuite un vilain bellâtre à rictus (Peter Facinelli, mauvais comme un cochon) qui devient son ange exterminateur à mesure que sa masse musculaire grossit – imaginez un des New Kids on the Block qui se changerait lentement en Hulk. Heureusement, en guise de survivants d’un survival qui avance trop vite, James Spader et Angela Bassett réussissent à détruire la menace. A première vue, c’est tout ce qu’il y a à retenir de ce script tartignole, aux pistes narratives à peine ébauchées et aux partis pris plus zarbis que la moyenne. On sourit de voir la caméra tanguer de droite à gauche durant les scènes d’intérieurs, comme si la stabilité dans un vaisseau spatial s’apparentait à celle d’un chalutier en plein océan. On s’atterre devant le montage brouillon des rares scènes d’action, en particulier cette tentative d’assassinat du protagoniste par des engins téléguidés (dont un qui ressemble davantage à une pince à glaçons géante qu’à l’arme menaçante qu’elle devrait être). On se marre à la vision d’un robot d’entretien qui peine à cacher la présence d’un acteur sous son costume de soldat de la guerre de 14-18 (no comment, please…). Et on ne gamberge pas bien longtemps sur l’origine d’un tel sabrage narratif : cette trame aux enjeux sacrifiés n’était sans doute que le squelette d’un survival potentiellement riche dont on a choisi d’ôter tous les organes, histoire d’en faciliter l’accès à un public considéré à tort comme trépané.




Le jeu de mot « supernavet » a été fait trop souvent au moment de la sortie du film pour qu’on soit tenté de le ressortir. Mais à vrai dire, ce n’est pas qu’on se retient de le faire. C’est plutôt qu’on n’en a pas envie. On n’arrive pas à détester Supernova. On regrette même de citer ses défauts, et pas par simple empathie envers son infernale gestation. On a envie de l’aimer parce qu’en jouant un minimum les archéologues de l’image et du montage, on devine ce qu’il aurait pu être. Soit un vrai space-opera, à la fois bizarre, mystique et astrophysicien, où les théories sur le mouvement perpétuel de l’univers se mêleraient à une symbolique barrée sur le cycle de la vie. Dans les faits, les pistes non développées par le film ont laissé traîner des traces que l’on s’empresse de suivre comme le Petit Poucet avec ses cailloux. Déjà cette fameuse matière alien à neuf dimensions, dont le contact avec un univers tridimensionnel serait censé provoquer la naissance d’une nouvelle matière en trois dimensions. Une « bombe », donc ? Disons plutôt une explosion pouvant reconstituer les éléments essentiels à la vie, un peu comme si notre univers en constante expansion était sans cesse rajeuni par une recréation de la matière. Il y a là une analogie directe avec l’effet d’une « supernova » : outre le fait de désigner la mort d’une étoile dans une explosion de matière lumineuse, ce terme évoque surtout l’onde de choc qui la suit, propageant dans toutes les directions tous les éléments chimiques que l’étoile a synthétisé durant son existence (ce qui peut ainsi donner vie à de nouvelles étoiles). Plus jeune et plus puissant à mesure que le récit progresse, l’antagoniste du film incarne donc cette logique scientifique assimilée à une menace, d’autant que l’une de ses répliques se passe de commentaires (« Les étoiles meurent pour que nous puissions vivre et nous mourons pour que les étoiles puissent renaître »). Le visuel va même jusqu’à lui emboîter le pas de par l’intemporalité des effets spéciaux et de la production design : les premiers dissolvent le temps (scène épileptique du saut dans l’hyperespace) tandis que la seconde concentre en son sein la plupart des esthétiques de la SF au cinéma (l’équilibre entre kitsch et modernité est assez optimal).


En outre, si l’on peut s’étonner au premier abord de voir autant d’érotisme dans un survival de science-fiction, en particulier quand il s’agit d’exhiber plein cadre des torses musclés, des fessiers galbés et des seins aiguisés, le spectre d’une série rose spatiale pour dimanche soir de W9 s’estompe vite si l’on active la lecture symbolique. Des preuves ? Les ébats répétés entre Robin Tunney et Lou Diamond Philips sont motivés par un désir d’enfantement. Une discussion entre Spader et Bassett sur la façon de faire rentrer une poire dans une bouteille d’alcool est un moyen détourné pour évoquer l’incubation. La mort d’un des membres de l’équipage est cadrée de manière à ce que son cadavre, éjecté dans le vide spatial en direction d’une étoile, soit presque comme un spermatozoïde qui s’apprêterait à rejoindre un ovule pour activer une naissance. Quant à la scène finale (celle que Coppola aura imposé dans le montage définitif), elle amorce l’idée d’une fusion génético-sexuelle des deux héros à la suite d’un saut commun dans l’hyperespace, et ce alors même que la Terre est d’ores et déjà condamnée par les retombées de la supernova d’ici 51 ans (cela détruira-t-il l’espèce humaine ou donnera-t-il naissance à une nouvelle forme de vie ?). Tous ces questionnements métaphysiques, bien que simplifiés ou relégués au stade embryonnaire, restent implicitement suggérés dans le film, parfois au détour d’un plan ou d’une bribe de dialogue. Le montage final a beau fragiliser leur force de frappe, on perçoit une résistance. Sans doute parce que les efforts de Coppola pour servir au mieux les intentions initiales de Walter Hill ont laissé de beaux fossiles dans la charpente bisseuse taillée par Jack Sholder. Un film « trois en un », en quelque sorte, où trois intentions différentes ont fini par fusionner lors d’une malheureuse expérience et où les gènes de chacune – y compris les originaux – restent décelables pour peu qu’on passe la chose au microscope.
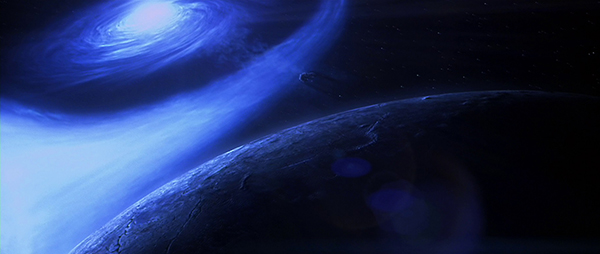
L’autre porte d’entrée pour déceler le potentiel de Supernova réside dans les scènes coupées qui figurent sur le DVD. Peu de changements sur le cœur de l’intrigue, puisque tout se résume à de légers enrichissements des enjeux. Le passé de l’astronaute incarné par James Spader – survolé à la va-vite dans le montage final – est un peu plus développé, une scène d’autopsie et une partie de ping-pong mettent en avant la mort d’un membre de l’équipage (hélas coupé au montage), l’exploration de la planète Titan 37 dévoile la rencontre entre Spader et un hideux fœtus à voix de Chipmunk (on taira sa vraie identité pour ne rien spoiler) et la mort de Lou Diamond Phillips par coup sur la tête est ici remplacée par un défonçage de crâne bien gore. Toutefois, le plus intéressant réside dans les deux extrémités du récit. D’abord un beau début alternatif autour du capitaine joué par Robert Forster : son monologue à haute teneur métaphysique sur la nature de l’espace (« Un chaos où l’absence de logique suit une logique ») tranche radicalement avec ce qu’offrait le montage cinéma, à savoir une étude des cartoons de Tom & Jerry pour expliquer la dérive de l’humanité (euh…). Ensuite une autre fin – celle envisagée dès le départ par Walter Hill – qui n’a pu être finalisée pour des raisons budgétaires, mais qui révèle le ton fataliste qui devait irriguer le climax final de Supernova. Au lieu d’annoncer une heureuse nouvelle à Angela Bassett et James Spader (en gros, un enfant), l’ordinateur de bord se faisait alors pessimiste en prenant acte de l’embrasement de toute matière tridimensionnelle – donc l’univers entier – comme seul moyen de mettre fin à la supernova. Cela condamnait ainsi la Terre à une destruction future, tandis que la voix off de Spader sonnait comme une mise en garde à faire flipper tous ceux qui s’imaginent rassurés en regardant les étoiles briller dans le ciel. Le film a fini par rejoindre son propre sujet : il n’a pas survécu, sa forme rêvée n’existe pas, mais les miettes de celle-ci persistent et brillent en tant que poussières d’étoiles au cœur d’un brouillon chaotique. Du coup, plutôt que de se plaindre d’un film raté, on préférera parler d’un film qui aurait pu être mieux.

