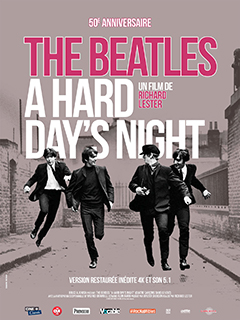
REALISATION : Richard Lester
PRODUCTION : Walter Shenson Films, Maljack Productions, Mars Distribution
AVEC : Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, Wilfrid Brambell, Norman Rossington…
SCENARIO : Alun Owen
PHOTOGRAPHIE : Gilbert Taylor
MONTAGE : John Jympson
BANDE ORIGINALE : Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, George Martin
ORIGINE : Royaume-Uni
GENRE : Comédie, Film musical
DATE DE SORTIE : 11 août 1964
DUREE : 1h28
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Alors que la Beatlemania fait rage en Angleterre, John, Paul, George et Ringo sont attendus à Londres pour jouer dans une émission de télévision. Pour arriver aux studios, ils vont devoir affronter tout un tas d’obstacles : des hordes de fans hystériques, le grand-père de Paul toujours prompt à semer la zizanie, et leur manager Norm qui tient à ce que les Beatles lui obéissent au doigt et à l’œil. Mais ces derniers ne l’entendent pas de la même oreille…
C’est tout simplement une question d’alchimie. Pour savourer comme il se doit cette pépite ciné des années 60, pas la peine d’être un fan hystérique des Fab Four, de connaître leurs tubes encore mieux que son numéro de carte bancaire ou d’avoir niqué les murs de son appartement pour y poinçonner des posters de John Lennon. Parce que tout le charme de la première expérience ciné des Beatles vient de son apparence de film volatil, à la fois scénarisé et improvisé, tourné en temps réel en compagnie d’une bande de joyeux drilles qui font un peu tout et n’importe quoi pendant une heure et demie. C’est en tout cas ce qui devait motiver le réalisateur Richard Lester en 1964, lors de sa rencontre avec un curieux boys band britannique dont l’ascension fulgurante déchaînait les passions au sein de la communauté rock. Et afin d’apprivoiser un peu mieux la « Beatlemania », quoi de mieux que de suivre les quatre chanteurs pendant trois jours d’une de leurs tournées ? Le voilà qui se retrouve à la tête d’une curieuse commande, mélange assumé de comédie totale et de film musical, centré sur les péripéties des Beatles durant leur quotidien de stars. Un quotidien tout ce qu’il y a de plus prévisible : échapper à des jeunes filles qui se déchirent les cordes vocales à leur seule vue, donner un concert à la télévision, investir une soirée huppée, s’éclater en guinguette, se préparer dans une chambre d’hôtel, ne pas obéir aux ordres de leur manager bienveillant, et supporter tant que possible un intrus (en l’occurrence le grand-père cinglé de Paul McCartney) qui met le souk partout où il passe. Mini programme pour maxi plaisir.

Ne surtout pas s’attendre à voir dans A hard day’s night autre chose qu’une ballade musicale résultant d’un joyeux coup de poker, ne fonctionnant qu’au travers de la pêche de ses jeunes héros et de la magie générée par leurs chansons. Preuve en est que le titre du film reste lui-même le fruit d’un pur hasard : c’est en s’apercevant que la nuit était tombée que Ringo Starr, à la fin d’une épuisante journée d’enregistrement en studio, avait accidentellement rajouté le mot « night » après avoir dit « It was a hard day ». Un détail qui en dit long sur la créativité folle du groupe, lequel s’était alors empressé d’écrire la chanson homonyme après avoir entendu la phrase de Ringo, et qui, tout au long de ce film, n’a de cesse que de relancer les dés de l’intrigue, naviguant de cavalcades nerveuses (pour échapper aux flics ou aux fans) en discussions totalement farfelues (« Etes-vous un mod ou un rockeur ? – Plutôt un moqueur »), laissant ainsi le récit se construire tout seul par le biais d’un montage d’une énergie folle.
La grande intelligence de Richard Lester aura donc été de laisser jusqu’au bout sa mise en scène en retrait, se limitant à mettre en valeur la matière qui surgissait à chaque instant : des jeux de déguisements pour draguer les filles ou narguer les passagers d’un train, un petit rasage improvisé sur un reflet dans une glace de salle de bain, une enfilade de questions de journalistes à esquiver (la parade suprême de Paul : répondre toujours « Non, nous sommes juste de bons amis »), une suite de gaffes du grand-père détraqué qui va donner du fil à retordre au groupe, ainsi qu’une myriade d’apartés loufoques qui surgissent ici et là comme dans un bon vieux sketch des Monty Python. Sans parler de la musique, élixir absolu à la morosité qui procure ici une jubilation monstrueuse, tant par la mise en valeur des chansons par la caméra discrète de Richard Lester que par l’inventivité de ce dernier à intégrer les scènes chantées dans des cadres instantanément évocateurs. Il suffit de découvrir comment la poursuite inaugurale sur A hard day’s night ou la gesticulation foutraque des Beatles dans un vaste jardin sur Can’t buy me love suffisent à donner à ces deux tubes un relief inédit (les autres chansons du film ont droit au même traitement de faveur). Doit-on dès lors s’étonner que Lester soit considéré depuis la sortie de ce film comme le père du vidéoclip, titre qui lui fut par ailleurs décerné par MTV ?

Pour autant, au-delà du plaisir ressenti devant les effets du voyage, il y a un « plus », et pas n’importe lequel : celui de suivre les coulisses d’une tournée au travers de la pure énergie d’une mise en scène, et ce sans avoir à se farcir les clichés promotionnels inhérents au concept (Justin Bieber et les Spice Girls auraient dû en prendre de la graine en tournant leurs navets respectifs). L’âme des Beatles semble d’autant mieux inscrite sur l’écran qu’il est difficile de la qualifier précisément, les caractères des quatre comédiens néophytes ne cessant jamais de s’échanger d’une scène à l’autre, ce qui donne en soi une idée de leur complicité. Et c’est parce que le film fonce tête baissée sans s’autoriser la moindre chute de rythme qu’il contribue à incarner sur grand écran un imaginaire qui échappe à la logique, nourri de courants musicaux variés et de décrochages à gogo. Telle est la logique de ces quatre scarabées : n’en faire qu’à leur tête et se faire plaisir, à nous aussi tant qu’à faire. Rien de révolutionnaire dans A hard day’s night, juste un plaisir bien réel, tout sauf coupable, qui résiste encore aux affres du temps. Et pour finir, un petit gage pour les amateurs du jeu Où est Charlie ? : un figurant, totalement inconnu à l’époque, s’est faufilé parmi les spectateurs de la scène finale. Il s’appelle Phil Collins. Saurez-vous le retrouver ?
Test Blu-Ray
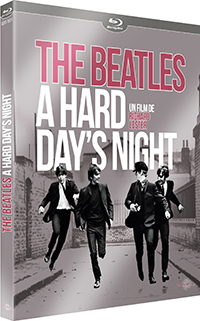 Là, ça se jouait à pile ou face : la perfection visuelle et sonore était de rigueur pour un tel film construit sur l’alchimie entre l’image et la musique. Carlotta répond à toutes les attentes grâce à un pressage HD absolument divin qui transcende les cinquante ans d’âge du film, sans parler de trois pistes DTS-HD en tous points idéales. Et du côté des suppléments, c’est juste l’euphorie : pas moins de six petits documentaires peuplent le menu, compilant un nombre si faramineux d’informations sur la conception du film qu’ils en arrivent parfois à se répéter un peu d’un module à l’autre. Chacun d’eux reste néanmoins axé sur un sujet précis. Par exemple, l’interview audio d’époque des Beatles se concentre sur leur envie de ne surtout pas livrer un film bâclé et d’être aussi crédibles que possible pour leurs débuts au cinéma. Du côté du morceau de résistance du Blu-Ray, à savoir un long making-of d’une heure où l’on croise aussi bien Phil Collins que le critique Roger Ebert, c’est toute la création du projet qui est passée au peigne fin. Le reste, entre un petit historique de l’ascension des Beatles, un retour sur la carrière de Richard Lester, une analyse hélas trop succincte du style visuel du film et quelques souvenirs de tournage évoqués lors de sa ressortie en 2002, ne démérite pas dans le désir de l’éditeur d’offrir une seconde jeunesse à l’un des films les plus cultes des années 60.
Là, ça se jouait à pile ou face : la perfection visuelle et sonore était de rigueur pour un tel film construit sur l’alchimie entre l’image et la musique. Carlotta répond à toutes les attentes grâce à un pressage HD absolument divin qui transcende les cinquante ans d’âge du film, sans parler de trois pistes DTS-HD en tous points idéales. Et du côté des suppléments, c’est juste l’euphorie : pas moins de six petits documentaires peuplent le menu, compilant un nombre si faramineux d’informations sur la conception du film qu’ils en arrivent parfois à se répéter un peu d’un module à l’autre. Chacun d’eux reste néanmoins axé sur un sujet précis. Par exemple, l’interview audio d’époque des Beatles se concentre sur leur envie de ne surtout pas livrer un film bâclé et d’être aussi crédibles que possible pour leurs débuts au cinéma. Du côté du morceau de résistance du Blu-Ray, à savoir un long making-of d’une heure où l’on croise aussi bien Phil Collins que le critique Roger Ebert, c’est toute la création du projet qui est passée au peigne fin. Le reste, entre un petit historique de l’ascension des Beatles, un retour sur la carrière de Richard Lester, une analyse hélas trop succincte du style visuel du film et quelques souvenirs de tournage évoqués lors de sa ressortie en 2002, ne démérite pas dans le désir de l’éditeur d’offrir une seconde jeunesse à l’un des films les plus cultes des années 60.
