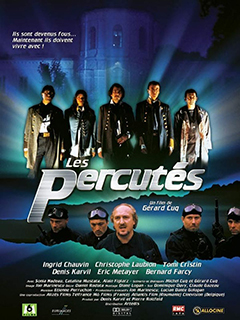
REALISATION : Gérard Cuq
PRODUCTION : Alizés Films, Artédis, Atlantis Films, Cinévision
AVEC : Christophe Laubion, Tomi Cristin, Denis Karvil, Ingrid Chauvin, Eric Métayer, Bernard Farcy, Sonia Nadeau, Catalina Mustata, Alain Figlarz, Monalisa Basarab, Vlad Ivanov
SCENARIO : Gérard Cuq, Michel Cuq
PHOTOGRAPHIE : Ion Marinescu
MONTAGE : Diane Logan
BANDE ORIGINALE : Etienne Perruchon
ORIGINE : Belgique, France, Roumanie
GENRE : Action, Comédie, Policier, Thriller
DATE DE SORTIE : 31 juillet 2002
DUREE : 1h43
BANDE-ANNONCE
Synopsis : Alors que sa carte de crédit vient d’être avalée par un distributeur, l’inspecteur Bruno Lussac, dit « Débé », franchit les limites de sa déontologie quand il apprend qu’il vient d’être interdit bancaire. Déguisé en sudiste pour une soirée costumée où il était supposé arrêter des trafiquants de drogue, il entraîne ses collègues dans le braquage d’une banque et provoque un bain de sang. Le groupe prend alors la fuite et se réfugie dans un hôpital psychiatrique, vite assiégé par le Raid. Afin de gagner du temps, ils envoient les fous négocier à leur place. Les heures passent, les malades deviennent incontrôlables, la tension monte à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Le carnage semble inévitable…
Ils étaient dans une « jungle », ils avaient trop d’armes, trop d’imprévus, trop de bruit autour d’eux, et petit à petit, ils sont tous devenus fous. On parle là des cinq protagonistes des Percutés, bien sûr, mais c’est à se demander si l’équipe du film ne serait pas visée elle aussi, et même les spectateurs par-dessus le marché ! Des films tarés qui donnent l’impression d’avoir été conçus avec le pif dans la schnouff, ce n’est pas ça qui manque chaque année si l’on se tient au jus de l’actualité cinéma. Mais des cas d’école comme celui-ci sont si rares qu’ils ont tôt fait de se transformer en cas de conscience. Peut-être de façon encore plus prononcée que le mémorable T’aime de Patrick Sébastien, le premier long-métrage de cinéma de Gérard Cuq s’imposerait presque comme LE film impossible à critiquer sérieusement. Poser des mots pour tenter de retranscrire ce qui constitue le film en tant que tel et expliquer ce qui a pu justifier son état final est une gageure que l’on se sent incapable d’accomplir, de même que l’encenser ou le vilipender pour telle ou telle raison ne servirait à rien ici. Si l’on se voulait schématique, on pourrait résumer l’affaire à un ersatz du Killing Zoe de Roger Avary, mais revu et corrigé par un Jean-Pierre Mocky qui se serait mis un peu trop de poudre blanche dans les naseaux. Or, après deux ou trois visionnages, on s’interroge : la singularité des Percutés ne résiderait-elle pas dans le fait de ne jamais se chercher un début d’identité et de cohérence, avec la narration foutraque et le trop-plein de genres disparates comme armes de liberté ? Pas facile à dire au vu d’un ovni dégénéré qui ne cesse de hurler son envie de réinventer la série Z à chaque raccord de plan.

« Euh, t’es vraiment sûr de ton coup, Gérard ? Parce que là, on flippe un peu… »
Auparavant connu pour son travail sur tout un tas de télépolars avec l’auteur-réalisateur Olivier Marchal (on lui doit notamment des épisodes de Groupe Nuit et de Commissaire Moulin), Gérard Cuq aura mis bel et bien huit ans à venir à bout de son baptême du feu sur grand écran, et pour cause : l’absence de complexes et la liberté artistique sont ici si outrancières que la frilosité des distributeurs à vouloir sortir un truc pareil dans les salles obscures peut se comprendre. Pour autant, la production chaotique des Percutés aura tôt fait de lever le voile sur la dure réalité de l’exploitation cinéma. Rappel des faits. Une fois le tournage finalisé en mars 2001 via une coproduction avec la Roumanie, Cuq se retrouve face à un mur : le contrat de distribution passé avec la société Artédis prévoyait une sortie au 26 décembre 2001, mais l’absence de salles pour un film aussi atypique le pousse à annuler la sortie et à ranger le film sur une étagère en attendant des jours meilleurs. Il faudra attendre le festival de Saint-Malo quelques mois plus tard pour que le film, présenté hors compétition, fasse soudain son petit effet. De façon inespérée, Artédis trouve quelques salles qui acceptent de tenter le coup pour une date de sortie fixée au 31 juillet 2002, soit en plein milieu de l’été et surtout une semaine pile poil avant la sortie de Men in Black 2. Pas la meilleure idée du monde pour un film sans stars ni publicité dont l’horizon commercial ne dépend que du bouche-à-oreille (soit l’outil le moins efficace quand les trois quarts du public hexagonal et la majeure partie de la presse spécialisée se bronzent la pilule). Le réalisateur lui-même ne peut rien y faire : à ce moment-là, étant sur un tournage à l’étranger, Cuq ne peut assurer la promo de son bébé.
La suite est logique : la presse ne semble pas pressée de relayer quoi que ce soit sur Les Percutés et boude donc ce film sorti sur six copies à Paris et vingt-trois en province (il ne restera plus que deux copies parisiennes le mercredi suivant), qui finira sa carrière à un peu moins de cinq mille entrées. Pour autant, un mini-buzz se fait sentir. Longtemps avant que le nullissime The Room de Tommy Wiseau ait droit au même destin aux Etats-Unis, certains spectateurs français font preuve d’un enthousiasme sincère à la découverte du film, au point de retourner le voir plusieurs fois. Ce qui poussera Gérard Cuq et sa femme – l’actrice et chanteuse Marie Dauphin – à démarcher eux-mêmes les médias, à organiser des rencontres dans les salles et à distribuer des tracts pour relayer l’existence du film, histoire de lui offrir une vraie ressortie dans les salles obscures. Des efforts plutôt vains, puisque le film finira écrabouillé dans ce couloir encombré que l’on appelle la « distribution » et où les grosses machines ont de plus en plus force de loi. Pour autant, méritait-il de tomber dans l’oubli ? Clairement pas, ne serait-ce que pour la banane et l’hallu qu’il nous colle sur le visage du début à la fin.
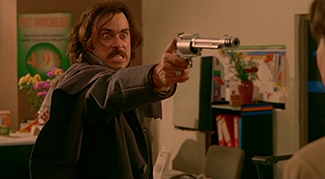

Règle n°1 : se la jouer hystéro et exorbité dans n’importe quelle situation !
« Pourquoi craindre la mort ? L’enfer est ici » : le carton qui ouvre le film a le mérite d’être clair sur l’univers que l’on s’apprête à investir. On jurerait même avoir déjà entendu la même phrase lors du climax final du Requiem d’Hervé Renoh, autre prototype de polar hexagonal à budget lilliputien marqué par une démesure dans l’hystérie et la violence extrême. Les énergumènes qui servent d’œil du cyclone aux enjeux d’un récit qui va partir dans tous les sens sont en tout cas hauts en couleur : Débé (Christophe Laubion), Sniper (Tomi Cristin), Spirou (Denis Karvil) et Cyborg (Ingrid Chauvin), quatre flics déguisés en soldats sudistes en vue d’infiltrer un bal costumé où aura lieu un trafic de drogue, et qui virent fuyards après avoir improvisé un braquage de banque – Débé a pété les plombs en se découvrant interdit bancaire. Les voilà qui entraînent avec eux leur indic Lagache (Eric Métayer), lequel, un peu esquinté, les contraint à trouver asile dans un… asile de fous ! On devine donc la suite : catapultez cinq personnages bien défragmentés dans la nef des fous, partez du principe que la liberté créative du 7ème Art est corollaire du fait d’exprimer sa propre part de folie, offrez à chaque poste créatif une cinéthérapie zulawskienne où l’hystérie nonsensique tient lieu de manifeste créatif, laissez le scénario s’écrire tout seul sans chercher à savoir comment il doit se finir, et hop, chaos reigns puissance mille. Le vol au-dessus d’un nid de coucou a donc été remplacé par une apnée nauséeuse et bruyante dans un terrier de pulsions qu’on ne cherche même plus à contrôler.


Règle n°2 : braquer les fous avant de les lâcher en roue libre !
On s’était permis de citer plus haut le navet crypto-humaniste de Patrick Sébastien, et ce n’est pas pour rien : le défilé de malades mentaux s’avère encore plus gratiné que chez l’animateur paillard des cabarets de France 2. Ici, nous avons donc un écholalique mal rasé, une danseuse nymphomane, un militaire dégénéré (joué par un Alain Figlarz qui inaugurait ici sa longue liste d’interprétations de brutes épaisses et caricaturales !), une pseudo-Jeanne d’Arc encore plus illuminée que la vraie, trois Bee Gees avec une planche de surf, des jumeaux binoclards, un joueur de cornemuse, un trouillard peroxydé, un psychopathe amateur du coup de marteau, un type en smoking qui cherche du feu, et même une grand-mère sadique ! Bref, une belle bande d’allumés qui ne cessent d’élever le taux de décibels dans les lieux, décuplant de ce fait le stress et l’hystérie de notre quatuor d’antihéros. A l’extérieur, le RAID entoure le bâtiment, mené par un Bernard Farcy alors en pleine période post-Taxi qui va perdre très vite le contrôle de la situation. Devant le film, en revanche, c’est le point d’interrogation. Tout porte à croire que l’on assiste à un nouveau prototype d’anti-cinéma, à une sorte de jeu nonsensique où le fou aurait réussi à mettre le roi échec et mat en se torchant avec la règle du jeu. Désireux de créer de l’inattendu et du mélange de genres soi-disant pour se mettre au diapason de la vie elle-même (intention louable en soi), Gérard Cuq a cependant oublié un détail capital : la règle du « tous les coups sont permis » se doit d’être conditionnée par un minimum de velléités artistiques, ici niées ou absentes. D’où l’impression de le voir se tirer lui-même une balle dans le pied.

« Bon, vous me prévenez quand je dois hurler « ALERTE GÉNÉRALE !!! », hein ? »
L’illogisme gratuit du film va de pair avec ses qualités de fabrication plus flemmardes que précaires. Rompu à l’exercice du téléfilm sans travail approfondi sur le cadre et l’esthétique, Gérard Cuq n’a ici pour lui qu’une certaine science du cadre pour faire un tant soit peu illusion. Le reste, entre un découpage calé sur la cacophonie du truc, des ralentis dépourvus de la moindre tension et des jeux de lumière dignes d’un clip de Julie Pietri, ne fait que révéler une entreprise sinon laissée à l’abandon, en tout cas gagnée par une folie théâtrale que l’on a jugée autosuffisante pour mener la barque à bon terme. Or, travailler la folie et l’hystérie au cinéma ne vaut rien si l’idée consiste à les utiliser comme palliatifs au je-m’en-foutisme le plus total. Nulle trace de subversion ici, sinon un étalage de violence complaisante que l’on tente de justifier par le fait que la réalité déraille à mesure que les personnalités de tout un chacun s’effondrent – l’effet est nul sans la mise en scène digne de ce nom qui va avec. Aucune début de ligne narrative n’apparaît même susceptible d’équilibrer les incessants changements de tonalité du film, tant les scènes et les caractères sont ici crayonnés à la va-vite. Bon courage, ainsi, pour dénicher le fil directeur entre une interprétation d’Au clair de la lune en pleine fellation, une enquête sur un meurtre dans l’asile, une fuite en caleçon dans des égouts, un exercice d’écriture instinctive, une valse sur fond du Beau Danube Bleu et une scène finale si imbitable qu’on préfère la juger bâclée. Regarder Les Percutés pour la première fois revient à rentrer dans un couloir dangereux où le no reason tel que défini par Quentin Dupieux dans Rubber aurait acquis une nouvelle signification, au mieux décomplexée, au pire décervelée. L’apprivoiser avec curiosité ou la rejeter sans appel sera bel et bien le seul choix valable à faire.

Libère ton esprit pour laisser la folie t’envahir…

« Dis donc Ingrid, tu te crois dans Matrix ou quoi ? »
Côté acteurs, la sublime Ingrid Chauvin – ici dans son unique rôle au cinéma – ne peut espérer surnager d’un parterre de tarés en roue libre : qu’elle soit saoule, hystérique, proto-bouddhiste (on la voit soudain faire du tai-chi avec deux zinzins !) ou amazone badass avec une perruque, l’actrice ne parvient jamais à donner un semblant d’évolution à son personnage d’agent de la paix entraînée malgré elle dans le chaos. Au moins, le seul intérêt de son rôle consiste à rappeler au spectateur quel est le sien : finir gagné par la folie de l’ensemble à force de le côtoyer avec autant de proximité. C’est là que, mine de rien, Les Percutés peut susciter un début d’ivresse, sous couvert d’avoir un cerveau en condition et un sérieux degré de tolérance à la cacophonie. On peine en tout cas à relever un autre exemple de polar français atteint par une telle folie. Peut-être serait-on tenté de songer au Dobermann de Jan Kounen, mais ce dernier avait pour lui une mise en scène et un découpage très BD-like, soutenu par un ton destroy sans ambiguïté et une galerie de personnages improbables en accord avec le sujet. Gérard Cuq, lui, ne vise qu’une folie à sens unique, dénudée et traitée sans recul, mais sans que l’on sache si elle est censée insuffler un vrai vent libertaire ou servir au contraire de mise en alerte. La réponse se situe sans doute entre les deux, à l’image de ce générique de fin où, sur fond d’une très envoûtante chanson, le flic joué par Bernard Farcy semble dépassé par tout ce bazar, hésitant entre la consternation et le fou rire nerveux. Il n’est pas le seul. Bonne chance, en tout cas, pour ne pas finir totalement fou en sortant de cet ovni.
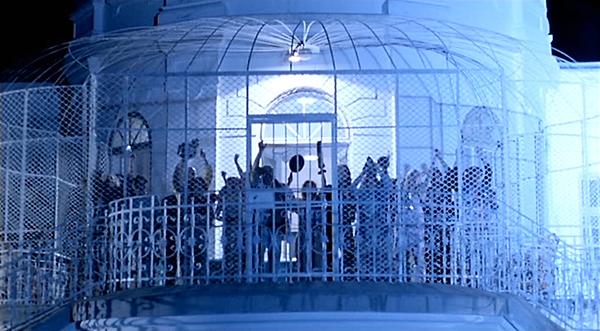
Apocalypse Now !!!
