
REALISATION : Claire Denis
PRODUCTION : Ognon Pictures, Arte France, Pusan Film Commission
AVEC : Michel Subor, Grégoire Colin, Béatrice Dalle, Katia Golubeva, Lolita Chammah…
SCENARIO : Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
PHOTOGRAPHIE : Agnès Godard
MONTAGE : Nelly Quettier
BANDE ORIGINALE : Stuart Staples
ORIGINE : France
GENRE : Drame
DATE DE SORTIE : 04 mai 2005
DUREE : 2h01
BANDE-ANNONCE
Synopsis : A la veille d’une transplantation cardiaque, un homme malade décide de quitter la montagne du Jura où il mène une existence solitaire pour partir vers les îles de Polynésie à la recherche d’un passé et d’un paradis perdus…
L’intrus, c’est qui ? Répondre Claire Denis semblerait presque trop facile. Du coup, on peut trouver une parade : son cinéma, de plus en plus radical et toujours aussi prompt à diviser les opinions, peut constituer en soi une intrusion dans le paysage cinématographique français. Ce que notre pays ne semble jamais prêt de désirer, que ce soit par peur ou par habitude, elle l’injecte sans crainte et sans ménagement : de la différence. Mieux : du nouveau, quelque chose qui n’appartient qu’à elle, un style qui laisse dans une drôle d’incertitude. De là vient sans doute sa volonté de bannir toute étiquette, de rejeter tout rapprochement entre cinéma d’auteur et cinéma commercial. On peut y voir aussi une forme d’évasion, le désir de faire souffler un vent de liberté dans le cinéma français et de se laisser porter par ce vent : du Cameroun de Chocolat aux terres étrangères de L’intrus, en passant par le désert de Djibouti dans Beau travail, le but du voyage a souvent été moins important que le voyage lui-même. Son idée de lâcher prise avec les règles du monde trouve d’ailleurs une belle signification dans l’une des premières scènes de ce film sorti en 2005, où une fausse séance d’hypnose laisse vite la place à un drôle de jeu érotique. En cela, on pige bien qu’avec elle, le sens importe moins que les sensations, et sa mise en scène, entièrement élaborée sur le travail de l’image et la récurrence des non-dits, en est le plus beau témoin. Reste que L’intrus, adaptation extrêmement libre d’un texte du philosophe Jean-Luc Nancy (qui aura inspiré au même moment La blessure de Nicolas Klotz), lui permet d’aller plus loin : en épousant enfin la ligne de fuite sensuelle et poétique qu’elle titillait depuis plusieurs films, Claire Denis largue les amarres pour de bon, au risque de dérouter tout le monde et de dériver clairement vers l’abstraction. Autant être prévenu dès le départ…

L’intrus, c’est quoi ? Mieux vaut laisser de côté le symbole au profit de la définition littérale si l’on souhaite s’aventurer dans le dédale du scénario. Première scène très évocatrice : un banal contrôle de douane à la frontière entre la France et la Suisse, marqué par la fouille et l’arrestation d’un routier qui transportait de la drogue. Rien de spécial à noter sur la narration, rien d’intriguant sur le terrain dramatique, juste des gestes à filmer, des attitudes à capter et, surtout, une forme d’animalité entre la jolie douanière (Florence Loiret-Caille) et son chien policier. Mais déjà, une idée surgit, claire comme de l’eau de roche : la frontière à franchir, l’intrusion en territoire étranger qui s’active, voire qui aboutit au rejet. D’où l’apparition rapide du personnage central, Louis Trebor (Michel Subor), un homme âgé vivant avec son chien dans une cabane paumée au beau milieu des plaines du Jura. Cet homme semble s’épanouir au contact de la nature, en marge du monde civilisé, que ce soit dans les forêts ou les lacs de montagne (où il se balade généralement tout nu). Cet homme a aussi un fils, Sidney (Grégoire Colin), marié à la douanière citée précédemment et père de deux petits enfants. Ce triangle de personnages, présenté à partir d’une série de connexions insidieuses sans qu’aucun dialogue ne vienne expliciter le pourquoi du comment, n’est pourtant que la première pièce d’un vaste puzzle narratif que Claire Denis va très vite complexifier.


Dès que les pièces apparaissent sans se relier directement, l’attention du spectateur est réclamée. Ces pièces sont d’abord des personnages, et exclusivement des femmes : une sauvageonne solitaire (Lolita Chammah) qui investit quelques plans avec son chien pour finir sans crier gare en cadavre ensanglanté dans la neige, une amante pharmacienne (Bambou) dont la seule fonction semble être de fournir Trebor en sexe et en médicaments, une « reine de l’hémisphère Nord » (Béatrice Dalle) qui semble dominer cette nature sauvage avec l’aide de ses chiens de traîneau, et surtout, une énigmatique jeune femme russe (Katia Golubeva, alias l’ex-compagne de Leos Carax), laquelle fait figure d’agent du trouble en plus de conserver un œil méfiant (ou bienveillant ?) sur notre protagoniste. Quelque chose semble roder dans cette forêt jurassienne, et Trebor lui-même se sent en liberté surveillée : une grosse voiture noire le frôle sur la route et, la nuit, des silhouettes (immigrés ou trafiquants d’organes ?) s’agitent dans les bois quand elles ne l’épient pas. Pour ne rien arranger, Trebor a un problème biologique : son cœur commence à lâcher. Un message tapé en russe sur un ordinateur devient une alerte pour lui : « Le processus d’urgence est lancé ». Il lui faut désormais partir, d’une part à la recherche d’un nouveau cœur, d’autre part à la recherche d’un fils qu’il n’a jamais connu. Et comme dans tout voyage, les paysages vont se multiplier : Trebor s’enfuit à Genève, récupère une valise pleine de billets dans un coffre sécurisé, se retrouve ensuite en Corée du Sud afin de régler une transaction, et s’envole in fine pour la Polynésie.
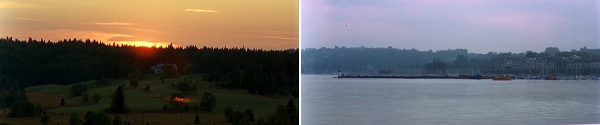

Ce genre de voyage aurait davantage sa place dans un film d’espionnage ou d’action. En un sens, L’intrus en est un, et des plus captivants, mais avec un truc en moins : l’action, précisément. Celle-ci n’existe pas, ou alors de façon elliptique, au détour d’un plan ou d’une scène. C’est que le film semble la faire circuler en sous-marin, un peu comme du sang dans les veines d’un corps humain. Tout semble là, mais absent, parce qu’échappant aux lois les plus élémentaires de la perception. Du coup, le spectateur se retrouve démuni, face à un cinéma entièrement dominé par l’ellipse, qu’elle soit scénaristique et/ou spatio-temporelle. Difficile, en effet, de relier tous les éléments de l’intrigue entre eux, tant la mise en scène de Denis assimile les séquences vécues aux séquences rêvées sans signe d’alerte, supprime toute dose de psychologie pour ne filmer que des corps et des visages (et sur ce point-là, elle reste la championne), et confère une dose élevée de mystère à chaque entité (humaine ou animale) qui se permet d’investir son cadre, parfois par accident. Mais cela forme un atout monstrueux, surtout pour ceux qui avaient déjà pu goûter à ses précédents films : Claire Denis profite de cette nébulosité pour aiguiller le suspense sur la question de l’articulation narrative, et ainsi, dessine une trame inachevée qui réussit à s’incarner au cœur même de la beauté formelle du film.
Considéré à tort par bon nombre de détracteurs comme le point faible de la cinéaste, l’humain retrouve ici une double nature : au premier plan, un primitivisme régi par les pulsions vitales (boire, manger, dormir, baiser, nager…), et au second plan, un mystère interne dont on ne peut vraiment cerner les contours. En cela, même le choix de Michel Subor (révélé en 1963 dans Le petit soldat de Godard) se révèle des plus judicieux : véritable mythe du cinéma français, l’acteur trimballe une carcasse massive et un incroyable charisme animal qui, dès l’instant où son personnage s’installe sur un atoll polynésien, en font une sorte de colonel Kurtz mélancolique, hanté par son passé. Si l’on se souvient que Marlon Brando lui-même avait choisi à l’époque de s’exiler dans ce coin du globe et que le film de Claire Denis intègre des extraits d’un vieux film inachevé de Michel Subor (alors âgé de 20 ans) au sein de sa propre narration, la coïncidence, cinéphile et temporelle, finit par ne plus en être une.

Tout cela n’implique pas que la tonalité primitive du film prive ce dernier de toute forme d’émotion. Bien au contraire, puisque celle-ci s’incarne aussi bien dans un simple raccord que dans les micro-informations qui semblent se trafiquer entre les scènes. Un exemple frappant : lors d’une ballade en famille dans la montagne, on voit Sidney porter son bébé, et la caméra se met à filmer ce dernier à hauteur d’épaule. Ce plan unique dure assez longtemps pour que le bébé finisse par troquer son regard vague au profit d’un léger sourire. Tout est alors dit sans avoir été « dit » : comme les premières scènes du film nous laissaient supposer que Trebor avait pu être un père absent (peut-être indigne) pour Sidney, et comme ce dernier est aujourd’hui père à son tour, l’amour d’un père porté à son enfant se ressent au centuple dans ce plan. Au fond, le sujet de L’intrus, ce n’est que ça : l’amour entre un père et son fils, que Trebor se doit désormais de retrouver, d’abord en troquant son cœur fatigué contre un autre plus solide, ensuite en enquêtant sur l’existence de son autre fils, naturel celui-là. Tout le film se dessine dans ce schéma filial, avec la greffe de cœur comme métaphore sous-jacente, sans parler du fait que les zones d’ombre du récit sont précisément les trous que Trebor doit combler au sein de son propre schéma interne. L’avertissement lancé par Katia Golubeva en ouverture du film n’était pas anodin : « Tes pires ennemis sont à l’intérieur, cachés dans l’ombre, cachés dans ton cœur ». Et lorsque la fin du film révèle le cadavre de Sidney, alors parcouru par la même cicatrice au torse que celle de Trebor (signe d’une possible greffe cardiaque), l’idée de transmission filiale tend à dériver vers la métempsychose. Ce qui fait alors de L’intrus l’exact inverse d’un objet désincarné, et davantage l’incarnation d’un transfert invisible doublé d’un sublime voyage intérieur.

Certes, on aura tout loisir de chercher la signification du titre du film, entre un Trebor vivant en marge des lois du monde ou la simple dichotomie père/fils, mais ce serait inutile. D’un point de vue conceptuel, l’intrus en question possède ici un double sens, cimenté par la mise en scène de Claire Denis et facilement assimilable aux deux valves du cœur malade de Trebor : d’un côté, il s’agit tout d’abord d’injecter le sang du film au cœur même du processus (ce qui revient à poser les bases d’un récit sans expliciter quoi que ce soit), et de l’autre, il sera ensuite question d’expulser ce même sang vers de nouveaux territoires (ce qui place alors le récit sur un autre régime de croisière, plus atmosphérique et sensoriel). De là viendront alors les innombrables disjonctions entre les séquences et la multitude d’effets de miroir (montagne/mer, réalité/rêve, père/fils, forêt/ville, France/Polynésie) qui achèveront d’étendre la grille de lecture du récit jusqu’à un horizon indiscernable. On l’évoquait plus haut : le film reste fixé sur le schéma interne de son protagoniste, dont il n’est pas impossible que le film (entier ou pas) soit rêvé ou fantasmé par son propre esprit (la lecture lynchienne n’est pas interdite). Mais paradoxalement, le film entier reste ouvert sur le monde extérieur, des étendues de neige jurassienne jusqu’aux lagons bleus de Polynésie, en passant par l’urbanisme neigeux de Pusan. La transe générée par le film se définit là encore par la simple sensorialité de ses images, généralement d’une beauté à couper le souffle (merci à Agnès Godard, décidément un chef opérateur d’exception) et créant le trouble par de géniales ellipses géographiques : à titre d’exemple, le raccord du Jura vers Pusan ne suscite aucune gêne grâce à la présence de la neige dans les deux environnements, et ce raccord installe aussi un léger doute sur la fluidité directe entre ces deux cadres, comme si le passage brutal d’un lieu à un autre signifiait le passage de la réalité au rêve. A moins que ce ne soit l’inverse. Ou autre chose, qui sait…

Cette idée de fragmentation totale dans le découpage renvoie à bon nombre de cinéastes français contemporains (de Philippe Grandrieux à Arnaud des Pallières), pour qui le sens d’un film passe avant tout par l’assimilation d’un montage sensoriel à partir de sons et d’images savamment emboîtés. Une mise en scène qui, à bien des égards, passerait presque pour du terrorisme tant elle réussit à éclater notre schéma classique de perception d’un récit ou d’une narration, traçant son chemin sur une route perdue sans phares allumés, avec un spectateur muni d’une simple lampe-torche pour tenter de retrouver sa voie. Il fut longtemps établi que la richesse du cinéma de Claire Denis résidait avant tout dans l’étrangeté qui s’en dégageait, mais cela n’était sans doute qu’une vue incomplète de l’esprit. Avec L’intrus, sans aucun doute son plus beau risque de cinéma, elle réussit un sacré exploit : relancer les dés de son style tout en l’amenant à un autre niveau, signe d’un accomplissement qui continuera à l’avenir de porter ses fruits. Oui, dans le cinéma français, Claire Denis est bel et bien une intruse. Et elle y tient une place de choix.
