
La projection de Michael Kohlhaas aura fait l’effet d’une surprise très déroutante, aussi bien lors de sa sélection cannoise (où le film fut considéré par beaucoup comme « la seule vraie curiosité de la compétition ») que lors de son avant-première lyonnaise. De la part d’un cinéaste aussi rare et exigeant qu’Arnaud des Pallières, c’était la moindre des choses. Le résultat fut pourtant au-delà des espérances, et une rencontre s’imposait d’elle-même pour tenter d’en décrypter les fondations. Car ce croisement ambitieux entre le drame existentiel et le western cévenol confirmait malgré tout la patte d’un auteur unique, déjà très connu pour son exigence formelle et sa capacité à investir de nouveaux territoires à chaque film. De la narration polyphonique d’Adieu jusqu’à l’ambiance lynchienne de Parc en passant par son sidérant documentaire sur Disneyland Paris, c’est autant de portes ouvertes qu’Arnaud des Pallières nous offre la possibilité de pousser, sans jamais préciser ce qu’il sera possible d’en tirer. Notre rencontre avec ce réalisateur (escorté pour l’occasion par sa scénariste Christelle Berthevas) nous a laissé la sensation d’un artiste humble, profondément intègre dans sa démarche comme dans sa pensée, pour qui un film est autant une aventure à tenter qu’une expérience à offrir. La curiosité du regard et la grandeur du geste, en somme. Et face à quelqu’un qui n’hésite pas à citer Valhalla Rising comme une pure expérience de cinéma, le respect s’impose autant que l’admiration.
Courte-Focale : Quelle a été l’origine de votre désir d’adapter la nouvelle d’Heinrich von Kleist ?
Christelle Berthevas : Je pourrais vous répondre sur le « comment » du scénario, mais sur le « pourquoi » et sur les intentions de départ, tout est parti avant tout d’un désir d’Arnaud.
Arnaud des Pallières : C’est un livre que j’ai lu il y a très longtemps, lorsque j’étais encore un jeune étudiant en cinéma. J’ai tout de suite pris conscience qu’il s’agissait d’une grande œuvre, et non pas simplement d’un bouquin. Ce fut d’ailleurs l’un des premiers objets littéraires que j’ai rencontré sur mon chemin et dont je me suis dit – comme cela peut arriver lorsqu’on devient cinéaste – qu’un jour, j’aurais quelque chose à faire avec ce texte. En clair, je me suis immédiatement senti une intimité avec ce que racontait cette histoire, avec ce personnage. Mais à l’époque, je ne savais pas trop quoi en faire ni même comment le faire : j’avais 25 ans, je commençais à peine à faire quelques courts-métrages dans une école, et je ne me sentais pas capable de mettre en scène un film comme celui-là. Ce qui s’est finalement passé, c’est qu’après plusieurs années, le souvenir du texte est resté suffisamment vif dans mon esprit pour que, de temps en temps, j’en parle à un producteur en disant que j’en ferais un film plus tard. Seulement, pour cela, il aurait sans doute fallu que je sois devenu suffisamment aguerri et reconnu pour pouvoir disposer d’un budget conséquent. C’est un film à costumes, et quand on fait un cinéma comme le mien, qui navigue entre cinéma et télévision, fiction et documentaire, court-métrage et long-métrage, et qui est à la fois assez personnel pour ne pas avoir d’étiquette commerciale, l’accès à ce genre de budget était très restreint. Avec mon producteur Serge Lalou, on a néanmoins pris la décision de se diriger malgré tout vers ce projet-là (à l’époque, mon film précédent, Parc, venait tout juste de sortir). Du point de vue de la collaboration avec un producteur, c’était quelque chose de très ambitieux, voire de très difficile, mais Serge m’a dit oui dès le départ, donc je savais qu’il m’accompagnerait jusqu’au bout. Ce qui me plaisait aussi dans l’entreprise, c’était de n’avoir aucune idée de la façon de faire ce genre de film : je n’avais aucune expérience sur le film en costumes, et me lancer dans quelque chose d’inconnu est une chose qui me plait toujours. J’aime beaucoup la phrase de Gertrude Stein qui dit « Si on peut le faire, pourquoi le faire ? ». Je savais que je ne savais pas le faire, et c’était un bon signe. A chaque nouveau film, je fonctionne par défi, et je pense qu’en faisant un retour sur les quelques films que j’ai faits, il n’y en a pas un qui ressemble aux autres. C’est ma manière d’être. J’aime bien faire un film contre le précédent. Il existe deux sortes de cinéastes : ceux qui approfondissent un geste et qui refont toujours le même film en l’enrichissant ou en l’épurant, et ceux qui, au contraire, font à chaque fois des choses très différentes en s’interrogeant à chaque fois ce qu’il restera d’eux-mêmes au final. Dans mon cas, on fait d’abord un documentaire sur Disneyland, et ensuite, on fait un film d’aventures avec un acteur danois et un scénario inspiré d’une nouvelle de Kleist. Mais de soi, qu’est-ce qui reste présent d’un film à l’autre ? Cette question me semble intéressante. Certains gens peuvent y retrouver des préoccupations, un goût pour le son, ou tout un tas d’autres choses.

Les différents films que vous avez réalisés, qu’il s’agisse de vos documentaires ou de vos longs-métrages pour le cinéma, ont en commun une vraie exigence formelle, une composition esthétique très particulière, et sur le fond, ils sont instables de par les changements de points de vue qu’ils opèrent, notamment sur le terrain psychologique. Avez-vous le sentiment d’être dans cette continuité avec ce film-là ?
AdP : Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre : je ne fais pas de différence entre le fond et la forme, au sens où je ne suis pas un philosophe et où je ne travaille pas avec des idées. Je suis avant tout un cinéaste, je raconte des histoires. Et même plus que de raconter des histoires, vu que ce n’est pas propre aux cinéastes, je construis des histoires en images et en sons, afin de faire vivre au spectateur une expérience sensorielle dans le temps.
Comme ce fut le cas pour Parc, par exemple ?
AdP : Oui, je l’espère, aussi bien dans Parc que dans les autres films que j’ai faits. Mais ce que je recherche avant tout, c’est la forme adaptée à l’histoire que je veux raconter. L’idée n’est pas d’inventer absolument une nouvelle forme à chaque film, et il y a autant de façons de raconter une histoire en images et en sons qu’il y a d’histoires à raconter. Ici, c’est un film d’aventures, j’avais envie d’essayer le Cinémascope, je n’avais jamais travaillé en HD, je n’avais jamais travaillé à ce point avec des animaux dans les séquences, je n’avais jamais travaillé avec un coscénariste, ni même monté un film avec une autre personne… Il y a beaucoup de « premières fois » dans ce film, et l’idée, c’est d’aller de première fois en première fois. Tout ce qui est propre à ce film résulte de choix qui venaient de l’histoire particulière que j’avais envie de raconter. Du coup, je pense que je pourrais justifier chacun de mes choix de façon relativement rationnelle.
Vous disiez que vous naviguiez entre plusieurs voies, mais il semble qu’il existe dans le film une dialectique formelle entre l’idée de spectacle et l’idée d’épure, qui est assez fondamentale. Êtes-vous d’accord avec cela ?
AdP : Vous le dites très bien : je veux tout et son contraire. Je peux être quelqu’un d’assez compliqué, enfermé dans l’excès ou la profusion, quelqu’un qui adore empiler des tas de sons et de personnages. Je pense l’avoir fait dans Adieu, par exemple, mais là, j’étais dans une logique d’épure et de soustraction. Je peux vous donner une raison très simple : le film est centré autour d’un personnage qui est protestant, mais je ne veux pas raconter qu’il est protestant. Je veux que le film l’exprime, que l’on soit sans cesse dans son monde à lui, dans ses sentiments et dans sa propre perception de ce monde. Tout est parti de cette petite idée. Et cette logique d’épure a ainsi rejailli sur la totalité des opérations de mise en scène du film. D’une certaine manière, je pourrais dire que mon geste d’excès a été un geste de simplification : ne garder que le strict minimum, le vivant, l’organique. Je suis donc devenu excessivement simple.
Et derrière, le travail du spectateur consiste donc à « coller » sur cette simplicité ces propres sensations ?
AdP : L’idée, c’est que le spectateur ressente avant qu’il ne comprenne. Ce qui ne correspond pas vraiment à ce que je faisais dans mes précédents films : je pense qu’il y a quelques années, j’étais encore un peu plus littéraire que cinéaste, je chargeais beaucoup mes films de textes ou de phrases à transmettre, etc… Aujourd’hui, je pense différemment. L’idée du cinéma, c’est juste des images et des sons qui font vivre une expérience. Koyaanisqatsi, c’est du cinéma. Au hasard Balthazar, c’est du cinéma. Valhalla Rising, c’est du cinéma. Je me souviens de Bresson qui disait « Un cinéma qui repose trop sur le dialogue est plus proche du théâtre que du cinéma ». Ici, tout est parti du personnage, de ce que doit être le propre « film » de ce personnage. Et ce film, il est ici dans le protestantisme, par rapport à la luxuriance du catholicisme. Il s’agit d’épouser quelque chose du caractère du personnage.

Mais dans cette logique d’épure, vous n’êtes pas non plus allé jusqu’à épurer le jeu des acteurs comme chez Bresson. Vous leur avez donné la liberté d’apporter une charge émotionnelle…
AdP : Si on veut être dans l’épure, on n’est pas obligé d’être bressonien. Il existe de nombreuses manières de l’être. Des cinéastes comme Melville ou Haneke sont clairement dans l’épure. Je pense que chacun de ces cinéastes a construit, selon son intime conviction organique, quelque chose de très personnel dans l’art de l’épure. Sur ce film, je l’ai fait à ma manière, à savoir quelque chose qui était de l’ordre de la palpitation, de l’organique, de la saleté…
Un cinéma tellurique, en somme ?
AdP : Oui, le vent, la lumière, toutes ces choses… D’ailleurs, lorsque l’on travaillait sur le scénario, on s’est rendu compte avec Christelle que le personnage n’était pas conscient de la portée politique de sa révolte, mais qu’il avait une intuition politique. C’est un personnage qui est d’avant les idéologies révolutionnaires, et cette idée de l’intuition, c’est quelque chose qui m’est resté. Et au fond, c’est un film où les êtres agissent davantage selon une forme d’instinct presque animal que dans une logique plus rationnelle. Au moment où on écrivait les dialogues, on est tombé sur des historiens qui nous disaient qu’à l’époque, on ne pensait pas et on ne parlait pas de la même manière qu’aujourd’hui. Nous tous, nous sommes des rationalistes et des cartésiens, parce qu’on a hérité de ce moment extrêmement important de la pensée qui était le cartésianisme. Mais il y a eu un « avant » où l’échange des idées dans les paroles était très différent. Du coup, on s’est dit que peut-être, dans ce film, les choses devraient un peu plus heurtées, un peu moins expliquées.
Parfois, vous êtes aussi dans l’ellipse. Par exemple, dans la scène de la mort de l’épouse de Michael Kohlhaas, on a un peu l’impression d’avoir raté quelque chose. Pourquoi avoir utilisé ces ellipses ?
AdP : Eh bien, il vous arrive exactement la même chose que la petite fille : elle a raté quelque chose. J’essaie de vous mettre, par un geste de montage, dans le sentiment de la petite fille. Vous allez arriver trop tard. Les ellipses, c’est toujours de l’énergie pure, une forme de violence faite au spectateur. Presque un coup d’électricité. Et encore, pour cette scène, je ne pense pas l’avoir réfléchi au moment où je la tournais. Mais votre réaction me semble tout à fait juste : pour la petite fille, il s’est passé quelque chose dans son dos, et quand elle arrive, il est déjà trop tard. La souffrance et la cruauté de ce qui se passe provient de ce « déjà trop tard ». C’est le geste temporel qui fait que c’est particulièrement douloureux.

Revenons sur la nouvelle de Kleist, dont il est précisé au générique de fin que votre film en est une adaptation libre. Quelles ont été exactement les libertés prises par rapport à la nouvelle ?
CB : Il y en a un certain nombre, à vrai dire. La nouvelle de Kleist date du début du 19ème siècle, elle est chargée d’un univers politique postrévolutionnaire, et à l’époque, Kleist va s’en servir pour défendre des idées. En somme, il s’inspire d’une histoire authentique, à savoir un fait divers de 1530 où, après s’être fait volé des bœufs, un marchand de bestiaux a réclamé une justice qu’il n’a pas obtenue et s’est lancé dans une révolte guerrière pour finir par être exécuté. A l’époque, on sait que Luther est intervenu en sa faveur par une lettre auprès du prince-électeur, et on sait aussi que le prince-électeur, après avoir eu connaissance de toute l’histoire de cet homme, a fini par regretter son exécution. Kleist s’empare donc de cette histoire, en fait une intrigue romantique sur fond de conflits politiques, entre un prince éclairé et un prince plus obscur de l’Allemagne de la fin du 18ème siècle. Il y est beaucoup question de droits, il y a un plaisir évident chez lui à développer une écriture juridique : on remarque qu’il y a toute une série d’aventures et de questionnements sur la justice, que va-t-il arriver au personnage s’il est jugé ici ou là-bas, etc… Il y a donc beaucoup de droits qui se confondent. Jusqu’au dernier tiers… Je sais qu’Arnaud parle souvent du rapport que Kafka avait avec cette nouvelle, mais tout le dernier tiers contient une intrigue non-romantique qui appartient plus au baroque du 19ème siècle, autour d’une bohémienne qui vient aider Kohlhaas dans sa prison. Quant au personnage de Kohlhaas, il faut préciser que dans la nouvelle, il s’agit d’un illuminé. Il devient quasiment un ange exterminateur, et à la fin, quand on le redécouvre à la tête d’une armée, il a devant lui des petits pages avec des coussins rouges et des épées dorées. Rien à voir avec ce que nous en avons fait dans le film. Mais nous avons tenu à conserver l’essence de la structure et de la narration. Par ailleurs, une autre chose nous avait beaucoup touchés, c’était la présence des enfants : d’une part, ils étaient plus nombreux dans la nouvelle (au moins quatre), et d’autre part, on a gardé un instant précis de la fin de la nouvelle, où Kohlhaas voyait deux de ses enfants monter sur un cheval et partir au loin. On a repris cet instant dans le film pour la scène finale, avec la petite fille.
AdP : Cela dit, la plus grande liberté qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’on en a fait une histoire française. Je pourrais d’ailleurs revenir à la première question que vous m’avez posée : il y a un lien si fort entre cette histoire et l’histoire de l’Allemagne, et l’idée d’en faire un film alors que je ne suis pas très compétent en allemand m’intimidait beaucoup. Le déclic a consisté à me dire que, dans le fond, le rapport à la germanité n’est pas important. L’important, c’est un homme qui a une obsession, qui va jusqu’au bout et qui donne sa vie pour cette obsession. Ça pourrait très bien se dérouler n’importe où. Et comme Christelle est beaucoup plus historienne que moi, je lui ai demandé si elle voyait quelques circonstances historico-politico-religieuses qui permettraient de décaler l’intrigue et d’en faire une évocation historique. C’est là que nous avons trouvé cette histoire de princesse d’Angoulême, ainsi que cette région des Cévennes où une sorte de coexistence pacifique a existé pendant longtemps entre les catholiques et les protestants. Et le tour était joué : je n’avais pas de problème, je racontais une histoire en français et je faisais une coproduction avec l’Allemagne. Sur ce dernier point, autour de la question du protestantisme, ça avait du sens que certains acteurs puissent avoir un accent qui donnerait l’origine de cette foi… Au bout du compte, quand on fait un film, on ne peut pas prendre tout ce qu’il y a dans un bouquin : le temps de lecture d’un livre et le degré de complexité de ses différents embranchements ne sont pas comparables avec l’écoulement d’un film de deux heures. Comme tout ne nous intéressait pas dans cette histoire, nous avions donc des choix à faire (tous ceux que Christelle vient de citer). Nous avons pris la décision de modifier, de supprimer ou d’inventer certains personnages (dont celui de la petite fille, qui n’existe pas dans la nouvelle). Et comme nous trouvions que l’histoire manquait de personnages féminins, nous avons décidé que Kohlhaas aurait beaucoup plus affaire à des femmes : cela l’humanisait et le rendait moins seul que dans la nouvelle (où les personnages secondaires étaient toujours au second plan). Il fallait lui créer de vrais rapports, inventer de vraies relations, ne serait-ce qu’avec sa femme et sa fille… On a aussi pris la décision de moderniser les dialogues : chez Kleist, tout est très baroque et tortueux, et on a choisi d’écarter les signes de langue ancienne ou les doubles négations pour que le spectateur rentre le plus tôt possible dans le film. Plus vite il peut oublier qu’il se trouve au 16ème siècle, mieux c’est. Plus on épure, plus on se rapproche de quelque chose qui est de l’ordre du western, et au fond, dans le western, on n’a jamais l’impression d’être dans le passé. On a une telle connaissance, une telle aisance dans le western, justement parce qu’on en a vu plein. On est dans une sorte de présent hyper-codifié qu’on connait bien, et du coup, on ne fait plus attention aux costumes ou à la temporalité. C’était l’objectif à tenir sur ce film : faire qu’à chaque instant, on puisse être au présent.

La nouvelle de Kleist a déjà été adaptée plusieurs fois. Cela ne vous a pas posé de problème dans le travail d’adaptation ?
AdP : Quand on a commencé à travailler avec Christelle sur l’adaptation, on s’est dit que la moindre des choses serait de voir les œuvres précédentes qui ont été tirées de la nouvelle. J’avoue que je ne les connaissais pas, et c’était une bonne chose. Nous avons donc vu trois ou quatre films en tout et pour tout. Il y avait un film de 1969 réalisé par Volker Schlöndorff, un feuilleton allemand des années 70, et aussi un téléfilm en mode western réalisé par John Badham avec John Cusack (Jack Bull, produit en 1999 par la chaîne HBO). Mais le plus fort, ça a été de redécouvrir Ragtime de Milos Forman, qui est en réalité une adaptation détournée, via un roman de Doctorow qui est lui-même inspiré de la nouvelle de Kleist.
CB : Ils n’ont d’ailleurs même pas cité Kleist au générique, mais on a tout de suite repéré la connexion. Il y a même un personnage dans ce film qui s’appelle Coalhouse ! (rires)
AdP : Outre le fait qu’il s’agissait pour nous de la meilleure adaptation qui ait été faite de cette nouvelle, cela prouve à quel point cette histoire est universelle, conjugable à toutes les cultures et à toutes les époques. On en a tiré cette leçon.
Aviez-vous le sentiment, sans que cela devienne forcément une intention au moment de l’écriture, d’utiliser cette histoire pour évoquer quelque chose de l’actualité contemporaine ?
AdP : C’est la seule raison pour laquelle j’ai voulu adapter cette histoire. J’avais l’intime conviction qu’il y avait quelque chose de Kohlhaas en moi, et que cette histoire disait quelque chose d’important à la fois sur notre humanité et sur des sujets plus politiques. Quand mon producteur m’a demandé pourquoi je voulais adapter cette nouvelle, je lui ai dit que je ne connaissais pas beaucoup d’auteurs qui racontaient aussi bien quelque chose qui est en train de nous arriver. Au risque d’aller un peu vite, je dirais que le désespoir politique de Kohlhaas a quelque chose à voir avec le désespoir politique d’hommes et de femmes seuls qui luttent contre le monde en sacrifiant leur vie. On peut tous faire le lien avec cette histoire, et si on peut faire le lien, c’est qu’il y a un lien. Ce qui fait que l’on peut se poser la question : Kohlhaas est-il un terroriste ? Je ne vous dirais pas ma réponse, mais je tiens à ce que chaque spectateur se pose la question et se détermine par rapport à sa façon de juger le personnage.
Du coup, est-ce que vous vous sentez terroriste en tant que cinéaste ? Est-ce que faire du cinéma est une façon pour vous de lever des armées ?
AdP : Plusieurs personnes m’ont demandé si l’histoire de Michael Kohlhaas et de son combat n’est pas l’histoire d’un cinéaste qui combat pour faire un film… Je n’y avais jamais pensé… (il réfléchit) Pourquoi pas… Faire un film, c’est aller au bout d’une idée. Je crois que c’est Godard qui disait que, si l’on est très attentif, il existe dans tout bon film un documentaire sur la façon dont il a été fabriqué. Donc, oui, un film est toujours l’histoire de lui-même, d’une certaine manière. Et il est certain que pour faire ce film, nous avons dû passer par de nombreuses épreuves, tant physiques que météorologiques, par lesquelles les personnages passent dans le film. Mais même s’il y a une relation, ce n’est pas pour ça que je fais le film. Je ne fais pas un film pour parler de moi, je le fais parce que j’ai une relation intime avec cette histoire.

Entre le moment où vous avez entrepris de faire le film et aujourd’hui, l’actualité ne vous a-t-elle pas rattrapé à un moment donné, notamment en ce qui concerne cette question de l’amnistie qui anime une très large partie de l’intrigue ?
AdP : Ma conviction profonde, c’est que c’est le propre des chefs-d’œuvre d’arriver à créer ce genre de parallèle. Vous savez, il a souvent été dit qu’adapter une œuvre majeure au cinéma aboutit presque toujours à des films médiocres, et vice versa. Je n’en suis pas convaincu, car il y a des exceptions. Là, j’avais conscience que cette nouvelle de Kleist était un chef-d’œuvre de la littérature allemande. Le personnage de Michael Kohlhaas est un mythe très connu en Allemagne. Par exemple, je me souviens avoir rencontré Jean-Marie Straub qui disait que, dans sa jeunesse en Lorraine ou en Allemagne, on disait « Tu vas encore faire ton Kohlhaas ! ». C’est un poncif, c’est un cliché, c’est un mythe de l’humanité. Cette nouvelle sera toujours d’actualité, tout comme le seront toujours les questions qu’elle pose. La fin justifie-t-elle les moyens ? Jusqu’où peut-on aller trop loin ? Qu’est-ce qui vaut le coup ou pas ? Il y a d’ailleurs dans la nouvelle deux passages qui ont déterminés à eux tous seuls mon désir de faire ce film. Le premier concerne le moment où Kohlhaas, désormais capable de prendre le pouvoir par la force et d’obtenir ainsi la justice qu’on lui avait refusé auparavant, se voir proposer de l’obtenir normalement. Et là, il accepte. Sa folie consiste dans le fait d’accepter, parce qu’il est pur et rigoureux. C’est un truc de dingue : un homme qui pourrait avoir le pouvoir sans difficulté, et qui y renonce par honnêteté et par droiture. Ça n’occupe qu’une seule ligne dans la nouvelle de Kleist, et c’est pourtant cette simple ligne qui a fait que je n’ai jamais oublié cette histoire. Et le deuxième moment, c’est la fin : d’un côté, le cœur de Kohlhaas se gonfle de joie parce qu’on lui a rendu ce qu’on lui avait pris (il a donc obtenu justice et vaincu les nobles), et d’un autre côté, il va tout perdre, de sa famille jusqu’à sa propre vie. Ce déchirement entre la victoire et la défaite m’a bouleversé : je voulais mettre en scène cette joie et cette tristesse, et je trouve que Mads a fait ça magnifiquement.
Le choix de Mads Mikkelsen pour le rôle principal découlait-il de la coproduction ou s’agissait-il pour vous d’une évidence dès le départ ?
AdP : Non, ça n’a rien à voir avec la coproduction. Si cela avait été le cas, on m’aurait dit de prendre un acteur allemand. Au départ, j’ai cherché auprès des acteurs français quelqu’un d’idéal pour incarner ce personnage, et je ne l’ai pas trouvé. J’avais dit à ma directrice de casting que je cherchais un acteur avec cette flamboyance un peu sèche, protestante, quelque part entre le Jacques Dutronc du Van Gogh de Pialat et le Clint Eastwood d’il y a trente ans. Or, en France, on n’a trouvé personne qui correspondait, à la fois père de famille, homme ordinaire et guerrier charismatique. La nouvelle de Kleist commençait par une description morale du personnage, et ça, je ne peux pas l’écrire puis le montrer. Il fallait donc que la prestance de ce personnage puisse être limpide pour le spectateur dès l’instant où il apparait à l’écran, que l’acteur puisse porter dans son regard quelque chose de cette incroyable droiture morale. Et un jour, ma directrice de casting m’a montré une photo de cet acteur danois que je ne connaissais pas. Je rappelle qu’à l’époque, Valhalla Rising n’était pas encore sorti, et comme je n’étais pas très fan de James Bond, je ne l’avais pas vu dans Casino Royale. J’ai donc regardé l’ensemble des films dans lesquels Mads avait tourné, et j’ai vu à quel point il avait une très large palette. Mon premier réflexe a été de me demander s’il n’avait pas trop une « gueule » de série B, si cette allure allait trancher avec la complexité du personnage que je souhaitais révéler. Mais je dirais qu’entre le premier Pusher de Nicolas Winding Refn et After the wedding de Susanne Bier, j’avais pu voir les deux extrêmes de son jeu d’acteur, avec une sorte de folie furieuse d’un côté et une vraie délicatesse de l’autre. Du coup, je me suis dit qu’il était très courageux, très physique et, lorsque je l’ai rencontré, je sentais quelqu’un de très engagé dans son travail d’acteur. Il y avait deux grands défis pour lui : d’abord, le fait de n’être jamais monté à cheval (il est pourtant supposé jouer un marchand de chevaux, à la fois grand cavalier et capable de faire accoucher une jument), et ensuite, l’idée de parler français. Il restait un an avant de démarrer le tournage, sans compter les autres films qu’il s’apprêtait à tourner, et il m’a confié qu’il serait capable d’y arriver pour le film. Je lui ai fait confiance, et le résultat de ce travail, vous le voyez dans le film.

Vous avez réuni un casting très international. Comment avez-vous fait pour gérer tout ce casting, et aussi pour gérer la barrière de la langue ?
AdP : Un casting international est un concept très intimidant, mais dès que l’on oublie que ces gens ont une nation et dès que tout le monde se met à travailler ensemble, on est comme à l’époque de la Renaissance : il y a telle personne qui vient de tel village et qui parle tel dialecte, et donc, il faut bien qu’on se comprenne ! (rires) Il y avait certains acteurs qui parlaient très bien français, comme Bruno Ganz ou David Bennent : comme ils sont suisses, ils ont cette aisance entre le français, l’italien et l’allemand. Il y avait David Kross, un garçon charmant qui ne comprenait pas un mot de ce que je lui disais, et pourtant, dans le film, il parle un français merveilleux à mon sens, qu’il a d’ailleurs appris phonétiquement. Alors que, de mon côté, je bafouille dès que je parle en anglais… (rires) Vous savez, avec un acteur, on est dans des choses extrêmement simples, extrêmement physiques : « tiens, tu prends ça, tu le mets là », « ouais, plus doucement », « ah tiens, va plus vite »… Moins on échange des idées, moins on perd du temps. Les acteurs ont besoin d’être dans du concret, des choses matérielles. Partir pendant des heures sur les raisons profondes pour lesquelles le personnage va chercher telle chose ou va faire ceci ou cela, ça embrouille tout le monde. Au début, c’est ce que je faisais dans mes courts-métrages ou mes premiers films, et en fait, plus on travaille avec de grands acteurs, plus les choses se simplifient. On se lance, on échange des idées, et on improvise si nécessaire. On travaille avec des gens qui viennent d’ailleurs, on vit avec eux pendant un long moment, et cela crée un effet communautaire extrêmement fort. Ce travail a grandement favorisé l’installation d’une confiance mutuelle pendant le tournage. Et ainsi, la question d’un casting « international » n’avait plus à être posée.
Toute l’équipe technique était française ?
AdP : Non. Dans le travail de coproduction, il y a eu l’apport de techniciens étrangers. Par exemple, la chef costumière que je rêvais d’avoir sur ce film était allemande, et elle a fait à mon sens un travail formidable. Je me suis d’ailleurs rendu compte que je n’avais jamais tissé de relation suffisamment forte avec un costumier ou une costumière jusqu’à présent, et je serais ravi de travailler à nouveau avec cette personne.
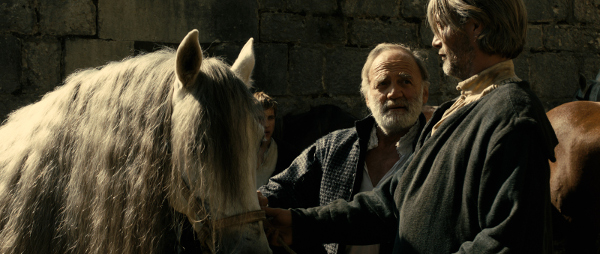
Et concernant la photographie du film ?
AdP : La chef opératrice est française, elle s’appelle Jeanne Lapoirie. C’est le deuxième film que je fais avec elle, et elle est excellente.
A ce sujet, les plans du film, plus spécifiquement les paysages, sont hallucinants de beauté, et dévoilent un travail extraordinaire sur la lumière. Est-ce que vous aviez des références en termes d’esthétique, aussi bien picturales que cinématographiques ?
AdP : On se connait bien avec Jeanne, parce qu’on a déjà fait un film ensemble et qu’on a les mêmes goûts. On aime les choses contrastées, colorées. On aime les choses fortes, les sensations fortes, et donc, quand on voyait un acteur ou un paysage, on était assez d’accord sur ce que l’on aimait et ce que l’on y voyait. Donc, la référence picturale n’est jamais présente, et il n’y a rien d’intellectuel dans le travail avec Jeanne. On n’était pas en train de se dire « Tiens, on dirait un Vermeer, on va faire pareil ! », il n’y pas eu ce genre d’échange. La seule personne à qui j’ai montré des peintures, ça a été la costumière, parce que la mode allemande de l’époque me semblait beaucoup plus épurée, plus géométrique et moins tarabiscotée que la mode française. En conséquence, on a donc beaucoup regardé des peintures de Holbein ou de Dürer pour ce travail-là. Mais pour la photo… (il réfléchit) En fait, oui, j’ai beaucoup parlé à Jeanne des Moissons du ciel, plus particulièrement du travail du chef opérateur Nestor Almendros, qui avait fait la photo de La Marquise d’O de Rohmer ou des Deux Anglaises et le continent de Truffaut. A mon sens, jamais Terrence Malick n’a approché un art de la lumière comme il l’a approché avec Almendros dans Les Moissons du ciel. C’est l’obsession de l’heure magique, de l’heure où les choses tournent, où les couleurs sont sublimées. Et il y a autre chose qui est très propre au travail de Jeanne Lapoirie (et elle sait que c’est possible en travaillant avec moi), c’est l’idée de ne rien maîtriser. Dans le travail de la lumière naturelle, elle aime que l’accident météorologique vienne comme un acteur à part entière, que l’imprévu s’invite dans le plan.
Il y a justement ce plan sublime, où une vaste ombre s’installe sur le paysage au moment précis où Kohlhaas annonce l’amnistie et quitte ses hommes en sortant littéralement du plan…
AdP : C’est ce qu’on appelle les « fausses teintes », cette espèce de masse d’ombre qui se déplace sur les paysages, et là, je dois vous dire qu’on n’a pas maîtrisé grand-chose. On a juste profité de ce qui se passait, on a pris tout ce qui venait comme une chance. C’est une sorte de logique documentaire : ce qui arrive par accident est plus une chance pour le film qu’un handicap.
Qu’est-ce qui a été tourné dans la région Rhône-Alpes ?
AdP : Il y a d’abord l’abbaye, qui est le décor central. Il y a également la prison, que l’on a trouvée au-dessus de l’abbaye à Pierre-Châtel, et ce même décor de prison nous a servi pour le fort, lors de la première rencontre entre Michael Kohlhaas et le gouverneur. Mais il y a aussi beaucoup de scènes du film qui ont nécessité des extérieurs que l’on a trouvés au Vercors : par exemple, la scène du pont est totalement tournée en contrebas du plateau du Vercors, de même que la scène de bataille avec les fausses teintes dont je parlais précédemment. Ce plateau était presque comme un studio extérieur : à chaque endroit où l’on se retournait, il y avait un nouveau décor à exploiter.
Il y a eu un laps de temps très large qui s’est écoulé entre le moment où vous avez tourné le film et le moment où il a été présenté au festival de Cannes. Cela résultait-il d’un long processus de montage ?
AdP : Oui, tout à fait. C’était complexe d’aboutir à un film qui ne soit pas emberlificoté en partant d’un matériau aussi riche, étant donné que j’avais environ 70 heures de rushes. Donc, le lent travail de simplification et d’épure a été mis en place, certains pans de l’histoire sont même passés à la trappe, et puis, là encore, histoire de revenir à ce que je disais au début de l’entretien, je pense que j’avais quelque chose à apprendre sur ce film. Je l’ai monté de façon différente vu qu’il s’agissait de quelque chose de nouveau pour moi. Je ne sais pas si ce terme va vous parler, mais le montage a été plus « horizontal », plus romanesque sur ce film. Avant, ma façon de monter était « verticale » : il s’agissait d’une approche plus poétique qui me poussait à faire un travail directement à l’intérieur de la séquence, sous la forme d’un bloc bien taillé et posé à la suite des autres. Sur ce film, l’approche était autre : le parcours du héros est comme une sorte de grande ligne qui va d’un point à un autre en suivant une seule idée, et c’est une chose que j’ai mis beaucoup de temps à trouver. Je pense être quelqu’un de lent, je suis désolé… (rires) Mais en fin de compte, je pense que ce film est bien plus accessible que mes précédents.

Vous avez une triple casquette sur tous vos films : scénariste, réalisateur et monteur. Au vu de ce qu’a été la conception de ce film, doit-on en déduire que c’est à travers l’étape du montage que vous sentez le film prendre chair, et que les étapes du scénario et de la réalisation peuvent alors être vues comme une longue période d’expérimentation ?
AdP : Il y a quelques années, je vous aurais dit que oui, mais ce n’est plus le cas maintenant. Je pense avoir progressé sur ce point, puisque j’arrive désormais à tirer un meilleur parti du tournage. Avant, j’ai longtemps dit que le seul moment où je pensais avoir une maîtrise de quelque chose, c’était le montage. Parce qu’on est alors une sorte de démiurge absolu, parce qu’il y a une sorte d’hyper-maîtrise de la moindre seconde, de la moindre décision, de la totalité de la texture sonore, etc… Au départ, je pense que le montage était le lieu par excellence d’expression du type de cinéma que je voulais faire. Mais depuis quelques films, je commence à faire des progrès dans le travail avec les acteurs et dans la quête d’incarnation du travail de réalisateur. Et sur celui-là, j’ai eu l’impression de m’épanouir davantage avec les acteurs, avec la chair humaine, avec toute la vie qui était présente sur le plateau. Film après film, cela commence à m’ouvrir plus de perspectives, même si je regrette de ne pas avoir beaucoup plus de temps. On manque toujours de temps pour des raisons économiques… Pour ce qui est de l’écriture, c’est autre chose. Ce sont des promesses que l’on lance, et on sait que si on travaille bien, tout ce temps passé à écrire serait totalement invisible et insoupçonnable pour le spectateur… D’ailleurs, dans votre question, il y avait le terme « prendre chair », et la chair, elle est au moment du tournage. J’ai envie de vous dire la chose suivante : le désir de la chair était dans l’écriture, la chair est arrivée au tournage, et le souvenir de la chair, on tente de le préserver au montage… Et c’est un film de « chairs », évidemment… (sourire)
Propos recueillis à Lyon le 11 juillet 2013 par Guillaume Gas. Un grand merci au cinéma Comoedia ainsi qu’à Christophe Chabert, dont certaines questions ont été reprises ici
