
Claustrophobie d’un univers aseptisé
Quand on lit les interviews de Bruce Miller, le showrunner, ou de Colin Watkinson, le directeur de la photographie, on réalise que la réalisatrice a joué le pivot entre la writer’s room et l’équipe technique. Par ses aptitudes relationnelles, elle a permis de coordonner le tout comme un ensemble harmonieux. D’ailleurs, ils ont tourné la saison 1 d’un bloc, à la manière d’un film de plusieurs heures (vade retro satanas répondront les sériephiles absolutistes mais ce sont les termes de Colin Watkinson, on n’invente rien), preuve de l’unité qu’ils ont voulu donner au projet. Comme pour The Knick, le travail a si bien misé sur la collaboration (y compris avec les acteurs principaux) que la mise en scène porte le scénario et le transcende. Ainsi, la réalisation peut s’analyser à l’aune du symbolisme, et on précise d’ailleurs que Reed Morano n’a pas hésité à cadrer certaines scènes elle-même, jouissant de son ancien métier de chef op’, le travail avec Colin Watkinson a donc pris la forme d’un dialogue : quand elle disait « composition picturale », il lui répondait tout naturellement « peinture baroque hollandaise », et le projet artistique de se préciser. Un duo inspirant !

La palette colorimétrique ci-dessus représente bien les couleurs dominantes de la série et situe notamment le contraste du bleu et d’un rouge assombri. La République de Gilead semble jalonnée de repères visuels qui renvoient bien sûr à une société de classe, sur un modèle quasi féodal mais aussi aux valeurs qu’elle prône. Cette société renvoie à l’imaginaire stalinien : prétendre donner sa place à chacun mais finalement effacer les identités et les fondre dans un collectif aliénant. Le régime est ici particulièrement hypocrite puisque seuls les hommes sont valorisés et ont accès aux fonctions de commandement, la femme est supposée être vénérée car porteuse de vie mais on la marginalise et brutalise, et ce, de manière graduelle. L’explosion de l’horreur sera marquée par les colonies qui se dressent en goulags des temps modernes. Mais l’intertexte ne nous renvoie pas seulement aux grandes dictatures qui ont secoué le XXe siècle (le logo d’aigle peut faire penser au IIIe Reich) mais esquissent aussi une toile de fond religieuse. Le drapeau de Gilead représente une colombe encadrée de rameaux tandis que le symbole des servantes écarlates représente une mère inscrite dans un cercle, probablement pour refléter le renouveau du monde et l’éternité. Echo aux déesses de la fécondité pendant le néolithique et l’Antiquité. Les servantes que l’on dispose systématiquement en cercle, mais aussi le logo qui les symbolise. Dans cet univers tragique, on remarque deux constantes colorimétriques qu’on associe volontiers aux servantes écarlates : le blanc et le rouge.


Le blanc : symbole de la pureté soit du rôle qu’on confectionne aux filles. En leur livrant leurs ailes blanches, on fait d’elles des vaisseaux divins de Dieu. Le blanc se faufile souvent en arrière-plan, via la lumière, un paysage enneigé, un ciel nuageux, des rideaux en dentelle ou bien encore pour les gros plans les ailes qui servent de coiffure aux jeunes femmes. Ainsi, les personnages sont souvent encadrés de ce voile virginal qui serait là pour les écarter de la société, les garder sous un sceau divin. C’est par leur statut d’être choisis par dieu qu’on justifie leur statut dans la société. Ce sont à elles qu’on demande de laver le sang des fusillés, comme si elles devaient absorber les vices des Hommes et payer pour l’extinction du monde et notamment la baisse de fécondité.
Le rouge : le rouge comme seul repère, seule couleur vive admise par la société, évocateur du sang, il rallie les filles qui sont seulement identifiables par leurs longs vêtements impersonnels. Non seulement, on a volé le nom de ces jeunes femmes mais en plus on leur ôte tout signe distinctif comme si elles devaient devenir les allégories de la fécondité. En outre, on peut se demander si le tissu rouge n’évoque pas le sang qui se serait infusé au travers du tissu, le fameux Mal qu’elles devraient éradiquer du monde, cela explique pourquoi on leur demande en plus de leur rôle de mères porteuses d’être des personnages sacrificateurs et de condamner les violeurs (ironique puisqu’il y aurait le viol moral servant l’accouplement et le viol amoral).
Ce rouge, assombri, désaturé semble filtré par Gilead comme si dans ce monde, les couleurs du réel étaient altérées par la propagande et l’embrigadement et que le monde ne pouvait plus être perçu selon ses couleurs naturelles. Cela fait écho à la jeune Eden qui ne peut pas comprendre le monde autrement qu’à travers les idées qu’on lui a insufflé adolescente. Elle ne voit plus le réel que par le prisme de sa religion intolérante.
Un bokeh surexposé :
 La première fois que June apparaît, elle est précisément à la fois dans le bokeh (la mise au point étant portée sur le lit) et dans un éclairage en douche qui provient de la fenêtre. Sa silhouette est donc blanchie par les rayons qui la dérobent à notre regard. La transition est assez explicite : June l’individu n’est plus, c’est Offred qui nous apparaît, une marionnette indifférenciable de ses consœurs (bien sûr, la voix-off nous rassurera et nous montrera que June est encore bien présente et que son esprit sarcastique montre son insubordination au système). De cette manière, la série surexposera souvent le bokeh aussi bien qu’elle jouera avec les lens flare. Le jeu sur la profondeur de champ, souvent faible quand il s’agit de gros plans permettra d’envelopper les visages dans une atmosphère cotonneuse, qui viendrait les engourdir. Un bokeh qui sature tout et qui, depuis l’arrière-plan vient tout envahir. Evidemment, les gros plans de June ou Emily, si rapprochés qu’ils couperont les fronts et les mentons feront jaillir l’horreur vécue. Si la majeure partie des plans sont stables et soigneux, ce sont les plans rapprochés anxiogènes qui feront sortir les personnages de leur torpeur habituelle et les rappelleront à leur situation d’esclave. Étymologiquement, l’angoisse est un phénomène physique lors duquel on sent sa gorge se nouer et où l’on a l’impression d’étouffer, c’est bien ce qu’incarnent ces scènes suffocantes : cadrage, profondeur de champ, colorimétrie, axe de prise de vue (contre-plongée) : Reed Morano aura usé de toutes les techniques filmiques pour nous les faire partager.
La première fois que June apparaît, elle est précisément à la fois dans le bokeh (la mise au point étant portée sur le lit) et dans un éclairage en douche qui provient de la fenêtre. Sa silhouette est donc blanchie par les rayons qui la dérobent à notre regard. La transition est assez explicite : June l’individu n’est plus, c’est Offred qui nous apparaît, une marionnette indifférenciable de ses consœurs (bien sûr, la voix-off nous rassurera et nous montrera que June est encore bien présente et que son esprit sarcastique montre son insubordination au système). De cette manière, la série surexposera souvent le bokeh aussi bien qu’elle jouera avec les lens flare. Le jeu sur la profondeur de champ, souvent faible quand il s’agit de gros plans permettra d’envelopper les visages dans une atmosphère cotonneuse, qui viendrait les engourdir. Un bokeh qui sature tout et qui, depuis l’arrière-plan vient tout envahir. Evidemment, les gros plans de June ou Emily, si rapprochés qu’ils couperont les fronts et les mentons feront jaillir l’horreur vécue. Si la majeure partie des plans sont stables et soigneux, ce sont les plans rapprochés anxiogènes qui feront sortir les personnages de leur torpeur habituelle et les rappelleront à leur situation d’esclave. Étymologiquement, l’angoisse est un phénomène physique lors duquel on sent sa gorge se nouer et où l’on a l’impression d’étouffer, c’est bien ce qu’incarnent ces scènes suffocantes : cadrage, profondeur de champ, colorimétrie, axe de prise de vue (contre-plongée) : Reed Morano aura usé de toutes les techniques filmiques pour nous les faire partager.


Les flashbacks plus vivaces que le réel
« We wanted the flashbacks to feel as real as right now. Once it all came together, the scary part of the flashbacks is that it feels so real, which made Gilead even scarier. » »
[1]
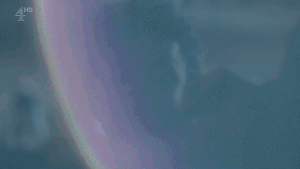
Episode 7 saison 1, 26 minutes
Quand Luke, blessé, est recueilli par des résistants, il se remémore la cabane dans laquelle ils s’étaient réfugiés avec June et Hannah. Un moment idyllique : il les observe alors qu’elles pâtissent, capture d’un moment familial malgré l’horreur qui approche, soubresaut d’amour avant la séparation. Ces instants du quotidien sont peut-être furtifs mais ce sont eux qui permettront à June de survivre, qui symboliseront la liberté et la quintessence du bonheur. On remarque bien que la République de Gilead en a soigneusement éradiqué toutes les manifestations ; d’intime il n’y a plus en dictature. La fin de la scène est saturée de lens flare qui viennent obstruer le champ de vision, nous faisant épouser le point de vue de Luke. C’est l’irrégularité de la mémoire qu’on met en scène : son cerveau ne restitue plus précisément tous les gestes du passé et n’en rejoue que quelques bribes. Il se concentre ainsi sur un sourire, une main qui agrippe un saladier, une mèche de cheveux rebelles. Les rayons lumineux embellissent la scène et montre aussi le cocon que le couple a réussi à construire dans la phase finale de sa fuite. Finalement, la musique s’efface et ne devient plus qu’un écho à mesure que Luke revient au réel, la lumière blanche se muant en une nuit anxiogène.
Her second challenge was how to shoot flashbacks while avoiding clichés. Morano’s preferred aesthetic is “less is more,” and she wanted the flashbacks to look like fleeting memories. “I pitched that they would always be shot in a way that felt more romantic, impressionistic, vérité,” she says, “so maybe you didn’t catch every line on camera, kind of like the way when you’re thinking back on something, you don’t remember exactly what everyone looked like in that moment, but you do remember certain parts of that moment.” »
[2]
En mettant en scène l’imprécision des souvenirs, la réalisatrice leur donne aussi une valeur impressionniste (la sensibilité luministe, la volonté d’immortaliser un instant furtif, la construction d’un point de vue subjectif via les jeux de plongée/contre-plongée). June se repasse les films de sa vie pour garder espoir, tromper l’ennui, s’accrocher à cette identité qu’on souhaite lui voler, car à mesure que le récit avance, c’est Offred qui semble prendre le dessus. Comme l’explique Reed Morano, les flashbacks qui doivent paradoxalement paraître plus vivaces que l’actualité des personnages, comme si la pseudo République qui avait succédé aux Etats-Unis était fictive.
The flashbacks were to be what Reed called “cinema verite” — a very visceral type of camerawork, to really put you in the moment. We wanted the flashbacks to feel as real as possible. The reason being even though they are flashbacks in the story, you are looking at today in the world and we wanted people to feel,”That’s right now.”
[3]
Reed Morano explique qu’elle voulait s’inscrire dans la théorie du « Cinéma vérité » et reprendre donc l’héritage de Dziga Vertov qui a tant inspiré La Nouvelle Vague française. Le cinéaste s’efface au profit de son sujet et donne l’impression d’immortaliser « du vrai ». Le vrai, c’est la caméra épaule du reportage, une captation toute en légèreté où l’œil de l’opérateur flotte autour de son sujet. Pas de science établie avec le cinéma vérité mais la preuve d’une réflexion continue quant à la meilleure manière de retranscrire la vérité intime des personnes filmées. Le vrai, c’est donc le passé de June a contrario de son présent qui ne lui permet plus aucune intimité. Cette époque est confortable parce que familière mais aussi parce qu’elle est sublimée par les personnages qui la revivent. Ce temps perdu semble s’établir en parallèle du présent, comme si ce quotidien révolu continuait d’exister (et ce, par la mémoire des protagonistes). Et comment cette « everyday life » (emmener les enfants à l’école, se préparer à partir travailler) aurait-elle pu se volatiliser ? Cette hypothèse semble si absurde que cauchemardesque. La force de ces flashbacks, c’est qu’ils sont toujours internes – en reprenant la terminologie de Gérard Genette – en effet, ils suivent le fil des souvenirs de June et sont toujours initiés par des raccords objets : c’est la vision d’un matériau qui mène au passé. Ainsi, ils ne sont pas guidés par une instance extérieure qui, de manière artificielle, entrecouperait le récit pour nous transmettre des informations et nous laissent calqués sur le ressenti des personnages.
 Ces bulles mémorielles ne nous sont pas seulement destinées et ne nous coupent donc pas de la narration puisqu’ils nous permettent d’épouser le point de vue du personnage principal. On vit ainsi avec horreur la saison 1 parce qu’on la ressent à travers ses propres perceptions, ce sentiment atteindra son paroxysme au début de la saison 2 où June réaffirme son identité : « My name is June Osborne. I’m from Brooklyn, Massachusetts. I am 34 years old. I stand 5’3″ in bare feet. I weight 120 pounds. I have viable ovaries. I’m five weeks pregnant. I am… free. ». June, c’est la citoyenne moyenne, elle n’est pas cadre, elle n’est ni mince, ni grosse, plutôt jolie sans avoir le physique d’un top-model, etc. C’est bien parce qu’elle n’a, a priori, rien de particulier qu’on sent que son destin peut arriver à n’importe qui. Impossible de ne pas penser alors à toutes les femmes qui traversent des traumatismes similaires au moment où ces lignes sont rédigées, un rappel au réel, une exhortation de ne pas fermer les yeux parce que la vue nous dérange. Le sentiment d’irréel, comme si le présent avait déraillé du fil normal des évènements est catalysé par la multi-personnalité de June, scindée en plusieurs identités : June, Offred, l’amante du Commander. Puisque ce n’est jamais elle-même qui vit ces évènements mais un pantin qui aurait pris sa place, on suppose que tout n’est que simulacre. Et à la caméra portée employée pour les flashbacks répondra une caméra sur pied pour le présent dystopique, de quoi projeter à l’écran l’ordre sclérosant de la République de Gilead.
Ces bulles mémorielles ne nous sont pas seulement destinées et ne nous coupent donc pas de la narration puisqu’ils nous permettent d’épouser le point de vue du personnage principal. On vit ainsi avec horreur la saison 1 parce qu’on la ressent à travers ses propres perceptions, ce sentiment atteindra son paroxysme au début de la saison 2 où June réaffirme son identité : « My name is June Osborne. I’m from Brooklyn, Massachusetts. I am 34 years old. I stand 5’3″ in bare feet. I weight 120 pounds. I have viable ovaries. I’m five weeks pregnant. I am… free. ». June, c’est la citoyenne moyenne, elle n’est pas cadre, elle n’est ni mince, ni grosse, plutôt jolie sans avoir le physique d’un top-model, etc. C’est bien parce qu’elle n’a, a priori, rien de particulier qu’on sent que son destin peut arriver à n’importe qui. Impossible de ne pas penser alors à toutes les femmes qui traversent des traumatismes similaires au moment où ces lignes sont rédigées, un rappel au réel, une exhortation de ne pas fermer les yeux parce que la vue nous dérange. Le sentiment d’irréel, comme si le présent avait déraillé du fil normal des évènements est catalysé par la multi-personnalité de June, scindée en plusieurs identités : June, Offred, l’amante du Commander. Puisque ce n’est jamais elle-même qui vit ces évènements mais un pantin qui aurait pris sa place, on suppose que tout n’est que simulacre. Et à la caméra portée employée pour les flashbacks répondra une caméra sur pied pour le présent dystopique, de quoi projeter à l’écran l’ordre sclérosant de la République de Gilead.
De Vermeer à The Handmaid’s Tale
Reed Morano voulait absolument que le village où vit June soit filmé comme un tableau et que les compositions des plans soient tirées au cordeau. Pari réussi puisqu’on pense immédiatement à Vermeer en contemplant les petits intérieurs rustiques de la série, ses tonalités bleues ou encore son éclairage. La référence est assumée par Colin Watkinson, ne nous accusons donc pas d’extrapolation, Vermeer est bel et bien omniprésent dans la série de Hulu. [4]
Le mariage du traditionnel et du moderne
I didn’t want it feel like a period piece. That was my fear with the costumes and everything. I pushed very hard that all the uniforms in Gilead had modern elements to them. Period would defeat the purpose.
[5]
Les teintes bleutées forment une étrange antithèse : en effet, elles peuvent nous renvoyer vers un monde futur, monde où l’a technologie n’a pas été totalement éradiquée puisqu’Internet continue à être d’usage parmi l’oligarchie qui use d’ailleurs pour ses déplacements de massifs SUV aux vitres teintées mais elles inondent des environnements rustiques.
« Another example was the supermarket. She was obsessed over that in prep. We must have looked at dozens of places, trying to get a supermarket that we could empty out and put our own stuff in. She had a certain feeling of what it should be. It had to feel like you knew this place, like you’ve been there before, but now it was different. It was meandering between different ideas in prep, but she was literally an arrow that never wavered. It couldn’t be like a farmer’s market. It had to be what we know, but bleak. »
[6]
Lors du pilote, on nous fait comprendre sans mots que la guerre a raréfié la nourriture et que la situation économique est tendue, de quoi poser le contexte sans logorrhée inutile. Cela nous aide aussi à comprendre comment une partie de la population a pu adhérer au projet des « Fils de Jacob » car ce sont toujours des situations économiques dramatiques qui précipitent les renversements des systèmes politiques. En outre, le choix de ce supermarché illustre un nouveau monde situé à l’intersection de la modernité et de la tradition, un monde où le technologique n’est pas totalement proscrit mais doit se faire relativement discret et exceptionnel, un monde où l’on impose la sobriété. Selon l’argumentaire de Gilead, ce monde permettrait de renouer avec le naturel et d’épouser la volonté divine, ce sont les commandeurs et leurs épouses qui l’ont façonné, eux-mêmes à la manière de chef décorateurs de cinéma. Ainsi, chaque objet et monuments doivent se faire signe du religieux (le profane est proscrit) et cela renforce l’impression d’un univers situé hors du réel.
Les intérieurs bourgeois
Dans ce nouvel ordre iconoclaste, les imageries ou les textes religieux sont proscrits (sauf pour les commandeurs qui jouissent maints privilèges) mais les intérieurs bourgeois ne manquent pas de nous rappeler les scènes de genre protestantes Dans la ville où vit June, on essaie de se calquer sur un mode de vie traditionnel et un ordre social qui peut rappeler les Provinces Unies (Pays-Bas actuels) tels que les représentaient Vermeer ou son confrère Pieter de Hooch.
 Cette scène fait particulièrement penser à la Laitière, on observe Rita en train d’effectuer des gestes quotidiens. Quand le peintre donnait l’impression de figer le temps pour découvrir la poésie d’un moment anodin, le monteur choisit le ralenti pour que l’on se focalise sur la farine. Dans chacun des cas, on observe la cuisinière depuis le seuil de la porte, nous ne sommes pas très loin d’un sujet mystérieux et tentons de lui dérober une fraction d’intimité. D’autres scènes qui mettent l’accent sur le travail ménager ponctueront la série, de la cuisine, au tricot, au ménage, au rangement ou au jardinage. Le microcosme du domicile, rustique et propret renvoie à la société d’ordres imaginée par Les Fils de Jacob, la servante doit épousseter la maison et cuisiner, l’épouse passe les commandes car c’est à elle que revient l’intendance du foyer, elle tricote pour se glisser dans le seul rôle qu’on lui laisse : la maternité. Les servantes écarlates n’ont d’autres missions que de procréer et aller acheter des denrées alimentaires, ce qui n’est pas contradictoires, de la fertilité de la terre à la fertilité de la femme, il n’y a qu’un pas.
Cette scène fait particulièrement penser à la Laitière, on observe Rita en train d’effectuer des gestes quotidiens. Quand le peintre donnait l’impression de figer le temps pour découvrir la poésie d’un moment anodin, le monteur choisit le ralenti pour que l’on se focalise sur la farine. Dans chacun des cas, on observe la cuisinière depuis le seuil de la porte, nous ne sommes pas très loin d’un sujet mystérieux et tentons de lui dérober une fraction d’intimité. D’autres scènes qui mettent l’accent sur le travail ménager ponctueront la série, de la cuisine, au tricot, au ménage, au rangement ou au jardinage. Le microcosme du domicile, rustique et propret renvoie à la société d’ordres imaginée par Les Fils de Jacob, la servante doit épousseter la maison et cuisiner, l’épouse passe les commandes car c’est à elle que revient l’intendance du foyer, elle tricote pour se glisser dans le seul rôle qu’on lui laisse : la maternité. Les servantes écarlates n’ont d’autres missions que de procréer et aller acheter des denrées alimentaires, ce qui n’est pas contradictoires, de la fertilité de la terre à la fertilité de la femme, il n’y a qu’un pas.
Une ville fluviale
Grâce à l’un des rares flashbacks qui montre la mise en place de Gilead, on voit la ville se modeler pour correspondre aux idéaux du régime : les maisons sont vidées du superflu, l’aménagement urbain est repensé et les vêtements sont jetés au profit d’uniformes. La ville choisie ici par Serena est intéressante car à taille humaine et surtout, les monuments et maisons n’y sont jamais bien hauts, comme pour ne pas concurrencer le divin et le naturel, comme pour attester de sa modestie face à la toute-puissance des cieux. Au contraire, la métropole (Boston) symbolisera le vice car on ne l’apercevra qu’à travers un bordel (illégal à Gilead bien sûr mais largement fréquenté par les commandeurs).
Lors des promenades effectuées par June le long du fleuve, on aperçoit une balustrade noire en fer forgé, seule infrastructure qui renvoie encore au monde moderne. Cette ville est déconstruite pour mieux coller à l’imaginaire d’autrefois : on cherche à retrouver une topologie similaire aux villes de la Renaissance. Si le régime fait détruire les œuvres d’art, il semble pourtant que la peinture hollandaise leur a servi d’inspiration. De nombreux peintres réalisèrent des vues d’un paysage urbain séparé par un fleuve mais ici, ne serait-ce pas une nième convocation de Vermeer, de sa Vue de Delft, une des plus célèbres vedutas (paysage urbain) qui soient ? Les teintes bleu/gris se marient aux couleurs brunes, les nuages laissent passer quelques rayonnements solaires et on a l’impression de sentir planer sur la ville une présence mystique.


La profondeur de champ et l’éclairage, signes d’une présence divine
La composition des plans est elle aussi assez similaire à la composition des tableaux de l’artiste : on observe toujours une ouverture, soit à l’arrière-plan soit sur le côté, sous la forme d’une fenêtre ou d’une porte ouverte. Ces motifs récurrents en histoire de l’art ou même en littérature – on se souvient des heures que passait Madame Bovary à sa fenêtre – servent à symboliser le désir d’ailleurs ou l’ennui. Quand les rideaux sont fermés et que les ouvertures sont obstruées, c’est l’impossible fuite qu’on met en scène. En outre, les pièces sont baignées dans une douce obscurité que soulignent des rayons lumineux. Dans cet environnement calme, on se concentre sur les gestes d’une femme : comme chez Vermeer, certains gestes sont répétés à de multiples reprises : la lecture, le geste de verser une boisson dans un verre. Le travail sur la profondeur de champ et l’éclairage permettent au regard de se promener dans les décors, de les balayer comme à la recherche d’une issue pour June. On devine qu’elle cherche des éléments familiers auxquels se raccrocher, éléments qui pourraient peut-être nouer un lien avec son passé mais dans cette tranquillité domestique, tout est froid et formel. Trop rangé, trop soigné.

La production designer a su créer une profondeur de champ grâce aux dégradés de couleur, si bien qu’on approche parfois le camaïeu en déclinant une même teinte sous différentes nuances. Colin Watkinson a quant à lui utiliser la machine à brouillard DF-50 pour densifier l’atmosphère et souligner l’éclairage en provenance des persiennes, cela lui a permis de distinguer les différents plans de l’image et de donner l’impression d’une profondeur de champ augmentée, en permettant au regard de circuler à travers les décors. [5]
À Gilead, l’éclairage n’est pas réaliste puisque la lumière filtrée par les fenêtres forme systématiquement des rayons précis qui renvoient aux iconographies religieuses. Dans les flashbacks, les lens flare avaient vocation impressionniste, ici ils sont plus ordonnés et rigoureux, renvoyant à une lecture mystique. On sent l’ironie poindre puisque le Dieu imaginé par Gilead n’existe pas, on voit bien à travers des flashback que les initiateurs du mouvement, Fred par exemple, n’avaient pas la moindre foi en ce qu’ils prônaient et qu’ils ont inventé des rituels par pure fin marketing. Par exemple, le rituel d’accouplement n’a pris cette forme que pour apaiser les épouses de l’oligarchie. Quel est donc ce divin ? Il pourrait constituer un simple trait cynique, ébauchant l’idée selon laquelle ces rayons ne cachent qu’un néant abyssal. On voit des signes là où on le veut, chacun les interprète à sa guise et un intolérant peut en faire son outil d’oppression. La République de Gilead respire le religieux de toutes parts mais n’en est pourtant qu’un simulacre, l’ironie est bien là : il est extrêmement facile de mettre au point un culte et d’inventer de toutes pièces une liturgie. Le nouveau monde est béni par la lumière d’un dieu qui n’existe pas, comme pour mieux se calquer avec la doxa de Gilead. Traditionnellement, on interprèterait la lumière blanche qui entoure les servantes comme la main de Dieu qui les aurait choisies. Or par notre connaissance du contexte, il n’y a pourtant aucune ambiguïté, on sait bien que tout est factice dans la religion d’Etat. In fine, cela pourrait révéler l’absurdité de nos religions : y a-t-il grande différence avec les croyances actuelles ? Nous interprétons des signes selon une grille de lecture écrite par les Hommes et croyons pouvoir expliquer le monde par ce prisme.

Cependant, on remarque que les références faites à l’Eglise sont nombreuses et rendent toujours antagonistes « le nouveau Dieu » des anciens dieux monothéistes. Par exemple, Janine est persuadée malgré les atrocités vécues qu’il ne l’a jamais abandonnée et qu’elle a survécu par sa volonté, celui auquel June elle-même s’adresse régulièrement. On conspue la secte nouvellement formée mais toute trace des anciennes religions est bonne à prendre : du Christianisme à l’Islam, les vieilles pratiques rassurent. Lors de sa fuite, June aperçoit un Coran et un tapis de prière islamique, elle le déroule et se positionne dans la direction de la Mecque pour prier. Elle a soudain l’air apaisée, comme touchée par la grâce. Inutile de savoir s’il s’agit d’un effet placebo ou si comme Janine le pense, un destin régit la vie des personnages, judicieusement la série ne tranche pas et laisse au spectateur la liberté de choisir entre lecture par la foi ou lecture par la conviction athéiste. L’important est ailleurs : ce n’est pas la religion qu’on rejette mais bien les extrémistes qui la détournent et l’exploitent, la religion est au contraire perçue comme protéiforme et malléable : chacun peut l’interpréter comme il le souhaite et doit avoir en sa possession des outils pour accéder lui-même aux textes. Ainsi, Janine imagine un mariage profane au beau milieu des colonies, ce n’est pas conventionnel mais le symbole prime sur les conventions et les règles édictées par autrui. Quand June répète « it’s okay », c’est peut-être donc une prière qui ne dit pas son nom plus qu’une parole rassurante, il s’agirait d’un franc signe de foi, d’un appel à une force extérieure.

La République de Gilead : un régime iconoclaste
On retrouve l’iconoclasme aux origines de la Réforme protestante puisque sous Calvin, on incitait à détruire des portraits des saints et que de nombreux édifices religieux ont été gravement endommagés. Au milieu du XVIe siècle, ce sont les Pays-Bas qui en sont victimes mais cela s’apaisera si bien que le Siècle d’Or hollandais verra les relations entre catholiques et protestants adoucies. Pourquoi l’iconoclasme ? Dans Simulacre et Simulation (« L’irréférence divine des images »), Baudrillard montre que deux thèses s’opposent : d’une part, certains considèrent que les représentations tuent le réel car elles le précèdent et finissent par l’éclipser, d’autres pensent que les représentations sont un puissant outil de médiation avec le réel. L’iconoclasme est bien sûr animé par la première idée. Si l’on peut représenter Dieu, soit le simuler, c’est qu’on peut l’exprimer par des signes. Or, s’il est si grand, voire ineffable, comment pourrait-il être exprimé par une représentation matérielle ? Ce Dieu-là ne serait déjà plus qu’un simulacre et aurait perdu toute sa substance. La divinité de la nature ne pourrait donc être copiée, c’est pourquoi les icônes étaient assimilées à des simulacres. La question centrale est la suivante : ces représentations véhiculent-elles l’essence du divin ou au contraire en évaporent-elles l’essence en ayant tenté de le calquer ? En nous fascinant, le simulacre éclipse Dieu, c’est finalement sa représentation qui nous attire et nous subjugue plus que sa réalité, c’est comme si nous n’avions jamais été qu’au contact du simulacre et jamais du divin. La plus grande peur des iconoclastes n’était pas qu’ils aient caché la réalité divine mais que peut-être il n’y ait jamais rien eu de plus que du simulacre. Si les religions n’ont jamais été motivées que par l’amour des représentations alors comment être sûr qu’elles n’aient pas dissimulé du néant ? Il faudrait savoir faire vivre la foi sans simulacre pour vérifier que Dieu existe bien.

Gilead s’inscrit dans ce souci mais va plus loin, en laissant intact les représentations religieuses du passé alors les nouveaux croyants ne verraient pas d’adéquation entre leur nouveau Dieu et celui qu’on représentait autrefois. Or de ce Dieu monothéiste, il ne peut y avoir qu’un. Par ailleurs, celui-ci est perçu comme plus absolu que le précédent, comme si cette nouvelle religion ne pouvait cohabiter avec d’autres perceptions du divin et devait anéantir toutes les autres. Ce dieu plus panthéiste que monothéiste ne pourrait supporter d’être représenté précisément parce qu’il est ineffable. Ce serait du moins la position des croyants tels que Serena et Fred. Pour elle, Dieu est en tout et ici-bas, et c’est en jardinant qu’elle l’honore. Le souffle panthéistique (doctrine selon laquelle Dieu se confond avec la nature) est ici amené d’un refus du médical, d’une limitation du technologique. Par conséquent, Serena s’immerge dans ses serres florales pour oublier l’imperfection du système – oublier qu’il est un simulacre – et fusionner avec sa réalité mystique. Fred serait quant à lui plus cynique et ses raisons d’interdire aux femmes la lecture sont différentes. La représentation par l’image ou le texte est un moyen de médiation entre le peuple et la foi, permet au peuple de se l’approprier. Or, le peuple ne doit pouvoir exercer de regard critique sur la religion officielle et doit surtout être maintenu dans l’ignorance et l’inculture, ce qui explique le court plan d’autodafés tourné lors de la saison 1 et qui résonne avec nos heures les plus sombres.
 La fin de saison 2 rompt enfin le statu quo et permet à Serena de s’affirmer, quittant la voie de l’iconoclasme et renouant avec son passé de lettrée, on ne sait pas encore comment elle combinera ces choix nouveaux à ses idéaux mais on devine qu’elle et June deviendront des alliées inattendues. Nous espérons vivement que la série proposera de nouveaux choix de mise en scène et de photographie. En attendant, on se délectera encore quelques semaines des précieux plans tournés par Reed Morano façon « ciné-vérité », et notamment la remarquable scène de l’aquarium. La saison 3 sortira début juin 2019, pour vous remettre dans le bain, n’hésitez pas à (re)lire notre critique/bilan des saisons 1 et 2 ! Stay tuned !
La fin de saison 2 rompt enfin le statu quo et permet à Serena de s’affirmer, quittant la voie de l’iconoclasme et renouant avec son passé de lettrée, on ne sait pas encore comment elle combinera ces choix nouveaux à ses idéaux mais on devine qu’elle et June deviendront des alliées inattendues. Nous espérons vivement que la série proposera de nouveaux choix de mise en scène et de photographie. En attendant, on se délectera encore quelques semaines des précieux plans tournés par Reed Morano façon « ciné-vérité », et notamment la remarquable scène de l’aquarium. La saison 3 sortira début juin 2019, pour vous remettre dans le bain, n’hésitez pas à (re)lire notre critique/bilan des saisons 1 et 2 ! Stay tuned !
[1] Cinematography of Handmaid’s Tale : interview with Colin Watkinson, Pushing Pixels : https://www.pushing-pixels.org/2018/04/28/cinematography-of-the-handmaids-tale-interview-with-colin-watkinson.html> [2] How Reed Morano created its look, Vulture, https://www.vulture.com/2017/09/the-handmaids-tale-how-reed-morano-created-its-look.html>[3], ‘The Handmaid’s Tale’: Finding Lenses (and Cameras) to Create the Unfamiliar World of Gilead, Indie Wire : https://www.indiewire.com/2017/06/handmaids-tale-reed-morano-cinematography-1201845595/>[4], The Handmaid’s Tale DP on Using Old Lenses, Vermeer and Drones to Conjure Dystopia, MPAA : https://www.mpaa.org/2017/12/handmaids-tale-dp-using-old-lenses-vermeer-and-drones-conjure-dystopia-2/>; [5] Interview de Reed Morano pour Indiwire : https://www.indiewire.com/2017/06/handmaids-tale-reed-morano-cinematography-1201845595/[6] Cinematography of The Handmaid's Tale : https://www.pushing-pixels.org/2018/04/28/cinematography-of-the-handmaids-tale-interview-with-colin-watkinson.html